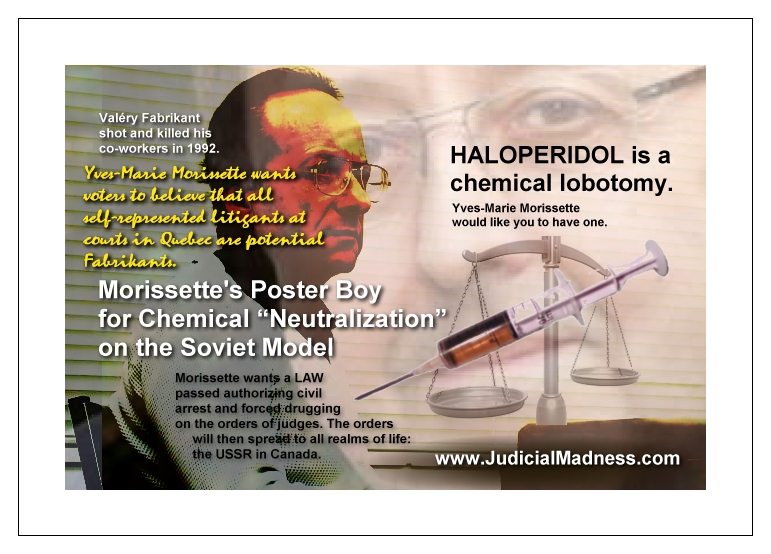2012-01-31 Committee on Institutions
Journal des débats (Hansard) of the Committee on Institutions
Version finale
39th Legislature, 2nd Session
(February 23, 2011 au August 1, 2012)
Tuesday, January 31, 2012 – Vol. 42 N° 61
Consultation générale et auditions publiques sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile
Table des matières
Auditions (suite)
M. André Bois
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. (ACCAP)
Observatoire du droit à la justice (ODJ)
Fédération de ressources d’hébergement pour femmes
violentées et en difficulté du Québec (FRHFVDQ)
Association du Barreau canadien, division Québec (ABC-Québec)
Association professionnelle des sténographes officiels du Québec (APSOQ)
Mme Linda Bérubé
Autres intervenants
M. Bernard Drainville, président
Mme Filomena Rotiroti, présidente suppléante
M. Jean-Marc Fournier
Mme Véronique Hivon
* Mme Andréanne Gobeil, accompagne M. André Bois
* M. Marc Gagnon, ACCAP
* Mme Esther Houle, idem
* M. Yves Millette, idem
* M. Pierre Noreau, ODJ
* Mme Huguette St-Louis, idem
* Mme Marie-Claude Sarrazin, idem
* Mme Manon Monastesse, FRHFVDQ
* Mme Sylvie Bourque, idem
* M. Antoine Leduc, ABC-Québec
* M. Babak Barin, idem
* M. Pierre Giroux, idem
* Mme Rosa Fanizzi, APSOQ
* M. André Boudreau, idem
* M. Jean-François Longtin, idem
* Témoins interrogés par les membres de la commission
Journal des débats
(Neuf heures cinquante-deux minutes)
Le Président (M. Drainville): Alors, à l’ordre, s’il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Alors, le mandat de la commission, c’est de tenir des audiences publiques sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile.
Mme la secrétaire, est-ce qu’il y a des remplacements?
La Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Matte (Portneuf) sera remplacé par Mme L’Écuyer (Pontiac).
Le Président (M. Drainville): Merci beaucoup, Mme la secrétaire.
Alors, ce matin, nous allons entendre les représentations de Me André Bois, de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes et nous allons entendre également l’Observatoire du droit à la justice de l’Université de Montréal. En après-midi, nous recevrons la Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, le bureau canadien, section… le Barreau canadien, dis-je bien, section Québec, l’association provinciale des sténographes officiels du Québec et finalement Mme Linda Bérubé.
Auditions (suite)
Alors, nous allons débuter sans plus tarder avec Me Bois. Je vous inviterais à présenter la personne qui vous accompagne. Et, comme vous le savez, vous avez 15 minutes pour faire votre exposé; suivra une période d’échange avec les députés présents et M. le ministre. On vous écoute.
M. André Bois
M. Bois (André): Bien. Alors, je suis accompagné de ma collègue, Me Andréanne Gobeil. Je devais être accompagné d’un autre collègue, Me Lemaire, qui a dû s’absenter pour des raisons médicales.
Alors, M. le Président, M. le ministre, Mmes, MM. les députés, tout comme notre Code civil, le Code de procédure, c’est le résultat d’une lente et sage maturation de 150 ans. Ce code, comme tous les grands codes dans les pays de droit écrit et non pas comme les pays de common law, qui évoluent avec la jurisprudence, ce code-là a échappé à des réformes intempestives et irréfléchies, alors je vous suggère aujourd’hui qu’on s’apprête imprudemment, je le soumets respectueusement, à supprimer deux éléments essentiels de l’armature du système de procédure civile. Le premier élément, c’est le contrôle exclusif des parties et de leurs avocats sur les actes de procédure. Le deuxième élément, c’est le contrôle également exclusif des parties et des avocats sur les éléments de preuve, et je réfère plus particulièrement ici à la preuve par expert et aux interrogatoires au préalable.
Alors, quel motif propose-t-on pour justifier une réforme aussi radicale dans toute l’histoire de notre système de droit judiciaire privé? Le motif, ce serait le coût disproportionné de l’accès à la justice. J’ai 10 minutes pour défendre un système de 150 ans et, dans ces 10 minutes, je veux vous démontrer que le motif, le motif des coûts, n’est ni vrai ni faux, il est indémontré. Alors, voici ma démonstration.
Un différend en droit civil comporte trois phases. La première phase échappe au droit judiciaire privé et au Code de procédure. Un client vient me voir. Bon, jusqu’à présent, la majorité des justiciables sont représentés. Un client vient me voir — ou une cliente — et m’informe que son assureur invalidité lui refuse la prestation d’invalidité. L’assureur prétend que cette personne-là a fait des fausses déclarations lors de la souscription du contrat et prétend également que cette personne-là n’est pas invalide. Je ne lance pas l’action en justice immédiatement, je vais étudier le dossier, je vais correspondre avec l’assureur pour avoir plus de renseignements sur les motifs de son refus et je vais conseiller à ma cliente de retenir les services d’un expert afin de confirmer l’existence du syndrome — supposons qu’ici c’est le syndrome de la fatigue chronique — et confirmer également que cette personne-là n’était pas atteinte dudit syndrome au moment où elle a souscrit l’assurance. Je vais également lui demander si elle a des témoins profanes, des gens qui ont vu la détérioration de son état à la maison et au travail. Une fois que j’ai recueilli cette preuve-là, que vais-je faire? Je vais dire à ma cliente: N’instituez pas le recours, vous n’avez pas de droit ou le droit est trop risqué, ou encore je vais dire: Oui, allez-y, je vais lancer la procédure.
Que savez-vous du coût qui est engagé par le client dans cette première phase là? Que savent les juges? Rien. Où est la disproportion? Peut-être qu’il y en a, mais vous ne savez rien, ce n’est pas documenté, contrairement au régime en droit anglais où tous les frais sont taxés. Et lord Woolf en parle, le fameux Woolf. On en reparlera un peu plus tard.
Alors, première phase. Retenez que j’ai déjà un expert, et ça a pu me coûter 1 000 $, 2 000 $, 3 000 $. J’ai un cas de syndrome de fatigue chronique, les experts sont très rares, ça a coûté 16 000 $, une sommité.
Je lance la procédure parce qu’en mon âme et conscience et avec mes compétences j’ai dit à la cliente qu’elle avait un droit, merci, très bien, on y va, et je me présente à la cour pour le cheminement de l’instance dans le régime actuel, qui est bien, soit dit en passant. Il y a un calendrier qui est imposé. Cette réforme-là fut fort sage parce que ça a permis aux avocats les plus faibles — je dis bien «aux avocats les plus faibles» — de ne pas se faire bousculer par les gros gars de cour pour dire: Si tu inscris trop vite, je te reverrai. Alors là, il y a eu un arbitrage pour les délais.
**(10 heures)**
Dans le système proposé, je vais informer la cour, lors du protocole d’instance, que j’ai un expert. Ah oui, vous avez un expert? Mais il faut un expert commun. Oui, mais j’ai déjà dépensé, moi. La même cour, lorsque je lui proposerai mes éléments de preuve, les interrogatoires, va me dire: Ah, c’est trop, en une demi-heure, parce que ça, c’est du fast-food, ça, la gestion d’instance, les juges n’ont pas le temps d’y consacrer un avant-midi, et moi, j’aurai consacré six mois en mon âme et conscience pour étudier le dossier, et un juge, en une demi-heure, trois quarts d’heure, va m’informer que les procédures m’ont coûté trop cher. Qu’en sait-il? Il n’a pas vu mon compte d’honoraires, il ne sait pas si mes honoraires sont conditionnels au résultat de la procédure, aucune information.
Troisième phase. Alors, je suppose maintenant que le litige ne s’est pas réglé, parce que la plupart, vous savez, des litiges se règlent avant le procès. Et ils se règlent pourquoi? Parce que les interrogatoires au préalable bien fouillés permettent aux deux parties d’avoir une bonne connaissance des faits, de la vérité, et ce n’est pas en deux heures, en bas de 100 000 $, ou cinq heures, en haut de 100 000 $, qu’on obtient nécessairement cette vérité.
Et, en passant, il y a un symbole. À la Cour suprême du Canada, il y a deux gigantesques statues à l’entrée. Une s’appelle, à gauche, Veritas, et, à droite, Justitia, et moi, je vous dis: La plus importante, c’est celle qui est à gauche, la vérité. Alors, moi, en mon âme et conscience, quand je rencontre mon client, je dis: Vous avez besoin de telle vérité, de tel élément de preuve. Je sais ce que ça coûte. Le juge — et la justice — ne sait pas ce que ça coûte dans le système actuel.
Le procès ne se règle pas. Troisième phase: l’instruction. À Québec, c’est plus rapide. À Montréal, là, j’ai une cause de longue durée qui a été inscrite il y a un an et je serai entendu en 2014. Bon, on se dépêche pour attendre, mais ça, c’est un autre problème. Manque de juges, manque de ressources, ça, le problème est et à Ottawa et à Québec.
Alors, le procès, je rencontre des témoins, je les prépare, vérifie leurs dépositions, j’étudie mon dossier, on plaide. Que savez-vous des coûts engagés par le client? Rien. Vous avez l’impression que ça coûte cher parce qu’il y a des anecdotes. La preuve ici pour la réforme, elle est purement anecdotique. Le terme ne vient pas de moi, il vient d’une sommité qui a critiqué le rapport Woolf, qui est Hazel Genn, qui a étudié le «Woolf effect» et qui déplore justement que Woolf, qui avait pourtant… lord Woolf, la preuve, c’est fondé sur des anecdotes. On en a une, anecdote, au Québec, l’affaire Castor Holdings, avec des interrogatoires interminables, et pourtant le code, tel qu’il était, permettait aux parties d’aller au juge et de dire: C’est assez! Et d’ailleurs moi, quand on abuse de mon client, je dis: C’est terminé, je m’en vais. Oui, mais vous allez être en défaut. Non, je m’en vais, on va soumettre la difficulté au juge. Le code actuel donne déjà ce qu’il faut à des avocats qui, en leur âme et conscience, estiment qu’il y a un abus.
Alors, moi, je vous dis, dans les trois phases… dans la phase préjudicielle vous n’avez aucun renseignement sur les coûts, dans la phase entre l’ouverture de l’instance et le procès vous n’avez aucun renseignement sur les coûts, sauf les coûts étatiques, et à la phase du procès vous n’avez aucun renseignement non plus. Et, quand je lis le document ministériel et également toutes les conférences où les juges déplorent les coûts et la disproportion, où vont-ils chercher leurs coûts? Les seuls renseignements qui sont disponibles dans le public, c’est à l’occasion de procédures en droit de la famille où une partie réclame une provision pour frais, qu’on exagère évidemment pour obtenir un peu moins, c’est à peu près le seul cas, ou des réclamations d’honoraires.
Alors, cette réforme-là qui est proposée, le coeur de la réforme, il y a d’excellents éléments ailleurs, là. Enlever aux avocats — parce que c’est les avocats dont il s’agit ici, les parties non représentées sont encore en minorité — le contrôle des actes de procédure et le contrôle de la preuve par expert, ce n’est pas, pour le moment, justifié. C’est très radical, alors qu’il n’y a pas de mal de prouvé.
Deux minutes sur les interrogatoires au préalable. En bas de 100 000 $, j’ai d’abord un petit préalable là-dessus: Pourquoi limiter à deux heures à 100 000 $? Et, dans mon mémoire, j’utilise une image, là: la personne dont le salaire ne fait pas de bruit et qui a accumulé une petite équité de 75 000 $, c’est sa vie, ce sont ses épargnes, et on lui dit: Vous, c’est deux heures. La Royal Bank of Canada, elle, qui poursuit pour 1 million, qui est un quart ou 1/5 du bonus d’un gros bonnet de la direction, bien elle, elle a le droit à cinq heures.
Vous savez, il y a certains économistes qui nous enseignent, depuis Adam Smith, la différence entre le coût et la valeur, hein, et les gagne-petit… Parce que j’ai représenté toutes sortes de gens, y compris Yves Michaud ici, là, j’ai représenté des grandes organisations et je représente de plus en plus des petits, en fin de carrière. Je mets à leur disposition mes connaissances et mon expérience. 75 000 $, c’est énorme, et ils sont prêts à aller à procès parce qu’ils me disent quoi? Ils me disent: L’autre partie n’a pas de droit, ce n’est pas vrai qu’on va me passer sur le corps, même avec une médiation où on va me forcer la main — en anglais on dit «tordre le bras», là — ce n’est pas vrai.
Alors, je soumets très respectueusement que cette proposition de laisser à des juges, même bien intentionnés, qui n’ont pas la connaissance que moi, j’ai du dossier, que ma consoeur, que mes consoeurs et confrères ont de leurs dossiers après des heures d’étude, dans des gestions d’instance qui durent trois quarts d’heure, de limiter la preuve, de limiter les interrogatoires qui sont porteurs de règlement, ce n’est pas correct.
Et, pour les expertises, c’est la même chose. Vous savez, en expertise — et je vais vous proposer un exemple — il y a des écoles de pensée, hein, il y a des débats dans les diverses disciplines. Le syndrome de fatigue chronique, il y a une partie du corps médical qui ne le reconnaît pas, comme on ne reconnaissait pas la fibromyalgie il y a 20 ans. Si l’expert unique — qui ne me le dira pas — ne reconnaît pas le syndrome de fatigue chronique, je suis foutu, hein, puis on ne le saura pas. Dans le domaine du bâtiment, en matière d’enveloppe de bâtiment, isolation, ventilation, il y a des écoles de pensée aussi; on ne saura pas non plus. Et je vais vous donner maintenant deux exemples.
Le Président (M. Drainville): Il vous reste moins de une minute, Me Bois.
M. Bois (André): Oui, bien alors en réponse aux questions.
Le Président (M. Drainville): Ça va, M. le ministre m’indique que vous pouvez dépasser un peu la minute qu’il vous reste. Alors, allez-y.
M. Bois (André): Très bien. Deux exemples vécus.
J’ai représenté une cliente qui justement était soumise à un expert unique, on ne sait pas si c’est un arbitre ou un expert, c’est dans la convention collective des fonctionnaires des cégeps. Elle va voir le médecin en question, et c’est l’expert unique, là, et il lui pose quelques questions, finalement rend son avis à l’effet que cette personne-là, oui, souffre de tel syndrome mais serait peut-être capable d’accomplir des tâches à temps partiel. Dans son rapport d’expert, il dit: Bien, voici, ma déduction, je la base sur une surveillance vidéo de madame, surveillance à laquelle madame n’a pas été confrontée. Alors, où est-il allé chercher ses informations? Alors, voilà un bel exemple, là, d’expert unique. Ces gens-là ne sont pas férus dans la discipline de l’impartialité dans la recherche et la cueillette des faits.
Deuxième exemple: débordement grave d’un cours d’eau qui a inondé beaucoup de gens, expert en hydraulique, expert unique nommé par la cour, un cas vécu. Il arrive, pendant le procès, que l’expert, on lui demande: Où est-ce que vous êtes allé chercher les faits? Ah, bien je suis allé voir à la ville. Mais vous ne m’avez pas informé. Et deuxième anecdote, toujours pour le même expert, bien je lui dis: Très bien, il manquait de faits. Où êtes-vous allé les chercher? Bien, chez telle firme multinationale d’ingénierie, qui représentait une partie. Mais pourquoi vous ne m’en avez pas informé?
Prudence, hein, parce que, dans le nombre limité d’experts que nous connaissons présentement, certains d’entre eux sont rompus au principe ou connaissent bien le principe de l’impartialité et de la nécessité du audi alteram partem, mais ouvrez ça, et je ne suis pas certain qu’à moyen terme, pas à long terme, vous n’aurez pas de problème.
Alors, voilà mes représentations.
**(10 h 10)**
Le Président (M. Drainville): Très bien, maître. Merci pour votre participation, donc, à cette consultation. Et nous allons maintenant céder la parole à M. le ministre.
M. Fournier: Merci, M. le Président. Merci à vous d’être avec nous. J’aurais tendance à commencer en vous disant que je vous attendais. Là, vous allez me dire qu’on a commencé plus tard puis que vous nous attendiez, là, mais ce n’était pas ce que je voulais dire en disant: Je vous attendais. Lorsqu’on travaillait sur la préparation de l’avant-projet de loi — je parle de mon implication, les travaux ont commencé bien avant, j’y reviendrai — la préoccupation que j’avais, c’est de me dire: Mais, lorsqu’on dépose cela, ça change la vie des gens. Je pense ici aux avocats, ça change la pratique. Vous nous parlez d’une lente et sage maturation et que la réforme est intempestive, et je pense que j’ai entendu «irréfléchie». Je vais commencer en vous disant que j’attendais — là, on est au début de la deuxième — j’attendais que quelqu’un vienne nous dire: Ne touchez pas à notre pratique, et je sens que… Je ne disconviens pas que vous mentionnez des éléments, mais j’attendais que quelqu’un vienne me le dire, parce que je crois que vous représentez une proportion certainement très facile à comprendre des gens qui vont venir nous dire: Bien, nous, ça fonctionne, là, puis ce que vous amenez de nouveau risque de ne pas fonctionner, prudence. Bon, «prudence», j’ai entendu «prudence». «Prudence», ça va, pour être franc. «Irréfléchie», je trouvais ça un petit peu fort. Mais je veux quand même profiter de votre présence pour au moins vous dire qu’il y a une certaine partie de réflexion, minimalement on aura eu des échanges où, chacun, on pourra réfléchir à ce qu’on aura entendu ce matin.
Alors, je vous cite juste un rapport d’évaluation de la loi de 2002 déposé devant l’Assemblée et qui a été discuté ici, en Commission des institutions, en février 2008. Le rapport d’évaluation disait: «Le premier constat, sur lequel tous les groupes consultés sont unanimes — alors évidemment, donc, groupes consultés, donc des gens avaient été consultés — c’est que l’expertise en matière civile et commerciale constitue, avec les interrogatoires préalables, et même davantage, la principale source de délai et de coûts élevés des actions en justice. Les expertises sont nombreuses, et les rapports d’expert tardent à être produits et portent sur des objets qui sont parfois en bonne partie inutiles pour trancher les véritables questions…» Je fais juste vous dire que la prudence nous amène à porter attention à un rapport comme celui-là. Il faut bien lui donner un certain mérite. Il semble y avoir des consultations qui ont été faites, puis on a analysé la chose.
J’irais un peu plus loin: le Barreau du Québec lui-même parle de décrochage judiciaire. À un moment donné, on peut aussi se dire: Il n’y a pas de preuve, je n’ai pas les chiffres. On peut dire: C’est anecdotique, ce que vous nous dites. En échange, je pourrais vous dire que vous nous avez présenté aussi des anecdotes. Mais ni un ni l’autre n’est vrai. Je ne pense pas qu’on a à attaquer l’anecdote, l’anecdote est une illustration et une illustration qui peut se trouver généralisée. Quand vous me présentez des cas que vous connaissez, je ne les prends pas comme des anecdotes isolées qui ne représentent pas ce qui se retrouve dans nos palais ou dans nos bureaux, loin de là. Vous illustrez votre vision d’une situation et vous dites: Voici, vous devriez être prudents. J’accepte.
De la même façon, d’autres nous présentent d’autres illustrations. Je ne veux pas les qualifier d’anecdotiques pour elles et illustrations fondées dans votre cas, restons égaux pour tout le monde et disons-nous que les gens essaient d’illustrer ce que ça veut dire. Et ce qu’on a comme rapport, c’est qu’au coeur de notre fonctionnement il semble qu’il y ait un certain nombre d’abus.
Alors, voici l’hypothèse de base avec laquelle nous présentons un projet qui n’est pas intempestif ni irréfléchi. Depuis plus de 10 ans maintenant, il a été l’objet de discussions avec de nombreuses organisations au Québec, évidemment la magistrature, le Barreau, les huissiers, les notaires, enfin, tout ce qui est dans le milieu. Alors, je veux juste préciser ça à ceux qui nous écoutent, ça n’a pas été écrit la semaine passée derrière des portes closes. Alors, on peut être d’accord ou pas d’accord, mais on ne peut pas non plus attaquer le travail qui a été fait depuis 10 ans.
Parlons… Un élément que je voudrais attirer votre attention, vous me parlez de l’expertise. Alors, vous sautez… Et vous n’êtes pas le premier à donner une illustration qui me semble bien correcte, là, tout le monde le dit, ça ne commence pas par: M. le juge, je voudrais une expertise ou je voudrais… J’en ai déjà une. Avant de venir vous voir, j’ai vérifié si j’avais un droit fondé, je comprends ça. Mais, la règle qui est ici, la proposition n’est pas la règle de l’expert unique, c’est la règle d’un expert par partie par matière, et le juge peut… Mais est-ce que vous saviez que la règle qu’on proposait n’était pas de l’expertise unique automatiquement?
M. Bois (André): Non, non, ça, je suis bien conscient de ça, que la règle n’est pas une règle absolue, mais on donne, on accorde une discrétion au juge chargé de la gestion, on élargit son pouvoir de l’imposer, et c’est là où je ne suis pas sûr que ce soit sage, c’est tout, parce que les deux parties, la plupart du temps, ont déjà un expert. Nous représentons aussi des organisations en défense, dont des assureurs. L’assureur sait qu’il y a une réclamation imminente, il demande l’avis d’un expert, et le demandeur a déjà un expert, hein? Alors, moi, mon propos, c’est: Prudence, parce que les deux parties ont déjà engagé une dépense pour obtenir un avis, bon, puis les avis sont contradictoires.
Et je ne voudrais pas être réducteur, mais, quand on a peu de temps, on ne donne pas dans la dentelle, on ne nuance pas, hein, et je veux juste ouvrir une parenthèse. Quand je dis qu’un code doit échapper aux réformes intempestives, je ne dis pas que le vôtre est intempestif, je dis: Soyez prudents, hein, parce que je dis: Un grand texte législatif comme le Code civil ou une charte, il faut être prudent. Alors, je ferme ma parenthèse pour répondre à votre commentaire là-dessus.
M. Fournier: Parenthèse appréciée.
M. Bois (André): Très bien. Alors, oui, on les entend, là, à chaque ouverture de tribunaux, là, bon, la justice coûte cher, mais, je répète, il n’y a pas de preuve. Il est là, le problème. C’est qu’au Québec seul le Barreau aurait le pouvoir, par ses inspections, de faire des vérifications par échantillon de certains dossiers pour vérifier s’il y a disproportion ou pas.
Et, quand je parlais d’anecdote, j’ai été bien prudent. Il y a une sommité au Royaume-Uni qui est Hazel Genn, qui a écrit une quinzaine d’années après le rapport Woolf, et elle déplore que même Woolf, qui avait des statistiques, n’ait pas eu de preuve empirique, hein, elle le déplore. Et les Hamlyn Lectures, là, le premier qui les a données, dans les Hamlyn Lectures, c’est lord Denning. Bon. Alors, elle déplore le manque de preuve empirique dans un domaine aussi sensible.
Alors, voilà, je réponds à votre préoccupation: Oui, il y a des situations où l’expert unique est nécessaire, mais ça se pratique déjà. Dans le domaine familial, c’est systématique, la compétence parentale pour la garde de l’enfant est évaluée par un expert unique, et, pour la liquidation du patrimoine, sauf pour des patrimoines constitués d’actifs commerciaux, il y a un expert unique. Ça se fait sans que ce soit imposé. Bon. Mais, dans les litiges commerciaux, dans une société qui est de plus en plus complexe, moi, j’estime que ce serait imprudent d’accorder une telle discrétion à des juges certes bien intentionnés mais qui n’ont pas la même connaissance que les parties ont de leurs dossiers. Alors, voilà ma réponse.
M. Fournier: Je reviendrai sur les preuves, et tout ça, peut-être dans la deuxième partie. Puis je pense qu’il me reste comme deux, trois, quatre minutes peut-être, là.
Le Président (M. Drainville): En fait, non, il n’en reste plus, M. le ministre, il ne reste plus rien de votre premier bloc de 10 minutes. Il va vous rester un six minutes au retour.
M. Fournier: Ah, mon Dieu! Bien, tantôt, je reviendrai aussi sur l’expertise, là, puis peut-être comment, l’encadrement qu’on peut donner à l’expertise unique, si vous le voulez bien.
Le Président (M. Drainville): Et la raison est simple, évidemment, M. le ministre, c’est qu’on doit répartir sur les trois heures le retard. Donc, Mme la députée de Joliette.
**(10 h 20)**
Mme Hivon: Oui. Alors, bonjour. Bienvenue, Me Bois et Me Gobeil. Très intéressant, je vous ai lu avec beaucoup d’intérêt parce que, la première semaine, disons que les commentaires de la nature de ceux que vous faites aujourd’hui ont été plutôt modérés, en fait il n’y en a pas qui sont allés, je dirais, aussi loin que vous à dire qu’on faisait, en quelque sorte, fausse route de s’éloigner de vraiment le chemin plus traditionnel, et je trouve intéressante l’idée de dire qu’il devrait y avoir des données plus empiriques, c’est-à-dire des données comptabilisées, le parallèle entre les sommes réclamées, les coûts, c’est-à-dire les frais d’avocat, la durée. Bon, ça, je vous suis là-dessus puis je pense qu’effectivement peut-être que ce serait intéressant.
Par ailleurs, je dirais, il y a deux types de justiciable: il y a ceux que vous voyez dans vos bureaux parce qu’ils décident qu’ils vont de l’avant… ou en fait, à tout le moins, ils veulent voir s’ils peuvent aller de l’avant, mais il y a ceux, je vous dirais, qu’on voit dans nos bureaux de députés, qui sont ceux qui n’ont pas les moyens parce qu’ils ne sont pas admissibles à l’aide juridique et qui n’ont pas assez d’argent pour aller plus loin. Donc, ils viennent nous dire: Moi, je n’y arrive pas, je ne réussis pas à trouver un avocat qui peut prendre ma cause. Comment je peux faire?
Donc, est-ce que vous êtes quand même d’accord avec le constat de dire qu’il y a un problème d’accès à la justice et d’une certaine désaffection à l’égard des tribunaux, de manière générale?
M. Bois (André): Oui, en partie, effectivement, ça peut être un repoussoir, l’appréhension des coûts, mais je vais vous parler d’expériences vécues. Nous avons un secteur de responsabilité médicale, au bureau, en demande, c’est des gens en détresse, là, ils ont perdu un revenu à cause d’un accident thérapeutique; les honoraires, on les perçoit quand nous avons un résultat. Ces justiciables-là, on leur dit: On va vous soutenir, et, dans certains cas, les coûts d’expertise, les experts de San Francisco ou même de New York, on les paie. C’est cette preuve-là qui n’est pas faite, alors…
Et je vous parlais de cas d’assurance invalidité. C’est évident que quelqu’un qui a perdu son emploi n’a pas les moyens de me payer, bon, mais, quand ils m’approchent… D’abord, il y a ceux qui ont l’assurance des frais juridiques, là. Bon, ça, c’est un début, ils obtiennent un avis avec ça. Mais ceux qui, dès l’abord, sans même consulter un avocat, se disent: Ça va me coûter cher, oui, mais les gens qui sont prêts à une chirurgie esthétique, à faire un voyage dans le Sud puis ne sont pas prêts à payer un avocat… Parce que ce n’est pas drôle, payer un avocat pour se faire dire qu’on n’a pas de droit. Après 2 500 $, vous n’avez pas de droit. Ce n’est pas drôle, ça, hein? C’est tellement immatériel, tout comme ici ce n’est pas un «emotion-grabber», cette commission parlementaire là. Ce n’est pas avec ça que vous allez avoir des votes, hein? Bon. Alors, c’est la même chose pour les avis légaux.
Alors, oui, vous avez raison, c’est un dissuasif, mais il y a un coût. La phase étatique, il faut payer les juges, il faut payer les greffiers, les palais de justice, puis il y a tout le volet privé, à moins d’avoir l’assurance frais juridiques, un peu comme la carte-soleil. Alors, vous avez raison, oui.
Le Président (M. Drainville): M. Bois, à titre de président de cette commission, je veux tout de même réagir au commentaire que vous venez de faire. À défaut d’avoir la quantité, nous avons très certainement la qualité, et je pense que c’est important de le préciser. Je redonne la parole à la députée de Joliette.
M. Bois (André): M. le Président, je parlais de l’auditoire. C’est que j’ai déjà été ici, et les banquettes arrières étaient très occupées, voilà.
Mme Hivon: Oui. Et je suis sûre qu’on a la qualité de l’auditoire aussi.
Puis, en fait, ce qu’on nous dit aussi, c’est qu’un élément qui rebute beaucoup les gens aussi, c’est un peu d’avoir le sentiment de mettre le bras dans le tordeur quand ils commencent une action devant les tribunaux, et donc je suis bien consciente que ça, ça varie beaucoup d’un avocat à l’autre. Et certains vont aller dans le détail pour vraiment expliquer jusqu’où les coûts peuvent aller, d’autres, disons que ça va être plus flexible comme approche ou comme estimé, mais c’est un autre facteur qui revient — vous allez dire que ce n’est peut-être pas empirique, mais… — je dirais, dans les consultations, dans les phénomènes qui sont un peu observés de désaffection à l’égard des tribunaux. Donc, ça aussi, je pense que c’est une motivation, comme législateurs, qu’on doit avoir, de dire: Est-ce qu’on est capables d’aller un peu, je dirais, prévoir davantage et avec différentes mesures?
Et, avant de passer à la question de la conférence de gestion, sur laquelle je comprends que vous avez beaucoup de réserves, j’aimerais juste vous amener sur la question de la proportionnalité. Je comprends aussi que vous avez beaucoup de réserves. Vous avez donné un bon exemple, à savoir que, bon, quelqu’un dont toutes les économies sont de 75 000 $, ça peut avoir une valeur beaucoup plus grande que la banque qui va avoir une créance de 1 million, mais évidemment vous êtes conscient que, qu’importe le montant, on espère qu’il y a une proportionnalité avec les coûts que l’action en justice va représenter. La personne qui réclame 75 000 $, bien, si, au bout du compte, ça lui en coûte 50 000 $, 55 000 $, que ça s’étire sur des années, est-ce que c’est vraiment comme ça qu’elle va vouloir régler son problème? Donc, ça, j’aimerais vous entendre globalement sur la question de la proportionnalité.
M. Bois (André): J’ai déjà envoyé un article au Journal du Barreau là-dessus, qu’ils n’ont jamais publié, probablement que je suis trop polémiste. Ce que je dis, c’est que, comme il n’y a pas de preuve des coûts, comment le tribunal fera-t-il la pondération? C’est de l’impressionnisme.
Oui, c’est un exercice qui s’impose. D’ailleurs, dans le Civil Procedure Rules, en Angleterre, ce n’est pas un code, hein, c’est un décret. Il y a une loi-cadre, puis c’est un petit décret. Ce n’est pas très important, là. En passant, en Angleterre… On a une charte depuis 1976; ils viennent juste d’avoir un Human Rights Act, depuis 1998, pour ceux qui veulent les imiter, là. Alors, sur les coûts, la pondération que le juge peut faire, peut-être c’est un exercice qui devrait s’imposer, dévoiler quels honoraires vous allez facturer, mais encore faut-il qu’il y ait des critères objectifs et non pas de l’impressionnisme.
Je suis allé à Montmagny pour une cause de 9 000 $, pour représenter un gagne-petit, quelqu’un qui répare des tronçonneuses — on appelle ça «scies à chaîne» ici. Bon, je me suis fait… le juge a voulu me faire porter le bonnet d’âne: Vous êtes ici pour 9 000 $? J’ai dit: Un instant, M. le juge, là, savez-vous ce que je facture à mon client? Bien, ça s’est arrêté là. Il veut justice, c’est tout.
Alors, oui, ça peut être pertinent mais dans la mesure où le tribunal, comme c’est son devoir, s’instruit des faits. Et le fait essentiel, c’est combien ça va coûter. Il ne le sait pas.
Mme Hivon: Est-ce que vous pensez que ça devrait faire partie des éléments? Il y aurait évidemment une grande réticence, on peut s’imaginer, mais est-ce que ça devrait être une ouverture faite aux juges?
M. Bois (André): Si vous allez de l’avant avec ce projet-là, le seul moyen d’avoir un test de proportionnalité conforme à la vérité, c’est d’imposer la divulgation des honoraires que l’avocat se propose de facturer. Sinon, c’est le brouillard dans lequel on va. C’est pour ça que je m’attaque à ça. Moi, quand je débats une cause, c’est suivant la preuve, on pondère les deux droits, hein, mais il y a une preuve. Il n’y en a pas présentement, sauf à l’aide juridique, où c’est connu, mais, pour les avocats, on ne le sait pas. Alors, c’est tout.
Mme Hivon: Mais…
Le Président (M. Drainville): Il reste moins de deux minutes, Mme la députée.
Mme Hivon: O.K. Mais est-ce que vous pensez que les avocats seraient ouverts à ça?
M. Bois (André): Bon. Alors, ça, c’est le problème, il va y avoir… il y aurait une résistance énorme. Mais ils parlent tous la main sur le coeur puis la bouche en coeur, tu sais, puis: Ça coûte trop cher, puis… à chaque septembre, lors de l’ouverture des tribunaux: La justice coûte cher, mais ils ne le savent pas. Il n’y a pas de statistique, rien. Moi, je sais que, si je facture à mon plein taux puis je vais jusqu’au bout, je suis obligé de le dire au client.
En passant, on représente des assureurs en défense, ils exigent un budget de défense puis ils décident s’ils vont aller de l’avant ou pas, et mon devoir comme avocat, en vertu de mon code de déontologie, c’est de dire au client: Ça va vous coûter tant, puis là le client va décider s’il va au bout. C’est déjà dans le code de déontologie.
Alors, oui, peut-être que l’exercice s’impose, mais je ne suis pas certain que les barreaux, qui protègent le public et peut-être en même temps l’intérêt des membres, ne résisteront pas à une mesure comme celle que lord Woolf proposait, de divulguer ce qu’ils facturent.
Mme Hivon: Lord Woolf le proposait, mais ça n’a pas été appliqué. Donc, il n’y a pas de précédent…
M. Bois (André): Non, mais…
Mme Hivon: …à votre connaissance, d’une telle mesure?
M. Bois (André): Oui, mais par contre, en Angleterre, les honoraires sont taxés, et les honoraires taxables, là, c’est les frais extrajudiciaires des deux parties. Lord Woolf, ce que je dis dans mon mémoire — que j’ai gardé très bref, là, parce que je sais que vous lisez beaucoup — il avait accès à quelques données et, malgré… du «taxation officer», là, d’honoraires extrajudiciaires, et c’est là qu’il a été scandalisé, mais il avait une preuve, hein? Il y a des données en Angleterre et au pays de Galles mais pas ici, et cette étude-là a été conduite aux États-Unis. J’ai donné une bibliographie, il y a des études économétriques, là, hein?
Alors, quand je parle du danger d’agir intempestivement, je ne dis pas que vous agissez intempestivement, mais ça, c’est un cas, ici, où les juges qui se mêlent du législatif — soit dit en passant de plus en plus, la séparation des pouvoirs existe-t-elle? — vous pressent de faire des réformes, hein, alors qu’eux-mêmes ignorent tout — c’est pour ça que je parlais des trois phases tout à l’heure — ignorent tout des statistiques quant aux coûts… à moins qu’ils aient des regrets de leur passé d’avocat, là, mais ça, je l’ignore.
Le Président (M. Drainville): Et nous allons nous arrêter là-dessus. Merci. M. le ministre.
**(10 h 30)**
M. Fournier: Oui. Bien, je sens que notre cote d’écoute augmente, là, j’aime autant vous le dire, parce que je trouve ça très intéressant, ce que vous nous dites.
Parlant de preuve, je vais essayer… Rapidement, deux points. Parlant de preuve, juste un exemple, il y a plusieurs des matières qui sont incluses ici — peut-être pas plusieurs mais quelques-unes — qui sont inspirées de projets pilotes qui ont eu lieu, qui ont donné des résultats. Par exemple, à la fin de l’avant-midi, l’Observatoire du droit à la justice va venir nous parler, entre autres, d’un projet qui s’est tenu à Longueuil et qui, selon toute vraisemblance, a fait l’affaire des clients, des avocats et des juges dans une proportion qui dépasse le 90 %. Qui a entraîné quoi? Et pourquoi la satisfaction? Parce que ça a entraîné des délais moindres et des coûts moindres, et tout cela sans que la vérité soit affectée.
Est-ce que je dois m’inspirer de ce genre de projet pilote?
M. Bois (André): Je ne connais pas le projet pilote, mais, si les avocats représentant les deux parties confirment que les clients sont satisfaits, et que les avocats sont satisfaits, bon, là vous avez un bon sondage. Peut-être restreint, mais vous avez un bon sondage.
M. Fournier: En fait, j’ai une pratique qui a donné ce type de résultat et qui indique qu’il s’agit d’un chemin à suivre pour réduire délais et coûts, parce que, bien qu’on puisse prétendre à un degré de preuve d’un certain niveau sur la question des coûts, je vous inviterais à faire ma rue chez nous et de demander aux gens s’ils ont un réflexe, lorsqu’ils ont un certain type de problème, d’utiliser le recours aux tribunaux, et on risque d’arriver à peu près à la situation que ma collègue mentionnait tantôt, c’est-à-dire, dépendamment du problème, le réflexe serait de dire: Je n’ai pas le temps puis je n’ai pas les moyens pour couvrir ça. C’est un phénomène qui existe.
Alors, on peut le prendre sous l’angle pédagogique en disant aux gens: Je vais vous convaincre que vous avez le moyen, mais honnêtement la barre est un petit peu haute à ce niveau-là. Je pense qu’il y a un fondement. Honnêtement, je suis même convaincu qu’il y a un fondement sur la question des coûts et des délais.
Et, puisque je n’ai pas beaucoup de temps, on parlait tantôt de l’expertise, puis je veux juste faire un petit peu de millage, parce que la base de ce qui est proposé, c’est… les parties contrôlent encore la base. On peut l’escamoter pour fins de discussion, dans le cadre de ce forum-là, mais, puisque vous aimez la nuance, revenons au fondamental. Les parties ont leurs experts, un par matière, et tous ceux qui sont venus nous dire que ça, c’était bien, ils avaient une difficulté parfois sur l’expertise unique.
Alors, présenté dans ce contexte-là, c’est déjà différent de: Le projet n’est pas bon parce que c’est l’expertise unique, parce que ce n’est pas ça, mais je ne disconviens pas qu’il y a une discrétion. Est-ce que, plutôt que de le présenter comme vous le présentez, on ne pourrait pas dire: Envisageons un moyen d’encadrer la discrétion? Lorsque les parties ont leurs expertises, il n’y a peut-être pas lieu d’avoir une expertise unique et de laisser libre cours à une autonomie totale du juge, bien qu’on se dise qu’il va probablement en tenir compte, mais, bon, j’essaie de suivre votre raisonnement. N’avez-vous pas imaginé que, plutôt que de dire: Mettons ça de côté, il y a une façon de l’encadrer?
M. Bois (André): Oui, je vais répondre en deux phases. Il y a quelques années, j’avais rencontré un bâtonnier pour lui faire valoir avec ferveur la solution de l’expert unique, alors, tu sais, j’y ai déjà pensé, mais, bon… et depuis j’ai réfléchi. Il y a un dialogue le pour du contre et le contre du pour, là. Si vous allez de l’avant avec la solution, elle est insuffisamment encadrée.
Le meilleur modèle d’expert unique, c’est l’arpenteur-géomètre en bornage. Il y a contestation de son rapport possible, le code m’apparaît silencieux à cet égard-là, et ce qui m’inquiète dans le code, c’est que, comme, l’expert, on lui donne dorénavant la mission non seulement de donner un avis, mais de recueillir les faits… Ma crainte, c’est que, quand viendra le temps de contester le rapport de cet expert-là, que nous dira la cour? Elle va nous dire la même chose qu’elle nous dit en contrôle judiciaire de l’administration publique: Ah, mais ce sont des experts. Vous connaissez, hein, les… Bon, l’erreur simplicitaire est mise de côté, là, l’erreur simple, l’erreur déraisonnable, en fait des catégories qui défient la logique formelle, mais ça, c’est une autre histoire. Mais il n’y a pas d’outil présentement pour, un, vérifier si l’expert est partial, impartial dans sa discipline, pas d’outil pour contrôler son rapport et aller en révision du rapport et pas de questionnement non plus sur les coûts, parce que ce n’est pas mieux.
Vous savez, là, les juges sont en faveur de ça parce qu’ils ne veulent plus trancher dans le cas des expertises compliquées, là, en toute déférence pour eux. C’est embêtant de trancher entre deux grands courants. Bon. Alors là, l’expert unique fait le travail à leur place, il va chercher les faits, il donne son avis, puis c’est terminé pour M. le juge, à moins qu’on ait des griefs à adresser à l’expert, et le projet, tel qu’il est, encadre insuffisamment la possibilité de remettre en cause la qualité dans la… non, l’impartialité dans la cueillette des faits et l’impartialité dans l’expression de son avis. Si vous allez de l’avant, là, c’est insuffisant présentement. Voilà.
Le Président (M. Drainville): Et c’est comme ça que cet échange va se terminer. Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon: Oui, merci. Pour ce qui est de… vu votre longue pratique, un autre problème, bon, c’est, bien sûr, les délais. On nous dit beaucoup que les délais s’allongent, les causes se complexifient, et que donc des causes qui, dans le passé, pouvaient prendre une journée vont parfois s’étendre sur trois, quatre jours, que ce n’est pas rare maintenant d’avoir des procès au civil de plusieurs semaines, qu’il y a une espèce de prise de contrôle par, bon, certaines grandes compagnies, je veux dire, qui sont beaucoup plus présentes, des grandes institutions, corporations, qui fait en sorte que, bon, les délais s’ensuivent pour tous, c’est-à-dire qu’ils sont accrus pour tous.
C’est sûr qu’encore une fois je pressens que vous allez dire que les données ne sont pas très claires. Vous avez raison. D’ailleurs, le Vérificateur général a dit dans un rapport récent, en 2009-2010, que le ministère avait des efforts, de grands efforts à faire pour documenter mieux l’activité judiciaire, avoir des données fiables, je dirais, qui se comparent partout au Québec. Je pense que le ministre en est conscient puis qu’il y a un travail qui doit être en train de se faire là-dessus, on va y revenir de toute façon dans un autre exercice avec le ministre. Mais est-ce que vous voyez ce phénomène-là et que donc il y a une réponse législative qui devrait venir ou… enfin, des différents acteurs du milieu de la justice pour essayer aussi de contrer ce phénomène-là et d’essayer que l’accès soit facilité?
M. Bois (André): La dernière phase de la réforme a déjà produit des fruits, pas tous les fruits, et on devra lui donner une chance, avant d’intervenir, de les produire. Alors, pour le délai d’attente à l’instruction, le calendrier imposé par le code et imposé par les juges a amené une amélioration remarquable. Alors là, c’est la gestion, la gestion du calendrier. Et, les délais, c’est pour ça qu’on rigole chez les avocats, ils disent: On se dépêche pour attendre. C’est que, une fois que la cause est instruite, la difficulté, après ça, c’est le temps d’attente pour aller au procès. Dans l’Est du Québec, il y a eu une amélioration substantielle, mais, comme Montréal, c’est la métropole, il y a de grands litiges commerciaux, de longue durée, et la difficulté est là. Mais, dans l’Est du Québec, ce que je sais — puis Me Gobeil peut l’attester, n’est-ce pas? — …
Mme Gobeil (Andréanne): Oui.
M. Bois (André): …il y a une amélioration d’abord jusqu’à l’inscription puis dans l’attente du procès.
Maintenant, les délais d’instruction, là, le Québec… non, l’Amérique de 1960 puis l’Amérique de 2012, là, c’est plus compliqué, hein? D’abord, il y a de plus en plus de gens qui ont des activités complexes, le corpus législatif est beaucoup plus abondant. Alors, qui dit abondance de règles dit abondance de litiges possibles. Alors, moi, la durée d’instruction ne me surprend pas, et je pense que ce serait une erreur de ne pas s’interroger d’abord pourquoi c’est long. Est-ce que ce n’est pas plutôt le caractère compliqué de la preuve administrée?
Et l’autre question que vous devriez vous poser: la justice civile n’est pas seulement administrée dans les cours civiles. Êtes-vous allés voir l’arbitrage de griefs, combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend à la Régie du logement? Parce que, tout à l’heure, vous… Et je m’excuse de cette petite parenthèse là, il reste peu de temps. Il y a beaucoup de litiges qui ne se retrouvent plus en Cour supérieure ou en Cour du Québec parce qu’ils sont maintenant devant d’autres instances disponibles qui n’existaient pas avant, hein? Alors, voilà ma réponse plus ma digression.
Mme Hivon: Mais, malgré ce fait-là… Puis vous avez tout à fait raison parce qu’il y a aussi au TAQ ou tout ça, en tout cas il y a beaucoup d’instances où on voit que les délais sont très importants. Mais, malgré le fait qu’il y a une multiplication, en quelque sorte, des instances, il n’y a pas de diminution de l’activité devant nos tribunaux, on voit une complexification, on voit des délais accrus. Donc, c’est sûr qu’il y a un questionnement global, mais je pense qu’il y a des réponses qui tentent d’être apportées.
Sur la question spécifique des interrogatoires, j’imagine, parce que c’est effectivement quelque chose qui ressort constamment avec les expertises comme un frein, comme un problème, comme un potentiel d’abus — et même, pour certains, il y a de l’abus en matière d’interrogatoire, de durée, de détail, de nombre — je comprends que vous vous inscrivez plutôt en faux par rapport à ça, mais est-ce que vous avez un peu une… Vous semblez rejeter l’idée de fixer 100 000 $, bon, une limite claire. Est-ce que vous avez quand même des idées pour essayer de contenir les choses, pour essayer qu’il y ait une meilleure prévisibilité, pour essayer de restreindre les abus possibles?
**(10 h 40)**
M. Bois (André): Oui, bien la solution est déjà dans le code. Il s’agirait… Je dis ça à mes étudiants. Tout est là-dedans, dans le chapitre sur les interrogatoires, là, 396.4: «Le tribunal peut, sur demande, mettre fin à l’interrogatoire qu’il estime abusif, vexatoire ou inutile…» Alors, il incombe aux avocats, en leur âme et conscience, qu’ils disent: Il y a abus, c’est assez, on va devant le juge. Mais fixer des règles mathématiques de deux heures, c’est le sténographe qui va faire le chronomètre? Si le témoin parle aussi abondamment que je parle… Il y en a, hein? J’ai déjà interrogé des ministres, moi, M. Duhaime, dans une très grande cause, là, puis c’est long, hein? Alors, j’ai perdu mon temps parce que le ministre témoin est éloquent? Bien non, mais soyons pratiques, là. Et, après ça, s’il y a une foule d’objections, j’ai seulement à faire de l’obstruction puis je vais éteindre le deux heures de cette façon-là. C’est illusoire. Le code contient déjà le remède, mais il incombe aux avocats, pourvu qu’ils soient compétents puis qu’ils connaissent bien leur code, de demander l’intervention de la cour. C’est là.
Mme Hivon: Et… Oui?
Le Président (M. Drainville): C’est terminé, malheureusement.
Mme Hivon: O.K., c’est terminé. Bon.
Le Président (M. Drainville): Alors, on va vous remercier, Me Bois, et remercier également Me Gobeil qui vous accompagnait.
On va suspendre quelques secondes, le temps de permettre à l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes de prendre place. Merci.
(Suspension de la séance à 10 h 42)
(Reprise à 10 h 44)
Le Président (M. Drainville): Alors, nous allons reprendre nos travaux avec les représentants de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes. Est-ce que c’est Me Gagnon qui prendra la parole d’abord et qui nous présentera les personnes qui l’accompagnent?
Association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes inc. (ACCAP)
M. Gagnon (Marc): Voilà. Alors, M. le Président, M. le ministre, membres de la Commission des institutions, je me présente, Marc Gagnon. Je suis vice-président du service juridique de SSQ Groupe financier et également président du comité juridique de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes. Je suis accompagné, à ma droite, de Me Esther Houle, qui est directrice des litiges et droit du travail de Desjardins Sécurité financière; à ma gauche, Me Michel Paquet, qui est vice-président adjoint et conseiller juridique en chef de la Financière Manuvie; et, à mon extrême gauche, Me Yves Millette, qui est le vice-président principal Affaires québécoises de l’ACCAP.
Tout d’abord, l’ACCAP et ses membres vous remercient de l’invitation pour vous faire part de nos observations sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile. D’entrée de jeu, je vous dirais que, de façon générale, l’ACCAP et ses membres sont satisfaits des objectifs poursuivis dans l’avant-projet de loi. Toutefois, nous avons des réserves quant à certains changements proposés, tels que le recours aux modes privés de règlement, les seuils de compétence de la division des petites créances et la nouvelle terminologie proposée. Nous nous opposons à certains changements prévus aux interrogatoires au préalable et à la preuve par expertise. Et enfin nous vous ferons part de certaines observations quant aux dispositions en matière d’insaisissabilité.
Tout d’abord, nos réserves, et plus particulièrement quant au recours aux modes privés de règlement. L’article 1 de l’avant-projet de loi impose aux parties l’obligation de considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leurs différends avant de s’adresser aux tribunaux, toutefois l’article 7 du même avant-projet de loi prévoit que «les parties peuvent s’adresser aux tribunaux si elles ne réussissent pas à régler leur différend par [...] voie privée». Lus ensemble, ces articles portent à confusion et nous apparaissent en quelque sorte incompatibles. Nous nous interrogeons à savoir si le recours judiciaire d’une partie pourrait, à sa face même, être irrecevable si elle n’a pas d’abord tenté de régler le différend par voie privée. Je vous réfère également à l’alinéa deux de l’article 613 qui prévoit la possibilité d’une médiation alors qu’une action est déjà en cours. Nous nous interrogeons à savoir qu’est-ce qu’il en arrive des dossiers dans lesquels les avocats sont consultés à quelques jours, voire à quelques heures de la prescription du recours — et ça arrive. On s’interroge également à savoir: Qu’arrive-t-il également quand les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un médiateur?
Nous sommes d’avis qu’il faut analyser davantage l’impact de ces mesures, qui somme toute ne sont pas nécessairement, à nos yeux, plus efficaces financièrement. Le Code de procédure civile actuel et l’avant-projet de loi prévoient déjà un mécanisme de conférences de règlement à l’amiable présidées par les juges, et vous conviendrez avec moi que cette procédure s’est avérée très efficace.
Sur le seuil de compétence de la division des petites créances, l’augmentation des seuils de la petite créance ne réglera pas le problème de la division artificielle des créances en matière de réclamation d’assurance invalidité. Selon l’état actuel du droit, le versement mensuel d’une prestation d’assurance invalidité pour un mois donné constitue une créance distincte de celle du mois précédent et distincte également de celle du mois qui suit lorsqu’il s’agit d’une même période d’invalidité. En poussant la logique de la règle à l’absurde, on pourrait s’interroger à savoir si un assuré ne pourrait jamais cumuler plusieurs petites créances pour se présenter soit en Cour supérieure ou en Cour du Québec, chambre civile. Si tel était le cas, l’assureur et l’assuré seraient privés de leur droit d’être représentés par avocat, privés de leur droit d’appel et privés de leur droit d’être traités selon les règles ordinaires du livre II du Code de procédure civile.
Nous proposons de soustraire les contrats d’assurance invalidité à l’application des règles de la division des petites créances ou, à défaut, de modifier l’article 550… excusez-moi, l’article 544 afin d’ajouter les contrats à exécution successive dont les obligations éventuelles sont indéterminées ou excèdent la compétence du tribunal. Ainsi, un juge de la Cour des petites créances pourrait ordonner que la demande soit transférée devant le tribunal compétent ou instruite devant la procédure du livre II concernant les matières contentieuses.
Quant à la nouvelle terminologie, nous comprenons mal la nécessité des changements proposés. À nos yeux, cela n’apporte aucune valeur ajoutée et ne peut que rendre plus difficiles les recherches en droit.
**(10 h 50)**
Certaines dispositions qui, selon nous, ne devraient pas être retenues ou qui ne devraient pas être retenues telles que proposées. Et je vous parle de l’interrogatoire au préalable.
D’abord, la perte de contrôle de la déposition à la partie qui interroge. L’objectif d’un interrogatoire au préalable est de favoriser la divulgation de la preuve, de mieux évaluer la qualité de sa preuve, de contribuer à accélérer le déroulement du procès et, dans plusieurs cas, de favoriser un règlement à l’amiable. Nous sommes d’avis que ces objectifs ne seront plus atteints si une partie interrogée, sans l’accord de l’autre partie, peut produire la déposition au dossier de la cour.
Quant aux objections pendant l’interrogatoire, le fait que le témoin soit tenu de répondre à une question, même s’il y a objection, même si la question est inadmissible en preuve, ouvre la porte à l’abus. Un témoin pourrait se voir contraindre à divulguer des informations confidentielles et n’ayant aucune pertinence avec le dossier.
Quant au seuil prévu à l’article 223 en matière d’assurance invalidité, nous sommes d’avis que les interrogatoires au préalable devraient être permis lorsque le véritable montant en jeu ne sera connu qu’au jour du procès et qu’il est susceptible de dépasser la valeur prévue à l’article 223.
L’expertise commune. Sur le principe de l’expertise commune, nous ne nous y opposons pas, en autant que les parties puissent produire une expertise additionnelle, et ce, même si l’expertise commune est ordonnée d’office par la cour ou à la demande des parties ou l’une d’entre elles. Nous recommandons que les clauses prévues à cet effet dans le projet pilote du district judiciaire soient reproduites dans l’avant-projet de loi.
La divulgation des instructions données à l’expert. Lorsqu’il s’agit d’une expertise commune, nous n’y voyons aucun problème. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une expertise qui est retenue par une partie, nous nous y opposons. Nous sommes d’avis que le mandat confié par un avocat à un expert doit être protégé par le secret professionnel, et ce principe a été reconnu par la jurisprudence.
Quant aux restrictions aux interrogatoires de l’expert lors du procès, ces restrictions ne sont pas souhaitables et ne sont pas de nature à faire apparaître les droits des parties. Nous sommes d’avis que ces restrictions sont incompatibles avec le principe que les parties sont maîtres de leur preuve. Les rapports d’expert sont souvent, pour ne pas dire toujours très techniques et souvent difficiles à comprendre à leur seule lecture, c’est pourquoi les interrogatoires et les contre-interrogatoires sont utiles, voire même nécessaires afin de bien comprendre le contenu des rapports d’expertise.
Enfin, en terminant, quelques observations quant aux nouvelles dispositions en matière d’insaisissabilité. D’abord, la renonciation au bénéfice d’insaisissabilité. L’article 692 de l’avant-projet semble étendre l’impossibilité de renoncer à l’insaisissabilité à tous les biens insaisissables et non seulement à ceux qui sont prévus à cet article comme c’est le cas actuellement à l’article 552 du Code de procédure civile. Si notre interprétation est juste, nous sommes d’avis que cela aura pour effet d’empêcher un titulaire de police d’assurance de céder celle-ci en garantie lorsque le bénéficiaire désigné est de la catégorie des bénéficiaires privilégiés, c’est-à-dire le conjoint légal, les ascendants, les descendants et le bénéficiaire irrévocable. La désignation d’un bénéficiaire privilégié rend les droits conférés par le contrat insaisissables, et on sait qu’un bien insaisissable ne peut être hypothéqué, aux termes de l’article 2668 du Code civil du Québec, à moins de renoncer à l’insaisissabilité. Nous savons que les polices d’assurance vie et les contrats de rente émis par les assureurs font souvent partie de la planification fiscale et successorale, voient à l’atteinte de l’autonomie financière, et que l’hypothèque des droits résultant d’un contrat d’assurance sont souvent partie intégrante de cette stratégie et donnent accès au financement. Nous sommes d’avis qu’il est important de maintenir ces droits, c’est pourquoi nous recommandons le maintien actuel de l’article 552, dernier alinéa, du Code de procédure civile.
L’insaisissabilité des instruments de retraite. Nous sommes préoccupés par la nouvelle terminologie «instrument de retraite» prévue à l’article 694. Il faudrait à tout le moins définir et encadrer ces termes. Doit-on comprendre que ces termes incluent les REER et les FERR collectifs ainsi que les régimes de participation différée aux bénéfices auxquels les employeurs cotisent?
Sur l’insaisissabilité des cotisations, la Loi sur les régimes complémentaires de retraite et certaines autres lois, telle la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, rendent insaisissables les cotisations. Or, le paragraphe 7° de l’article 694 énonce le principe que toute chose déclarée insaisissable par la loi est insaisissable. Dans cette optique, nous sommes d’avis que la référence à l’insaisissabilité des régimes de retraite prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de 694 n’a pas son utilité. Si tel n’est pas le cas, il faudrait référer aux «cotisations versées par un régime complémentaire de retraite déclarées insaisissables par une loi du Québec, du Parlement fédéral ou d’une autre province ou territoire du Canada».
L’insaisissabilité du capital accumulé. Au paragraphe 5° de l’article 694, on introduit la notion de «capital accumulé pour le service d’une rente ou dans un instrument de retraite s’il y a eu aliénation du capital». Cette notion d’aliénation du capital a fait l’objet de deux jugements importants, soit l’affaire Lacroix en 2001, une décision de la Cour supérieure, ainsi que dans l’affaire Banque de la Nouvelle-Écosse contre Thibault, une décision de 2004 de la Cour suprême du Canada, et ces décisions ont eu pour effet de mettre en péril le statut de la validité de nombreux contrats et, par conséquent, l’épargne d’un grand nombre de contribuables, à tel point que le législateur québécois est intervenu à deux reprises suite à ces jugements, soit en 2002 et en 2005, afin de préserver les acquis des contrats de rente des assureurs de personnes et des sociétés de fiducie en matière d’insaisissabilité.
L’article 33.5 de la Loi sur les assurances prévoit déjà l’insaisissabilité du capital accumulé pour le service d’une rente. Le fait d’introduire la notion d’instrument de retraite dans l’article 694 aura pour effet de faire perdre un avantage aux régimes offerts par les assureurs par rapport aux produits offerts par d’autres institutions financières: ces derniers n’auraient pas besoin d’une désignation de bénéficiaire spécifique pour être insaisissables, alors qu’en matière d’assurance c’est le contraire. Nous vous recommandons donc de laisser la détermination de l’insaisissabilité des cotisations et du capital accumulé aux lois spécifiques.
À l’article 694, paragraphe 6°, nous proposons d’étendre l’insaisissabilité aux prestations versées en matière de maladie grave, de soins de longue durée et d’assurance mutilation.
Quant au calcul du revenu saisissable, on comprend de l’article 696, tel que rédigé, que les biens mentionnés à l’article 694, alinéa un, paragraphe 5° et paragraphe 6°, ainsi qu’à l’alinéa deux, premier paragraphe, deviennent saisissables lorsqu’entre les mains du débiteur, alors qu’ils étaient insaisissables lorsqu’entre les mains d’un tiers. Alors, telle que rédigée, cette disposition serait contraire aux dispositions de l’article 264, paragraphe 2°, de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, qui prévoit que les prestations de la retraite sont insaisissables en quelque main qu’elles soient. Nous suggérons à cet effet d’ajouter le mot «saisissables» après le mot «sommes» de cet article.
Le Président (M. Drainville): …moins d’une minute, s’il vous plaît.
M. Gagnon (Marc): Quant à la détermination du revenu saisissable, nous sommes d’avis que la façon de déterminer la portion saisissable du revenu du débiteur prévue à 696 est complexe et qu’il y aurait lieu de la simplifier. À titre d’exemple, il sera excessivement difficile pour un assureur de soustraire les dépenses fiscalement admissibles lors du versement des commissions aux représentants en assurance de personnes. Je vous remercie.
Le Président (M. Drainville): Merci beaucoup, maître. M. le ministre.
**(11 heures)**
M. Fournier: Merci, M. le Président. Merci à vous d’être avec nous pour nous présenter des remarques, certaines d’ordre général qu’il me semblait plus facile d’assimiler, d’autres plus techniques, et je vous annonce à l’avance que, sur certains détails techniques, j’ai déjà envoyé le message qu’on analyse si la relation entre l’avant-projet de loi et d’autres lois que vous avez mentionnées avait un effet non voulu, qu’on puisse s’en assurer, là, du meilleur libellé. Alors, je prends note des éléments sur lesquels vous êtes venus, et ça me réconforte avec l’idée qu’on ait fait un avant-projet de loi pour pouvoir vous entendre. Donc, merci d’être là.
Commençons par le début. Vous, non seulement vous vous posez la question, mais je pense que vous y répondez, sur l’obligation de considérer les moyens de règlement des différends, et vous nous dites que vous craignez que cela entraîne peut-être l’irrecevabilité du recours. Je vous entendais et je me demandais comment vous pouviez arriver à cette conclusion de crainte, parce que ce n’était pas tellement la mienne, mais, puisque vous l’avez vue, il est possible que soit, dans une des dispositions, un élément où l’obligation de considérer… que vous l’ayez vous-mêmes considéré comme pouvant entraîner la perte du recours. Alors, pouvez-nous dire qu’est-ce qui vous a amenés à croire cela?
M. Gagnon (Marc): Parce que, dans certaines situations, il est possible qu’une partie ne veuille pas du tout songer à une médiation, pour diverses raisons, et, si elle ne le considère pas, on se pose la question: Est-ce que son recours sera quand même admissible? Je veux dire, si elle avait une allégation, par exemple, dans sa procédure introductive d’instance à l’effet que je n’ai pas considéré la médiation, est-ce que ça serait irrecevable à sa face même?
M. Fournier: Est-ce que, selon vous, il y a une disposition qui la rend irrecevable? Est-ce que c’est écrit en quelque part que la conséquence, c’est l’irrecevabilité?
M. Gagnon (Marc): Non, ce n’est pas écrit. On s’interroge à savoir si ça l’est parce que l’article 1 oblige les parties à considérer.
M. Fournier: Oui, tout à fait, et cette…
M. Gagnon (Marc): Notre préoccupation, c’est: Si elle ne le considère pas, qu’est-ce qui arrive?
M. Fournier: Est-ce qu’on ne peut pas interpréter que, par exemple, les dispositions qui donnent au tribunal et au juge le rôle de favoriser la conciliation ne peut pas être le moyen de donner suite à cette considération qui n’aurait peut-être pas été complète, plutôt que l’abandon du… plutôt que la perte du recours? Autrement dit, quand vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit: Bien, si ça, ça arrive, ça se peut que le juge nous dise: Bien, regardez, on va essayer de revoir ça un petit peu, là. Vous trouvez ça trop intrusif, le fait qu’on demande aux parties de le considérer?
M. Gagnon (Marc): Non, mais la conséquence de ne pas le considérer, c’est ce qui nous inquiète.
M. Fournier: D’accord, mais je ne crois pas que la conséquence soit la perte du recours. Je ne pense pas que c’est ça qui est écrit.
M. Gagnon (Marc): Bien, on s’est posé la question et on n’a pas trouvé de réponse dans le texte de l’avant-projet.
M. Fournier: O.K. O.K., parfait. Je crois que la réponse, elle est ailleurs. Ça amène le tribunal à pouvoir jouer son rôle qui est prévu, et je ne pense pas qu’on ait écrit qu’il y avait la perte du recours dans ces cas-là.
Qu’est-ce que vous pensez de ces moyens de règlement qui sont autres que la procédure judiciaire habituelle? Votre réflexe, ça a été de me dire: On ne peut pas vraiment… Vous savez qu’on ne force pas les parties, hein, parce que, ce qui nous a été présenté, l’expérience fait en sorte que, pour que ce cheminement-là fonctionne, il faut qu’il y ait une volonté. Alors, vous, est-ce que vous trouvez que ce sont des moyens utiles?
M. Gagnon (Marc): Très utiles. Je vous dirais que, personnellement, chez nous, on pratique régulièrement ce processus de règlement à l’amiable, soit par l’intermédiaire d’un avocat-médiateur ou, comme je l’ai mentionné dans ma présentation tantôt, en conférence de règlement à l’amiable devant un juge, et je vous dirais que le taux de réussite est phénoménal.
M. Fournier: Donc, vous nous encouragez à amener les parties à le considérer.
M. Gagnon (Marc): Oui, mais il ne faudrait pas qu’on se retrouve dans une situation où les parties sont obligées, parce que, quand on va en médiation, il faut le faire de bonne foi.
M. Fournier: On se comprend là-dessus. D’ailleurs, on a eu à échanger. Il y en a certains qui sont venus nous demander… ce n’était pas si clair que ça, mais qu’on aurait pu renforcer ça un petit peu; d’autres que je qualifierais de… je ne sais pas si je dois dire «plus experts en la matière», là, je ne veux pas commencer à quantifier les expertises, mais qui nous disaient justement d’être prudents parce que ça doit reposer sur un échange de volontés. Mais en même temps il ne s’agit pas de le laisser à l’extérieur, il faut quand même amener les parties à savoir que cela existe. Et d’ailleurs plusieurs nous ont proposé de faire de la pédagogie là-dessus, d’amener les gens, de les inciter à devenir volontaires, si vous voulez. C’est une façon de le présenter.
Est-ce que vous trouvez que nous le faisons bien, qu’on devrait aller encore plus loin pour favoriser? Puisque ça fonctionne bien mais que, pour que ça fonctionne bien, il faut que les parties entrent dans la danse, est-ce qu’il y a d’autres moyens qui doivent être pris pour s’assurer qu’ils vont entrer dans la danse, justement?
M. Gagnon (Marc): Je vous dirais que tous les outils sont déjà présents. Comme je vous le mentionnais tantôt, chez nous, on le fait de… je ne dirais pas de façon systématique, mais on le fait dans neuf cas sur 10. Donc, les outils sont déjà là, il s’agit juste d’avoir la volonté de le faire. Le fait qu’on le mentionne à l’article 1, je veux dire, on n’est pas contre ça, mais en autant que ça ne devienne pas une condition pour pouvoir prendre une procédure judiciaire.
M. Fournier: En fait, c’est une condition que les parties peuvent remplir, on peut avoir une discussion. Dites-moi comment ça peut être impossible pour un avocat de dire à son client: Il y a aussi ce type de moyen là, voici ce que ça implique. Qu’ils l’analysent et qu’ils échangent là-dessus, est-ce que ça, c’est trop?
M. Gagnon (Marc): Non.
M. Fournier: D’accord. Mais…
M. Gagnon (Marc): Mais, si ça ne se fait pas — c’est là qu’est notre inquiétude — si ça ne se faisait pas, c’est quoi, la conséquence de ne pas le faire?
M. Fournier: …que les avocats, dans leur code de déontologie, dans… C’est quoi, c’est l’avocat de 2021, là, dont on parle un peu, là. Est-ce qu’il devrait avoir cette responsabilité de dire à ses clients quels sont les différents moyens qui existent et qu’il n’y a pas juste la voie judiciaire, que ce moyen-là est un moyen… De toute façon, à vous écouter c’est performant. Alors, est-ce qu’il ne devrait pas y avoir une obligation de le considérer ne serait-ce que dans l’ordre déontologique?
M. Gagnon (Marc): Encore une fois, je suis d’accord avec le principe, je n’ai rien contre. Au contraire, je suis tout pour. Mais ma préoccupation, c’est: Si je ne le fais pas, c’est quoi, la conséquence? Puis je n’ai pas trouvé la réponse.
M. Fournier: O.K. Bien, moi, je la cherche un peu, parce qu’on le trouve sous la voie de la conciliation que le juge a le mandat de faire, on peut le retrouver dans l’ordre déontologique. Parce que, franchement, si on n’en parle pas, comment les gens peuvent le faire?
Alors, je trouve juste… Moi, ça m’offense juste un petit peu de dire: C’est une bonne idée, mais on n’est pas obligés d’en parler. Alors, c’est juste ça qui… Il faut trouver le moyen, tu sais, comprenez-vous? Si c’est bon pour vous puis il faut que les gens le sachent pour embarquer, il faut bien trouver un moyen pour que ça se fasse. C’est juste ça, là.
M. Gagnon (Marc): Tout à fait, tout à fait.
M. Fournier: D’accord. Revenons à la Cour des petites créances. Au-delà de la juridiction, qui est augmentée, là, mais au-delà de ça, sur le cumul des créances, qu’est-ce que le Code de procédure change à la vie de tous les jours, d’aujourd’hui dans vos cas à vous, là?
M. Gagnon (Marc): L’avant-projet de loi, rien, mais on profite de l’occasion pour…
M. Fournier: Ah! D’accord, c’est une occasion. D’accord, d’accord, d’accord. Mais, considérant que la façon dont on l’envisage, la Cour des petites créances, c’est aussi en pensant à ceux qui sont plus les individus à qui ça peut arriver une fois dans leur vie — dans le cadre de votre regroupement, disons que c’est plus «business as usual» d’avoir des litiges, hein, c’est même le propre de ce que vous faites — lorsqu’on se met dans les souliers de l’individu, est-ce que ce n’est pas bon de lui donner des moyens comme cela? Est-ce que cela n’explique pas justement pourquoi la règle était celle-ci? Et, quand vous nous proposez de la changer, qu’en est-il de l’intérêt du justiciable?
Mme Houle (Esther): Si vous me permettez, M. le ministre, pour la question des Petites Créances, évidemment, si on hausse dans un premier temps à 10 000 $, par la suite à 15 000 $, en matière d’assurance invalidité — je vais vous donner un exemple — quelqu’un peut demander des prestations d’invalidité et prétendre être invalide jusqu’à 65 ans, donc, évidemment, bon, qui divise un premier trois mois et, par le suite, un premier trois mois et… bon, pour faire différentes créances qui seraient inférieures à 15 000 $, bien, évidemment, vous avez un dossier dont la valeur en litige n’est pas véritablement inférieure à 15 000 $. Donc, évidemment, dans ces dossiers-là, le juge aura à déterminer si la personne répond à la définition d’invalidité, et, lorsque les sommes en litige sont plus élevées, vous aurez compris que, dans bien des cas, bien, soit l’assureur ou même le juge d’office va demander au médecin traitant d’être présent.
Donc, à votre question: Est-ce qu’il peut y avoir un… J’allais dire «un déficit», ce n’est pas le bon mot, là. Mais est-ce que celui qui intente sa poursuite, l’assuré, peut être brimé? Bien, évidemment, peut-être qu’il aurait préféré avoir eu l’aide ou l’apport d’un avocat pour interroger son médecin, préparer son médecin et si ce n’est qu’avoir accès, que son médecin se présente, parce que, dans la réalité, je vous dirais, ça nous est arrivé aux Petites Créances, évidemment, nous, on n’est pas présents, mais que le juge reporte trois fois parce que le médecin traitant, malgré le subpoena, ne s’est pas présenté parce qu’il préférait être auprès de ses patients. C’est correct, mais évidemment le contribuable n’a pas eu le médecin traitant pour pouvoir lui permettre d’avancer dans sa cause, qui, dans certains cas, la somme en litige n’est pas véritablement inférieure à 15 000 $.
Donc, oui, il peut y avoir, dans certains cas, un effet pervers, je vous dirais, de mettre ça sur le dos de l’accessibilité de la justice, alors que peut-être tant le contribuable que l’assureur auraient pu permettre au juge d’avoir un tableau plus complet de la situation. Donc, c’est pour ça qu’on vous dit: Est-ce que, dans certains cas, dans ces cas-là où la somme en litige, en quelque sorte, elle devient indéterminée… Parce qu’effectivement on rajoute plusieurs mois, et la personne se prétend invalide souvent jusqu’à 65 ans. Des fois, la valeur en litige, ça excède les 200 000 $, là, dans certains cas, là. Donc, dans ces cas-là, peut-être qu’il y aurait… Nous, ce qu’on croit, c’est que, dans ces cas-là, on devrait avoir la possibilité que ce soit devant la Cour supérieure ou que la personne puisse bénéficier, là, des services d’un avocat. Donc, c’est ces dossiers-là pour lesquels on croit qu’il devrait y avoir une justification. Pour les dossiers où quelqu’un a une période déterminée inférieure à 15 000 $, trois mois, 7 000 $, 8 000 $, on comprend, là, on pense qu’effectivement la mesure peut être justifiée, là.
**(11 h 10)**
M. Fournier: Dites-moi pourquoi je…
Le Président (M. Drainville): …M. le ministre.
M. Fournier: Ah! C’était tellement intéressant. Peut-être tantôt.
Le Président (M. Drainville): Oui, mais à moins que la députée de Joliette…
Mme Hivon: …
Le Président (M. Drainville): Vous allez aller sur le même sujet?
Mme Hivon: Oui.
Le Président (M. Drainville): Mais est-ce que vous consentez à ce que le ministre…
Mme Hivon: Non, bien, je vais y aller, puis peut-être que si…
Le Président (M. Drainville): Oui, très bien. Alors, M. le ministre, la députée de Joliette va prendre le relais.
Mme Hivon: Oui, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à mon tour.
Pour rester sur ce sujet-là, je comprends que l’état actuel des choses versus le projet ne change rien, l’avant-projet. Moi, je veux simplement comprendre, à l’heure actuelle, comment on détermine, devant quelle cour on va aller si le montant de l’indemnité est indéterminable.
Mme Houle (Esther): La personne fait sa demande aux Petites Créances et indique, par exemple: Bon, moi, on me doit trois mois d’indemnités, additionne ses trois mois d’indemnités, elle fait sa demande pour cette période-là. Et, par la suite, elle peut refaire une autre demande, si elle se prétend toujours invalide, pour un autre trois mois, et, dans certains cas, bien les causes vont être entendues ensemble, pour une bonne gestion et administration de la justice on va mettre les sommes ensemble, mais, pour la période de trois mois, c’est déterminé. Donc, effectivement, si c’est inférieur actuellement à 7 000 $, ça va aller dans la division des petites créances. Là, je vous parle juste de prestations d’invalidité, là. Si c’est effectivement de 7 000 $ à 30 000 $, ça va aller à la Cour du Québec.
Mme Hivon: Parfois, ça va aller à la Cour supérieure, donc, dépendamment…
Mme Houle (Esther): Bien, il y a des cas… C’est ça, il faut faire attention. Là, on est en prestations d’assurance invalidité, donc c’est des montants déterminés, ça va être déterminé uniquement en fonction du montant. Si, évidemment, il y a des cas qui sont de façon déclaratoire, bien ça va aller plus dans la juridiction… dépendamment des motifs de refus, là. Par exemple, l’annulation d’un contrat d’assurance, c’est la Cour supérieure. Mais on ne rentrera pas… ce n’est pas pertinent pour…
Mme Hivon: O.K. Mais généralement c’est en Cour des petites créances, à cause des montants qui sont en jeu et du fait qu’on doit y aller créance par créance, donc période par période.
Mme Houle (Esther): Je vous dirais, en matière d’assurance invalidité, ce n’est pas, généralement, aux Petites Créances parce que, malheureusement, dans bien des cas, l’assuré a un délai de prescription de trois ans pour intenter son recours, et, dans la majorité des cas, les actions ne sont pas intentées les deux, trois mois qui suivent l’interruption des paiements mais bien deux ans et deux ans et trois quarts, là. Donc, les montants, je ne peux pas vous dire que c’est généralement aux Petites Créances, mais il y a un volume quand même.
Mme Hivon: O.K., merci. Pour revenir au premier élément dont vous discutez, donc cette obligation qui est faite de considérer le recours aux modes de justice privés, donc vous, vous le prenez… C’est intéressant. Vous, vous dites: Il n’y a rien d’écrit comme conséquence si une partie ne se conforme pas à cette obligation-là, donc est-ce que ça pourrait aller jusqu’à faire en sorte que son recours soit irrecevable devant les tribunaux par la suite? D’autres sont venus nous dire: Bien, en fait, vu qu’il n’y a rien d’écrit, ça veut dire qu’il n’y a aucune conséquence, ça veut dire que franchement l’obligation n’est pas très contraignante, donc qu’est-ce qui nous assure que les parties vont s’y conformer?
Mais je comprends par ailleurs que vous êtes à l’aise avec ce libellé-là — mais vous me corrigerez si je rêve — que vous estimez que c’est une bonne idée de favoriser le recours aux modes de justice privés, qu’on pourrait inscrire une telle obligation. Mais est-ce que de votre logique on doit déduire qu’il devrait y avoir, je dirais, un carcan un petit peu plus contraignant pour s’assurer que l’obligation a été respectée, sans dire qu’on va dire que la demande va être irrecevable, mais est-ce qu’il devrait y avoir une mesure qui fasse en sorte qu’on s’assure que cette obligation-là de considérer a été remplie?
M. Millette (Yves): Je pense que le problème de fond et la raison pour laquelle on dit: On ne devrait pas faire faire le recours aux consommateurs, c’est qu’il y a une réticence du justiciable à aller… à avoir une décision qui ne serait pas une décision d’un vrai juge. Je pense que globalement c’est le cas, on l’a vécu. Nous, on s’intéresse beaucoup à toutes ces questions-là parce qu’on a beaucoup de réclamations, et ce serait utile d’avoir un plus grand recours, comme on disait, à des mécanismes, y compris les Petites Créances, là, à différents mécanismes judiciaires pour régler les problèmes, mais on comprend qu’il y a une réticence de la part des consommateurs, surtout dans notre domaine, qui est complexe.
Juste pour revenir à la question des Petites Créances, s’il y a une prescription de trois ans, comme une invalidité peut durer pendant 25, 30 ans, il est possible que même après trois ans on ne connaisse pas le montant en cause. Donc, à ce moment-là, pour que le consommateur, que le justiciable soit vraiment indemnisé, bien je pense qu’on doit être très souple sur les mécanismes qui vont faire en sorte que le consommateur, si on revient à la Cour des petites créances, puisse être représenté par avocat présentement, par exemple, parce que le consommateur n’aura peut-être pas conscience, en allant devant le tribunal, en demandant trois mois d’indemnisation, qu’il en perd peut-être 25 ans. Je pense que c’est ces choses-là qu’on dit que vous devez faire un mécanisme qui fait en sorte que le consommateur va pouvoir avoir pleine justice, même si au départ le consommateur va vouloir avoir une décision d’un juge parce qu’il pense que c’est la façon de faire. Je pense que, dans les deux cas, c’est la perception qu’on a.
Mme Hivon: Pour la question des indemnités, par exemple quand on est en assurance invalidité, je pense que vous avez bien fait de porter ça à notre attention parce que c’est vrai que c’est une logique qui est un peu différente, donc les Petites Créances sont appelées à jouer un rôle mais qui n’est pas leur rôle habituel, compte tenu que ça s’échelonne dans le temps.
Mais vraiment, pour la question… C’est parce que c’est vraiment, je pense, quelque chose d’important qui envoie un signal dès le début, là, de l’avant-projet. Sur l’obligation de considérer, certains nous disent: Ce n’est pas assez, parce qu’une obligation de considérer, s’il n’y a aucun incitatif, s’il n’y a aucune conséquence, comment, les parties, on va savoir qu’elles s’en sont acquittées, finalement? Donc, moi, je vous dis: Plutôt que de prendre ça… Le ministre vous a dit: Il n’y en a pas, de conséquence comme celle que vous appréhendez, que le recours soit irrecevable, mais, moi, je vous repose la question. Les gens ne vous… En tout cas, je suis de l’école qui ne veut certainement pas enlever minimalement cette référence-là. Si on veut vraiment donner une impulsion, on se questionne à savoir s’il ne faudrait pas aller plutôt plus loin. Moi, je vous dis: Plutôt qu’une sanction, s’il y avait des incitatifs, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une voie intéressante, comme par exemple, s’il y a eu recours ou s’il y a eu considération en bonne et due forme, qu’il puisse y avoir des incitatifs pour, par exemple, ne pas avoir à tout refaire, s’il y a eu médiation, de ne pas arriver au même stade que quelqu’un qui commence son recours? C’est des pistes que certains nous ont amenées, une espèce de — excusez-moi l’anglicisme, là — «fast track» si des choses ont pu être faites par mode privé de règlement des conflits.
Mme Houle (Esther): Ce qui nous fatigue, évidemment, c’est la jonction de l’article 1 et 7, qui nous donnait l’impression que les parties devaient, avant de s’adresser à la cour, obligatoirement avoir fait cette démarche-là. Moi, je suis de l’école que je pense que ça fait partie, évidemment, du devoir de l’avocat. Quand on reçoit son dossier, bien on a plusieurs alternatives, ou bien on va à procès ou… mais on peut effectivement arriver à un règlement. Bon, tu sais, peut-être que c’est moi qui ai une… mais ma perception, c’était ça. Si vous gardez les dispositions telles qu’elles sont là, c’est sûr que ça prend un encadrement beaucoup plus serré, parce qu’évidemment, bon, je prends… Nous, on représente des assureurs, on est habitués d’avoir des requêtes en dommages. Si je n’ai pas considéré le recours, est-ce qu’au bout de la ligne le dossier se règle? Est-ce qu’on va me faire une poursuite en dommages en disant que je n’ai pas respecté l’esprit du code qui était de vouloir… de me forcer un petit peu à la médiation? Oui, je suis peut-être à l’extrême, vous avez raison, peut-être que j’ai une déformation avec ce type de recours là, mais, si on les garde tels quels, moi, je crois qu’effectivement ça prend un encadrement beaucoup plus serré à savoir c’est quoi, ces mécanismes-là. Est-ce qu’appeler mon beau-frère d’appeler le directeur du contentieux pour savoir si on peut régler mon dossier, c’est une façon d’essayer de régler le dossier?
Là, oui, je caricature, mais c’est juste pour que vous compreniez que, si on laisse ça tel quel… Moi, je crois que ça prend un encadrement beaucoup plus serré pour nous permettre de pouvoir l’exercer de façon correcte, parce que, dans l’état, tel qu’il est là, je ne vois pas de différence un peu, outre le «doivent», là, que vous nous dites que ce n’est pas une obligation, avec la situation actuelle où on semble favoriser.
**(11 h 20)**
Mme Hivon: Bien, ne vous excusez pas, parce que, je pense, c’est une question fort légitime, c’est-à-dire: à partir du moment où il y a quelque chose qui semble être de la nature d’une obligation, en tout cas minimalement, comme juristes on a la déformation de se demander c’est quoi, la conséquence, si on ne rencontre pas l’obligation.
Par ailleurs, vous dites que l’article 541, donc, sur la juridiction inhérente… en fait, sur le 15 000 $ sur les Petites Créances, que ça «porte atteinte à la juridiction inhérente de la Cour supérieure». Vous affirmez bel et bien ça. Vous…
M. Gagnon (Marc): Ce que je dis, c’est une interrogation qu’on se fait, c’est: Est-ce que la Cour supérieure, de la façon que les articles… Puis, de mémoire, je pense que ça n’a jamais été amené en cour, mais, quand on a lu ça, on s’est interrogés puis on s’est dit: Est-ce que quelqu’un qui cumule ses prestations ou sa réclamation de prestations d’invalidité mensuelles pour attendre d’être à un niveau soit de la juridiction de la Cour du Québec, chambre civile, ou de la Cour supérieure, alors que le code prévoit au chapitre de la Cour des petites créances le mécanisme pour une petite créance… Donc, on s’est posé la question: À l’inverse, est-ce que ça ne ferait pas perdre à quelque part la juridiction des deux autres tribunaux?
Le Président (M. Drainville): Et on va s’arrêter là, Mme la députée de Joliette. M. le ministre.
M. Fournier: Oui. Bien, peut-être juste… Je vais revenir tantôt, là, sur ce que je voulais dire sur la Cour des petites créances, mais, simplement pour essayer de se comprendre dans les concepts, il y a une obligation de considérer. Ce n’est pas: Il n’y a pas d’obligation de considérer. Il y a une obligation de le considérer. La sanction à l’effet que vous proposez ne me semble pas présente dans le code, je ne sais pas s’il ne faudrait pas y penser. Quelles sont les sanctions qu’on doit faire à l’obligation de considérer?
Il faut faire attention parce que vous avez étiré un peu, «considérer», c’était qu’on me force à le faire. Non. «Considérer», ce n’est pas forcer d’entrer dans le processus, parce qu’on veut que le processus de règlement des différends soit volontaire. «Considérer», c’est soupeser, envisager, proposer à son client, se dire qu’il y a d’autres mécanismes.
À cette étape-ci de l’évolution de notre droit, c’est une étape qu’il semble être obligé de faire parce que tous n’en sont pas conscients, de cette possibilité de passer par là. Personnellement, je crois que «built-in» dans le système… Enfin, je peux comprendre que quelqu’un pourrait dire au juge: Moi, je ne l’ai pas considéré, moi, je m’en fous pas mal, de l’obligation de le considérer, bon, si tant est que quelqu’un le ferait, puis je ne sais pas ce que ça ferait dans l’ordre déontologique. Vous dites que ce n’est pas comme ça que vous, vous le faites, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne cherche pas du côté des sanctions déontologiques, bien que ça puisse vouloir dire quelque chose. Mais «built-in» dans le système il y a le juge qui dit: Bien, si toi, tu ne l’as pas fait, moi, je vais le faire. Moi, je vais voir, on va considérer ensemble. Votre client, il va le savoir, que ça existe. Il pourrait, il a un rôle de favoriser la conciliation. Ça pourrait très certainement ouvrir cela.
Mais je laisse ça en suspens pour dire que la seule conclusion que m’amène votre présentation n’est pas d’affaiblir l’obligation mais de m’assurer qu’il soit bien compris qu’elle existe. Alors, peut-être que vous me proposez d’être encore plus précis sur les conséquences, on va réfléchir à cela, mais il est bien évident que ça ne sera pas un pas en arrière pour dire: Considérer, c’est trop. Ça, c’est sûr que ça ne sera pas le choix qui sera fait, d’autant que je suis intéressé un peu par ce que vous avez dit: Le justiciable veut une… il est réticent à ne pas avoir la décision d’un vrai juge. Puis d’ailleurs tantôt vous m’avez dit que vous réglez 90 % de vos cas sans… à moins que j’aie mal compris.
M. Gagnon (Marc): Ce que je dis, c’est que — permettez-moi l’expression anglaise, là — la personne veut «his day in court», et souvent, son «day in court», ça se fait par une conférence de règlement à l’amiable. Et c’est là que je prenais le…
Une voix: …
M. Gagnon (Marc): Devant le juge, oui, voilà. Alors, même s’il n’y a pas eu de procès, il n’y a pas eu enquête et audition au mérite, le justiciable a rencontré le juge, il a fait valoir ses doléances, et voilà.
M. Fournier: Par contre, vous n’êtes… Alors donc, je comprends donc que, lorsque vous me parliez des règlements, c’était plus par le biais de la conférence devant un juge que la procédure des modes privés de règlement des différends. À cet égard-là, y a-t-il une pratique que vous avez chez vous… ou pas du tout parce que les gens veulent leur journée en cour?
M. Gagnon (Marc): Il arrive souvent, au cours d’un dossier judiciarisé, qu’on envisage la conférence de règlement à l’amiable, mais, pour une raison d’horaire, on ne trouve pas de juge. Alors, on propose à l’avocat adverse d’aller en médiation devant un avocat, et je peux vous dire que ça arrive régulièrement que la réponse est non parce que le client veut un juge.
M. Fournier: Donc, pour vous, ce n’est pas une mécanique dans laquelle vous êtes habitués parce que le justiciable, lui, il ne le souhaite pas. Vous, vous le souhaiteriez, mais le justiciable ne le souhaite pas.
M. Gagnon (Marc): …ça arrive régulièrement.
M. Fournier: Mais vous, de façon générale, vous êtes très ouverts à ça.
M. Gagnon (Marc): Ah, absolument.
M. Fournier: Et, s’il y avait, par exemple, un délai, si, avant l’introduction de l’instance, il y avait un avis qui était donné: J’entends prendre une procédure, est-ce que, si on changeait les règles… Certains proposent de donner un avis qui favorise le règlement des différends avant la judiciarisation, avant la cristallisation du conflit encore de façon plus ferme. Est-ce que vous trouveriez que ce serait là une solution intéressante?
Le Président (M. Drainville): Et ce sera l’occasion de conclure également cet échange, Me Gagnon… ou Me Houle.
Mme Houle (Esther): Effectivement, ça serait une solution qui pourrait être intéressante parce que, comme on disait tout à l’heure, dans les dossiers d’assurance invalidité principalement, il y a d’énormes délais souvent. Donc, ça nous permettrait, avec l’autre partie, tout de suite, un, de mettre à jour le dossier — parce que souvent on est trois ans plus tard, donc, l’individu, sa condition a sûrement évolué — et effectivement d’entamer peut-être un processus qui ne débouchera pas sur le litige.
Donc, nous, on n’est pas réfractaires. Évidemment, ça prend toujours les deux parties, c’est des dossiers qui sont souvent très émotifs, donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération. Mais, à votre question, non, je ne pense pas que… on n’est pas réfractaires à cette solution-là. Il y autant de coûts, dans ces dossiers-là, pour les assureurs que pour les contribuables… les assurés, plutôt.
Le Président (M. Drainville): Merci. Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon: Oui. En fait, sur la question des modes de règlement, des modes privés, en fait, vous soulevez quelque chose d’intéressant qui est quand on lit en conjonction l’article où il y a l’obligation de considérer avec l’article 7, puis je comprends que c’est ça que vous faites comme exercice, puis effectivement moi aussi, je voudrais attirer l’attention du ministre là-dessus, parce que le libellé de l’article 7 peut laisser entendre que c’est plus qu’une simple obligation de considérer, puisqu’on dit: «Les parties peuvent s’adresser aux tribunaux si elles ne réussissent pas à régler leur différend par la voie privée…» Donc, ne pas réussir à régler son différend par la voie privée, est-ce que c’est simplement de ne pas y avoir réussi, de ne pas avoir réussi parce qu’on l’a considéré puis on l’a tout de suite écarté? Mais c’est sûr que l’utilisation des termes peut laisser entendre qu’il va falloir y avoir eu recours. Enfin, je pense que vous soulevez une question fort pertinente, puis il va falloir peut-être, avec les libellés, éclairer ça.
Je voudrais vous amener sur la question de l’expertise commune donc qui, dans la première semaine de nos consultations, a déjà fait beaucoup parler d’elle. Je comprends de ce que vous écrivez que vous ne vous opposez pas, donc, à l’idée de l’expertise commune. Vous faites d’ailleurs référence au projet pilote qui a eu cours à Laval, donc vous proposez la possibilité d’avoir recours à une expertise additionnelle selon les modalités qui s’apparentent à celles du projet pilote. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est rédigé dans l’article, tel qu’il est rédigé en ce moment, ça donne cette latitude-là… ou il y a un questionnement qui perdure?
**(11 h 30)**
Mme Houle (Esther): Tel qu’il est rédigé là, on n’a pas cette latitude-là, selon nous, là. Selon le libellé, tel qu’il est proposé, on ne croit pas qu’on a la possibilité de pouvoir obtenir une expertise additionnelle quand le choix a été fait sur l’expertise unique.
Évidemment, sur le principe de l’expertise unique, on ne s’y oppose pas, parce qu’évidemment on est conscients que tant la magistrature… Actuellement, on nous le propose dans chaque dossier. Évidemment, ça ne veut pas dire qu’on considère qu’elle est appropriée dans tous les dossiers, parce qu’évidemment dans bien des cas il y a déjà une expertise en demande lorsqu’on est saisi du dossier, donc c’est plus… et il y a des dossiers qui sont plus complexes et qu’il y a des divergences d’opinions, mais actuellement notre crainte est surtout, bon, sur la question de ne pas pouvoir obtenir notre propre expertise s’il y a des éléments qui n’ont peut-être pas été pris en considération par l’expert ou une tendance scientifique qui n’a pas été prise. Dans les dossiers plus complexes, ça nous semble un peu problématique, parce qu’on pourrait arriver à une situation où il faudrait même engager notre propre expert pour faire la lettre-mandat, évidemment, pour savoir quelles questions on doit poser à notre propre expert pour avoir, là, le tableau complet.
Et tout à l’heure j’entendais Me Bois parler de la fatigue chronique. Bien, évidemment, s’il y a deux tendances scientifiques… deux divergences scientifiques, excusez, sur le sujet, si on n’a pas consulté notre propre expert sur ce sujet-là, bien ça va être difficile pour nous, là, de connaître cette autre divergence d’opinions là.
Ça fait que c’est pour ça que je vous dis, oui, on n’est pas contre le principe. Évidemment, malheureusement, il y a des cas où ça ne s’appliquera pas.
Mais on a beaucoup de réserves, évidemment, sur toute la question du rapport écrit. Ça, c’est un autre sujet.
Mme Hivon: Oui, ça, c’est un autre volet, parce qu’en fait il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant, bon: On est contre l’idée même puis le renvoi à la règle de proportionnalité pour qu’il puisse l’ordonner, comment ça va être fait, puis tout ça. Donc, ils nous disent: Il faut que ça soit complètement volontaire. Donc, comme l’état actuel, si les deux parties consentent, il y aura une expertise commune.
Je dois vous dire qu’après avoir entendu les gens qui sont venus plaider pour ça je me demande bien dans quel cas il y a une expertise commune de manière volontaire, tellement les gens avaient l’air de trouver que c’était quelque chose qui était à peu près inacceptable dans leur pratique, bien que les pratiques entre les différentes personnes qu’on a entendues étaient assez différentes. Vous, je comprends que votre logique est un petit peu différente, vous dites formellement: L’idée que le juge puisse ordonner l’expertise commune, on n’est pas contre, mais on veut avoir a posteriori la latitude d’avoir une expertise additionnelle si le travail de l’expertise commune, les conclusions, tout ça, on estime qu’il doit y avoir une contre-expertise.
M. Gagnon (Marc): J’écoutais Me Bois tantôt, quand il a parlé de fibromyalgie, où un expert ne reconnaît pas la maladie, donc ne reconnaîtra pas l’invalidité qui suit, et ça, c’est un risque. Si on devait se retrouver dans une situation où un juge ordonne l’expertise commune et qu’il n’y a pas, permettez-moi l’expression, de «backup» pour avoir une expertise additionnelle, bien on peut se retrouver dans une situation difficile, comme Me Bois vous a décrit tantôt.
Mme Hivon: Mais est-ce que, pour vous, ça fait en sorte qu’il faut complètement rayer de la disposition l’idée que le juge puisse ordonner une expertise commune ou on garde ça mais en venant… — parce que je vois un peu ce que vous suggérez, mais je veux le clarifier — on garde le libellé mais en venant prévoir qu’après, une fois que cette expertise commune là est déposée, il devrait y avoir la faculté que, pour des raisons définies, on puisse demander qu’il y ait une expertise supplémentaire?
Une voix: …
Mme Hivon: C’est ça?
M. Gagnon (Marc): C’est notre position, oui.
Mme Hivon: Puis dans la logique des choses, évidemment, les coûts, l’expertise qui vient par la suite, qu’elle vienne après ou qu’il y en ait deux au départ, ça ne change rien, c’est-à-dire que ça n’économise rien pour la partie, j’imagine.
M. Gagnon (Marc): Effectivement.
Le Président (M. Drainville): C’est terminé, malheureusement, Mme la députée de Joliette. Alors, on remercie les représentants de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes.
Et on va prendre un petit moment pour permettre à l’Observatoire du droit à la justice de l’Université de Montréal de prendre place. Merci.
(Suspension de la séance à 11 h 33)
(Reprise à 11 h 36)
Le Président (M. Drainville): Alors, nous allons reprendre nos travaux sans plus tarder avec les représentants de l’Observatoire du droit à la justice de l’Université de Montréal. J’imagine que c’est M. Noreau qui prendra la parole et qui nous présentera les personnes qui l’accompagnent. Allez-y, monsieur.
Observatoire du droit à la justice (ODJ)
M. Noreau (Pierre): Merci. Alors, Pierre Noreau, président de l’Observatoire du droit à la justice. Je vais vous présenter Huguette St-Louis, membre de l’observatoire, ancienne juge en chef de la Cour du Québec, et puis Marie-Claude Sarrazin, également membre de l’observatoire, engagée dans beaucoup d’autres choses aussi mais particulièrement dans les questions d’accès à la justice qui, dans le fond, sont au fond de ce que nous, on essaie de… ce sur quoi on réfléchit. L’observatoire, c’est un regroupement à la fois de chercheurs et de praticiens, on essaie ensemble d’explorer les voies qui permettent de développer un plus grand accès à la justice. Quand on réussit à s’entendre, les chercheurs d’un côté puis les praticiens de l’autre, bien on dit: On doit être sur quelque chose qui a une chance de fonctionner.
Je vous remercie d’abord de nous recevoir. J’ai toujours dit que c’était un privilège pour les citoyens de pouvoir participer au travail législatif, d’une certaine façon, en rencontrant les députés, et je trouve que c’est encore le privilège qu’on a aujourd’hui, puis je veux vous remercier de nous accueillir.
Le mémoire qu’on a déposé — puis je vais le présenter le plus courtement possible pour qu’on puisse échanger — il est centré sur deux axes, en fait. On a eu cette préoccupation-là, d’abord, de placer le justiciable au milieu de notre réflexion à nous, c’est un peu l’objectif qu’on poursuit dans cet observatoire, et on le fait d’autant plus que ça n’a pas toujours été le cas des réformes antérieures. Souvent, lorsqu’on réforme surtout les aspects les plus techniques de la procédure civile, c’est pour régler les problèmes de la pratique, qui sont souvent les problèmes des praticiens, finalement, ou de l’administration de la justice au sens le plus technique du terme, et on a voulu, nous, reconsidérer ça dans une perspective plutôt visant à répondre aux besoins du justiciable. Puis un autre axe aussi, c’est de considérer la justice pas uniquement comme la grande institution politique ou en tous cas publique que les sociétés se sont donnée, mais également comme un service public, comme une institution au service de ceux qui y recourent comme ça doit être le cas également en matière de santé, d’éducation, que ce n’est pas seulement une grande institution abstraite, que l’État de droit n’est pas une abstraction, c’est la réalité organisée, institutionnelle dans laquelle nous vivons et à laquelle on doit avoir accès.
Et donc ce sont ces deux angles-là qui ont orienté notre réflexion, et on a volontairement limité, nous, notre présentation et notre mémoire à trois éléments sur lesquels on pensait avoir quelque chose à ajouter, et c’est là-dessus que ça va porter principalement: d’abord sur la question du recours à des moyens alternatifs, non contentieux, préventifs — appelez-les comme vous voulez — donc de donner l’accès à des modes de règlement des conflits, des litiges, des différends qui ne mobilisent pas nécessairement le système judiciaire et qui peuvent même être envisagés avant le début d’une procédure; le deuxième élément sur lequel porte le mémoire, c’est sur la gestion d’instance, puisqu’on a développé une expertise sur cette question-là dans le cadre du projet pilote qui a été mené à Longueuil sur cette question de gestion d’instance; et finalement sur la question de la nécessité du suivi empirique de la réforme. Et là j’en parlerai un peu plus tout à l’heure.
**(11 h 40)**
Notre objectif dans tout ça, nous, ça a été de rendre opérationnels les principes qu’on trouve inscrits dans le code, c’est-à-dire qu’il y a un certain nombre d’obligations nouvelles qui sont définies et qui vont dans le sens de ce que nous, on pense nécessaire de faire aujourd’hui dans l’institution judiciaire, et pour l’institution judiciaire, et, par extension, pour les citoyens, mais on considérait qu’il faut peut-être rendre ça plus opératoire, c’est-à-dire que ces obligations-là doivent pouvoir s’exprimer dans un cadre minimum qui les met en action, sinon ça va rester des principes plus théoriques. On voulait dépasser ce risque-là.
Alors, on commencerait peut-être, si vous voulez, par parler de ces modes alternatifs qui sont prévus. C’est l’article 1, le troisième alinéa de l’article 1 qui prévoit l’obligation de considérer le recours possible à d’autres modes de gestion des différends, à la conciliation, en fait, pour l’essentiel, et cette orientation-là, nous, on l’appuie fortement.
Je vais rappeler peut-être quelque chose qui est un peu plus personnel. Il y a 20 ans, j’étais ici, dans le salon rouge, devant la Commission des institutions, pour plaider la cause du besoin, pour l’institution judiciaire, de recourir à ces modes-là alternatifs de gestion des différends, et je me rappelle, à l’époque le ministre m’avait dit: Merci, Me Noreau, merci de nous faire rêver, ce qui était évidemment une façon polie de dire qu’on était des rêveurs. Et, quand je vois aujourd’hui, dans l’article 1, cette référence-là à d’autres modes de gestion des conflits dans le Code de procédure civile, je me dis qu’on est devenus… on est très nombreux maintenant à être des rêveurs et je trouve que c’est une orientation qu’il faut appuyer. La question, pour nous, c’était de savoir comment on rend ça… dans quel cadre on rend ça… comment on incite, finalement, les praticiens à le faire, et ça, c’est éclairé par les expériences antérieures.
Moi, j’ai beaucoup pratiqué en matière familiale. À l’époque, dans la Loi du divorce, en 1985, il y avait eu une modification de la loi qui nous obligeait à informer les gens qui se divorçaient de l’existence, en tout cas, des services de médiation, et à l’époque, d’abord, il n’y en avait pratiquement pas, de service de médiation. Moi, je pratiquais dans un village, on ne savait même pas qu’est-ce que c’était. Et puis évidemment on ne se sentait pas tellement liés par ça, même si la loi nous obligeait à en parler.
Et je pense que, si on veut dépasser… Et donc ça a été très long, en fait, avant que la médiation familiale prenne son envol, très largement parce qu’il n’y avait que cette obligation-là d’informer et il n’y avait pas d’autre cadre qui suscitait l’action des procureurs, des avocats, et conséquemment on s’est dit: Si on veut éviter cette situation-là, peut-être qu’il faut créer un cadre qui les oblige, qui oblige le praticien à faire autre chose que ce qu’il fait d’habitude, et c’est cette idée-là d’un préavis d’exercice, d’une éventuelle demande, là, introductive d’instance et l’obligation qui est faite à l’avocat qui veut poursuivre ou à la partie qui veut poursuivre, 60 jours à l’avance, d’indiquer qu’on a 60 jours, vous et nous, pour envisager les conditions d’un recours ou en tout cas la possibilité d’un recours à d’autres modes de gestion des différends que le procès, à la conciliation judiciaire, et qu’en ouvrant cette porte-là, cette fenêtre-là sur le plan procédural on les oblige, les parties, à en parler réellement, pas seulement à envisager de le faire mais de discuter sérieusement la possibilité de le faire. Et, si jamais ils y arrivent, eh bien, il y a de bonnes chances qu’ils réussissent à régler leurs problèmes de cette façon-là, parce que les taux de succès de ces pratiques-là sont extrêmement élevés, et, les expériences qui ont été tentées, les études là-dessus au plan international arrivent toujours à peu près au même résultat. Mais, s’ils n’y parviennent pas, bien ils ont par la suite l’obligation d’émettre une attestation qui établit qu’ils l’ont évalué comme possibilité, que même ils l’ont tenté et que finalement ils en viennent à la conclusion qu’ils doivent procéder par la procédure habituelle.
Donc, cette idée-là de préavis, le fait de se donner 60 jours pour s’obliger à le voir, c’est un moyen terme, je dirais, entre la médiation en tant que c’est une idée possible et puis la médiation obligatoire comme on la trouve dans certains pays. J’ai voyagé au Pérou, il existe une obligation claire d’envisager la médiation et même de tenter une médiation avant d’aller à procès. Et donc, entre les deux, il y a cette possibilité-là, et ça nous apparaît un moyen terme qui ne rend pas nécessairement la médiation, la conciliation obligatoire mais au moins qui oblige plus sérieusement de l’envisager, pour ne pas que ça devienne juste une étape de plus à travers la séquence judiciaire, d’avoir eu à y penser, mais de s’être obligé peut-être à l’envisager sérieusement.
La deuxième proposition qu’on fait pour rendre ça concret et aussi pour éviter le problème dont je viens de parler en matière familiale dans les années 80, alors qu’on aurait peut-être voulu, nous, en référer à la médiation familiale, mais il n’y avait pas de médiateur, c’est qu’on reconnaisse telle chose que des médiateurs en matière civile, un corps de médiateurs, un corps public, en fait, ou un corps de médiateurs civils accrédités comme pour la médiation familiale, hein? Ça permet de s’assurer de la formation de ceux qui exercent comme médiateurs et ça permet de savoir à quelle porte on peut frapper lorsqu’on a besoin d’un médiateur, particulièrement dans cette période de 60 jours où on demande aux parties de l’envisager.
Autour de ça, il y a un paquet d’autres dispositions concernant la prescription, etc., vous avez les détails dans le mémoire. Mais ce qui est important, c’est de voir que c’est possible.
Tout à l’heure, il y a eu cette question que vous avez posée, de savoir: Est-ce que c’est si vrai que les gens veulent forcément avoir leur journée à la cour, hein? C’est une question qu’on a posée en 1993 déjà dans un sondage et qui révélait que 86 % — et là ça fait 20 ans, là — 86 % des citoyens interrogés considéraient qu’ils préféreraient plutôt passer par une négociation à l’amiable, pour régler leurs conflits, que de passer par le procès. Le procès n’a ramassé que 1,7 % d’adhésion chez les répondants. C’est important de le savoir, ça. Les gens ne veulent pas nécessairement rencontrer le juge, ils veulent régler leurs problèmes, ils veulent qu’on les aide à régler leurs problèmes, et je pense que la disposition qui propose qu’on recoure à ces modes alternatifs avant d’envisager toute autre possibilité et le cadre dans lequel nous, on le situe favoriseraient qu’on y recoure effectivement concrètement, à l’avantage des justiciables. À l’avantage des justiciables mais, j’ajouterais peut-être, à l’avantage même de l’activité juridique elle-même, c’est-à-dire qu’évidemment ça nécessite de la part des praticiens de réfléchir à leur pratique dans d’autres termes, mais pourquoi pas? Actuellement, beaucoup de jeunes avocats ne réussissent pas à gagner leur vie, ne réussissent pas à lancer leur carrière comme avocats parce qu’ils n’ont pas de client, et, si on change de façon importante la façon de voir l’activité juridique, bien sans doute qu’en fait, en même temps qu’on servira les intérêts du justiciable, bien on permettra peut-être à la profession d’avocat de s’enrichir, d’avocat ou de notaire, parce qu’il n’y a rien qui empêcherait que ces médiateurs-là puissent venir d’une autre profession, en fait.
Le deuxième élément, c’est la reconnaissance, dans le projet de loi, de la plus grande latitude qu’on donne aux juges dans la gestion d’instance. C’est une mesure qui a été expérimentée dans le cadre d’un projet pilote qui s’est mené à Longueuil en 2009, sur l’ensemble de l’année 2009, et qui a largement révélé son efficacité.
Elle vient également en contradiction avec une idée souvent reçue. Longtemps, on a cru que les gens, finalement, réussissent à régler au fur et à mesure de l’instance parce qu’à la fin il y en a un des deux qui s’épuise et qui accepte de régler, les clients ne sont pas mûrs… ou les justiciables, les citoyens ne sont pas mûrs pour régler au début, ce qui est tout à fait faux. L’expérience qui a été menée à Longueuil, qui faisait intervenir un juge très rapidement au début de la trajectoire judiciaire, révèle la très grande disposition des parties à régler dès le début, et donc on ne peut plus fonctionner comme s’il y a uniquement l’épuisement des parties qui les amenait tranquillement à finir par devenir conciliants. On peut toujours trouver des cas d’exception à ça, mais, en général, ce n’est pas le cas. Il y a une très grande ouverture au règlement dès le départ, il faut utiliser ça.
Le projet de Longueuil, il a été, par la suite, continué à Longueuil parce que les avocats du district de Longueuil l’ont demandé. Il a été repris dans le district de Gatineau, il a été repris dans le district du Saguenay, et, indépendamment des résultats — qui étaient assez favorables — de l’étude qu’on a menée, nous, pour évaluer l’efficacité de cette pratique-là, le grand succès de cette opération, c’est qu’elle a été reprise par d’autres districts. C’est la véritable mesure de la fonctionnalité, en fait, de cette pratique.
Alors, la seule chose… Bon, cette idée-là, elle est reprise généralement dans le cadre du projet de loi mais dans une tout autre perspective, parce qu’on dit: Le juge devrait intervenir après que, sur une période de 45 jours, les parties auront pris le temps d’établir un protocole d’instance, que le juge évaluera après ça pour s’assurer, finalement, que la règle de proportionnalité, par exemple, est assurée, que la bonne conduite de l’instance est assurée. Ce n’est pas la conclusion qu’on peut tirer du projet pilote de Longueuil. Pour une fois qu’on a un projet pilote, pour une fois qu’on a une expérience qui est tentée et qui est mesurée dans notre système judiciaire, je pense qu’il faudrait tirer toutes les conclusions de cette expérience-là qui révèle que le juge peut intervenir dès la comparution de la partie défenderesse. Dans beaucoup de cas, c’est rendu possible par le fait que, même après la comparution, il y a toujours la possibilité d’une défense orale. Ça n’enlève de droit à personne et c’est cette intervention rapide qui a fait l’efficacité de l’expérience de Longueuil et qui est reprise ailleurs. Et donc d’attendre 45 jours, avec tout ce que ça implique aussi, hein, parce qu’il faut aller voir qu’est-ce qui se dépense aussi pendant ces 45 jours là pour le justiciable, je pense que c’est d’arriver trop tard, en fait, dans le processus judiciaire, dans la trajectoire, alors qu’on peut intervenir beaucoup plus tôt et que l’efficacité de cette intervention tôt là, elle a été révélée. Et donc je trouve qu’on perd, dans la proposition qui est faite, beaucoup des avantages qu’on a tirés de l’expérience de Longueuil et qu’il faut plutôt peut-être envisager cette intervention beaucoup plus rapide — et puis on pourra en reparler peut-être tout à l’heure — donc revenir, finalement, aux principes qui ont fondé l’expérience de Longueuil.
C’est une expérience très empirique, hein, parce qu’au départ on y a pensé, à la façon de le faire, mais on a discuté, après ça, avec les juges, avec le Barreau de Longueuil. On a établi une façon très fonctionnelle de le faire, et donc ça peut être envisagé, je pense, dans d’autres districts.
**(11 h 50)**
Le Président (M. Drainville): Il vous reste à peu près une minute pour conclure.
M. Noreau (Pierre): Peut-être que 30 secondes, ça sera suffisant.
Le dernier élément du mémoire, c’est sur la nécessité de suivre cette réforme de façon empirique comme on l’a fait pour le projet de Longueuil. Toutes les réformes antérieures ont rarement fait l’objet d’un suivi systématique, de sorte qu’à la fin on ne sait plus bien ou on découvre, un peu catastrophés, que telle réforme, que telle norme de pratique qu’on avait changée n’a pas donné du tout les résultats qu’on s’attendait, et on s’en rend compte souvent assez tard, une fois que d’autres habitudes ont été prises et ne peuvent plus être changées. C’est le cas, par exemple, du délai de 180 jours de la réforme antérieure, qui a conduit à une culture des délais qui est complètement différente de ce qu’on s’attendait à voir naître, et je pense que, si on veut éviter ça, il faut à tout prix qu’on suive les expériences tentées en vertu du nouveau Code de procédure civile. Il faut les suivre pied par pied jusqu’à ce qu’on puisse savoir à quelle condition ça fonctionne et de quelle façon on ajuste.
Le système judiciaire est le système le moins étudié qui soit au Québec, c’est dénoncé chaque année par le Vérificateur général. Il n’y a aucune statistique judiciaire fiable dans le système juridique actuellement, au Québec.
Un projet de loi a été adopté en 1992 qui établissait la nécessité… ou en tout cas qui proposait et qui même faisait adopter le principe d’un institut québécois de la réforme du droit. Cette loi n’a pas été sanctionnée, et puis on aurait besoin en fait aujourd’hui de cet institut, ne serait-ce que parce que le suivi de cette nouvelle réforme, qui est ambitieuse et qu’on appuie très largement, mérite en fait qu’on le fasse, qu’on l’assure, ce suivi, et qu’on puisse en tirer toutes les conditions et toutes les conclusions pour l’avenir. Merci.
Le Président (M. Drainville): Merci. M. le ministre.
M. Fournier: Oui, merci beaucoup. Bien, merci à vous d’être avec nous. J’ai eu l’occasion de prendre connaissance des différentes propositions que vous aviez, d’échanger déjà, et vous savez tout le respect que j’ai pour votre observatoire et pour le travail que vous y faites, puis, dans le cadre du travail qu’on fait aujourd’hui, il est essentiel. Alors, merci beaucoup d’être là.
Commençons peut-être de reprendre là où on en était juste avec le groupe qui précédait, sur jusqu’où va-t-on quand on veut forcer les parties non pas à conclure par un mode privé de règlement des différends, mais à lui donner sa chance ou… Et ce n’est même pas ce qu’on fait. On ne lui donne même pas sa chance, on fait juste dire: On vous donne l’obligation de l’envisager. Ça se peut que vous ayez… On ne pourra pas vraiment vérifier si vous l’avez envisagé sérieusement, mais… Puis je comprends. Puis je reviendrai tantôt sur les propositions que vous avez, qui sont à la même essence, là, je ne disconviens pas, qui sont des moyens qui nous permettent d’aller un peu plus loin dans l’opérationalisation, mais franchement, si dès le départ je me fais dire comme je me suis fait dire tantôt, si, moi, je ne veux pas, bien on va remplir 45 papiers, on va laisser le temps passer puis… Bon.
Selon vous, outre la mécanique que vous nous proposez — j’y reviendrai tantôt — y a-t-il vraiment quelque chose qu’on peut imaginer? Parce que, même dans cette mécanique-là… À part la déontologie, mais même là.
M. Noreau (Pierre): …évidemment, il y a toute la question de la formation des avocats eux-mêmes, hein, et puis toute la question du Code de déontologie des avocats qui peut éventuellement être amendé de manière à susciter cette obligation-là ou à leur faire réfléchir à la nécessité de l’envisager. Il n’y a rien de pire à changer, dans la vie, que les habitudes, hein? Souvent, on dit: Ah! Ça prend un changement de culture. Non, non, c’est les habitudes qui sont difficiles à changer, parce qu’on peut facilement changer de discours sans changer de pratique, et le système judiciaire, c’est l’exemple type de ça.
Et donc il faut y aller de plusieurs façons. Je pense que le fait que… Si on définissait l’intervention du juge, la gestion d’instance dans la perspective où on la propose, nous, là, c’est-à-dire qu’immédiatement après la comparution le juge intervient, ça donnerait l’occasion et ça créerait aussi une obligation supplémentaire de voir si vraiment sérieusement on ne pourrait pas en arriver à une entente avant, parce que le juge, c’est ce que normalement il doit être amené à faire. Il doit être amené à demander aux parties de réenvisager la possibilité de régler immédiatement, les envoyer en conférence de règlement à l’amiable, si c’est possible, et de ne pas attendre trop avant de le faire.
La plupart des dossiers, mettons, du rapport… Dans le rapport de Longueuil, c’est très intéressant, la plupart des dossiers sont réglés à l’intérieur de 77 jours. Alors, évidemment, on est loin du 180 jours, là, on est 110 jours avant le 180 jours. Ça prouve quand même l’efficacité de cette pratique-là.
Donc, si on intervient en séquence beaucoup plus rapidement, on accentue, en fait, l’obligation pour les procureurs de l’envisager sérieusement, parce que tôt ou tard ils se retrouvent devant un juge qui, lui, va voir si, par le biais de la gestion de l’instance, il ne peut pas y parvenir, sinon par le biais de la CRA il ne peut pas y parvenir. Comprenez-vous? Et, moi, je pense que ces éléments-là sont des éléments qui créent un autre cadre de réflexion pour le procureur. Ils sont obligés d’y penser plus sérieusement, ça arrête d’être théorique.
M. Fournier: Avant d’embarquer dans le hâtif et le tardif, parce que vous nous parlez du hâtif, on nous a aussi présenté qu’il vaudrait mieux le faire plus tardivement que c’est proposé. On y reviendra tantôt. Vous nous dites, autant pour Longueuil… mais encore une fois c’est même d’autre chose dans le cas de Longueuil, on est plus dans un processus judiciaire où on veut favoriser le règlement, on prend les moyens, mais vous dites que, par rapport à ce qui nous a été présenté tantôt, «a day in court» ou le règlement… Enfin, les gens, moi, je partage un peu le point de vue qu’ils ne veulent juste pas avoir de problème. Alors, si on en a un, on veut le régler, je crois, mais… Puis vous avez fait référence à un sondage.
Comment se fait-il que, si c’est le cas, le citoyen lui-même ne pousse pas son avocat à embarquer là-dedans? Là, je comprends qu’on n’est pas là, là, mais j’essaie de trouver comment est-ce qu’on peut amener le monde à choisir cette méthode-là. On force les avocats à en parler avec les parties, alors qu’est-ce qu’il manque dans notre société pour que les parties soient conscientes que leurs avocats devraient leur en parler presque ou… Tu sais, prenons-le à l’envers, là. S’ils veulent vraiment régler… Je vais voir mon avocat. Est-ce que la première question, ce n’est pas: Je pense que j’ai un problème puis j’aimerais ça le régler sans aller voir le juge, peux-tu m’aider?
M. Noreau (Pierre): Oui. Moi, si je mets mon chapeau de sociologue, là, j’enlève mon chapeau d’avocat, je mets mon chapeau de sociologue, je dirais que le rapport entre le justiciable, le client, le citoyen et son avocat n’est pas très différent du type de rapport qu’un citoyen entretient avec son médecin ou entretient avec un autre professionnel, c’est-à-dire qu’on est dans l’opacité. Ils ne savent pas toutes les options qui s’offrent, donc ça devient compliqué pour eux de les offrir. Dans le domaine médical, c’est assez vrai, là, on le vit assez régulièrement lorsqu’on a des parents plus âgés ou qu’on se fait offrir des possibilités alors qu’il y en aurait eu d’autres qui auraient pu être envisagées, mais on ne les connaît pas. On s’en rend compte après coup.
Je pense que la solution à ça, c’est carrément l’information publique. On est dus, je pense, pour une campagne publique, une campagne communicationnelle claire sur qu’est-ce que ça signifie, d’aller à la cour, puis de quelle façon on peut l’éviter. Tant qu’on n’aura pas ce support-là, on ne pourra pas supposer que le justiciable, par lui-même, il a spontanément une connaissance des alternatives qui s’offrent et, tant qu’on n’aura pas ça, on n’y arrivera pas.
En droit, ça n’existe pas. Déjà dans le domaine médical, les gens, je ne sais pas si vous le savez, mais ils fouillent sur l’Internet, hein, et puis ils trouvent un paquet de questions à poser qui… Ils sont beaucoup… Ça achale un peu les médecins, mais ils arrivent beaucoup mieux informés sur ce que ça pourrait… Est-ce qu’il n’y a pas une alternative à ce médicament-là, à cet effet-là? Est-ce que ça ne pourrait pas en être un autre? Ça change beaucoup la donne des relations entre les avocats et leurs clients… entre les médecins et leurs clients. On n’a pas le même équivalent de ça, hein, dans le domaine de la justice, et donc c’est clair que le justiciable, qui souvent a des problèmes qui, pour lui, sont insurmontables, est dans une situation de grande dépendance par rapport au professionnel, et là il y a une réflexion à mener aussi sur le rôle du professionnel.
Mme St-Louis (Huguette): Sauf en matière familiale, où les gens vont sur l’Internet puis ils voient que la médiation familiale est possible. Et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de justiciables qui ont recours à la médiation familiale parce que ça, c’est connu, mais, de fait, au niveau civil c’est moins connu, et en plus les gens, quand ils vont sur l’Internet pour voir, ils arrivent avec des questions sur… ils arrivent avec le code, là, c’est le code qu’ils vont consulter, mais le code ne leur donne pas comme référence d’aller en médiation.
Alors, je pense qu’effectivement la proposition qu’on fait de leur donner du temps pour en discuter puis obliger les avocats à discuter de ça, bien, ça serait déjà une porte ouverte. Puis, s’il y avait un corps de médiateurs payés par l’État… Et il ne faut pas penser que ça veut dire que ça coûterait plus cher, parce que plus les conflits vont se régler, moins il y aura besoin de juges puis moins on aura besoin, peut-être, de l’appareil judiciaire. Alors, un dans l’autre, je pense qu’il faut le regarder d’une façon pratique aussi, ça, mais en médiation familiale ça a bien fonctionné. À l’époque, à la division des petites créances, quand il y avait ce qu’on appelait, nous, les médiatrices du gouvernement, là, qui étaient dans le palais de justice puis qui recevaient les gens, il y avait un haut taux de succès, et ça a légèrement… ça a diminué, ça s’est dilué quand on a eu recours à des médiateurs privés, qui étaient pourtant payés par l’État mais qui étaient un peu partout dans la ville et qui étaient, je dirais, peut-être de qualité inégale. Alors, je pense que les mesures qu’on suggère ici permettraient probablement aux gens de commencer à regarder comment ils peuvent régler leurs dossiers.
D’ailleurs, beaucoup de personnes n’y vont même pas, voir l’avocat, parce qu’ils ont peur. Il y a des gens qui se disent: On n’est pas pour mettre le pied là, parce que, si on met le pied, la jambe va y passer, et il y a toute cette crainte-là des gens de s’adresser aux avocats puis au système judiciaire.
**(12 heures)**
Mme Sarrazin (Marie-Claude): Peut-être que ça a l’air simpliste aussi, de parler de la formation des avocats, mais il faut se replacer dans la perspective où, quand on est consultés comme praticiens, c’est que l’individu ou le dirigeant de la corporation est arrivé au bout des solutions possibles au problème qu’il vit, puis là, bien, quand tu vas voir un avocat, tu as deux choix: soit tu te fais proposer d’aller à la guerre et de saisir le système judiciaire ou ton avocat est en mesure de te proposer une panoplie de solutions possibles à ton problème.
Donc, la créativité chez l’avocat, ça se cultive dès la formation, puis toutes les solutions possibles, comme elles ne sont pas documentées, puis les cas de succès de médiation à l’amiable et autres ne sont pas étudiés, documentés, on ne peut pas nécessairement enseigner à l’université aux avocats puis faire de la formation continue à ce sujet-là. Mais, quand quelqu’un se blesse, par exemple, puis n’a même pas les moyens de… je donne un exemple, là, mais de se transporter à son lieu de traitement, bien il ne veut pas recevoir le remboursement de son transport à son lieu de traitement cinq, 10 ans plus tard, mais, si on lui propose dès maintenant de convenir une entente intérimaire ou de convenir dès maintenant d’un expert commun pour évaluer la perte de revenus, etc. Donc, la réponse à votre question, c’est: Comment, par ailleurs, cultive-t-on la créativité chez les praticiens et chez les juges pour aider les justiciables à envisager d’autres solutions possibles à leurs problèmes?
M. Fournier: Profitons du fait qu’il y a des gens du monde universitaire juste vraiment même pas 30 secondes. Qu’en est-il de la formation actuelle, là? Parce qu’il me semble bien qu’il y a une ouverture à ça maintenant, non?
M. Noreau (Pierre): …efforts très importants faits dans certaines universités par rapport à d’autres, comme à Sherbrooke, par exemple, il y a un très fort travail qui est fait dans ce sens-là puis qui est très, très… qui est très utile, mais on ne peut pas considérer que c’est vraiment le cas partout. Dans beaucoup de cas, c’est des formations plus parallèles, et ils en entendent parler beaucoup plus tard. C’est difficile de faire changer le type de formation qu’il y a dans les facultés parce qu’on suit le profil indicatif du Barreau très largement, qui lui est centré sur une certaine conception de la profession.
Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui changent actuellement au Barreau. Je suis parfois étonné de ce que j’entends et assez ravi de ce que j’entends du côté du Barreau. En tout cas, il y a une période, je dirais, actuellement, où il faut constater que le discours est en train de basculer, et peut-être que ça amènera justement à avoir des profils indicatifs au niveau de la formation qui sont différents, et là on intégrera ces considérations-là, surtout qu’aujourd’hui il y a seulement 15 %, hein, des avocats qui vivent du litige. Alors, le 85 % qui reste, ils font quoi? Bien, ils travaillent comme directeurs de caisse populaire, ils travaillent dans un petit contentieux, ils travaillent pour un ministère ou pour un autre, ils travaillent comme gestionnaires responsables des ressources humaines, ils font un paquet de choses qui n’ont rien à voir, en fait, avec la pratique traditionnelle du droit. Et ça, je pense qu’il faut qu’on apprenne, dans les facultés, à les former à ça, à leur annoncer ça, à leur faire voir ça dès le départ.
On est dans une société de droit. Il y en a qui disent qu’il y a trop d’avocats. Bien, non, mais on est dans une société de droit, on a besoin de juristes, mais il faut qu’on comprenne qu’est-ce que fait aujourd’hui un juriste. On va faire servir tous ces beaux cerveaux-là à mieux que ce qu’on fait actuellement en leur laissant croire que la pratique du droit, c’est le litige.
Le Président (M. Drainville): C’est très bien, merci beaucoup pour cet échange. Mme la députée de Joliette.
Mme Hivon: Bonjour. Alors, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue. Très heureuse de vous avoir parmi nous. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre mémoire, et, vous le soulignez vous-mêmes, le système judiciaire et, je dirais, de justice au complet est un système qui est très peu étudié, il y a peu de données fiables, le Vérificateur général s’en plaint systématiquement. Je pense que le ministère réfléchit à des manières d’avoir des données plus fiables sur toute l’activité judiciaire, et c’est fondamental. Puis, dans un contexte comme ça, votre travail est d’autant plus important, parce que vous êtes à peu près les seuls à faire une évaluation un peu puis d’amener un regard un peu critique sur ce qui se fait. Donc, merci beaucoup. Je pense que votre réflexion est au coeur du sujet qu’on aborde aujourd’hui, bien sûr, donc votre présence est très précieuse.
Moi, je veux vous entendre… J’ai plein de questions, là, je n’y arriverai pas, c’est sûr, mais je veux vous entendre d’abord, je vous dirais, pour ce qui est de l’article 1, de l’obligation de considérer, cette fameuse obligation de considérer le recours aux modes de justice privés. Il y a évidemment comment on donne des dents à cette obligation-là. Donc, vous arrivez avec la suggestion du préavis et de l’attestation. Je veux vous entendre sur: S’il n’y a pas d’avocat dans le décor, il n’y en a pas, là, donc la personne ne veut même pas, un peu dans le cas que vous disiez, Mme St-Louis, aller voir un avocat, comment ces formalités-là vont pouvoir être remplies, dans le sens où, bien sûr, elles seraient prévues dans un code de procédure civile, et donc plus on est en amont, plus peut-être c’est difficile de formaliser? Moi, personnellement, je trouve qu’il y a un intérêt à considérer ça, parce que je l’ai mentionné tantôt, mais j’ai beaucoup de réserves à avoir une obligation de considérer avec rien qui… Donc, est-ce que ça va rester voeu pieux? Ça, ça serait le premier élément.
Et, s’il n’y a pas quelque chose qui vient l’encadrer plus formellement, est-ce que vous pensez que l’obligation devrait être rédigée différemment? En fait, est-ce que, pour vous, c’est une condition sine qua non qu’il y ait un encadrement plus formel d’obligation pour qu’elle ait vraiment toute sa vigueur, je dirais?
Mme Sarrazin (Marie-Claude): Bien, si on finit… Je commence par où vous avez terminé, là. Le préavis comme tel, ça s’adresse beaucoup au praticien pour l’aider à changer sa façon de concevoir la préparation et le règlement d’un différend, l’annonce de l’existence du différend et son règlement. Quand on parle du justiciable qui déciderait de faire la démarche seul, je pense que votre intervention met en lumière l’importance d’avoir un corps de médiateurs accrédités disponibles aux justiciables comme c’est le cas en médiation familiale, parce qu’en médiation familiale, effectivement, souvent les gens qui se séparent… puis je ne connais pas les statistiques, là, j’y vais un peu d’expérience personnelle à droite, à gauche, mais en viennent à ne même plus passer par l’avocat, ils vont directement aux services de médiation, puis ça se parle, ça se fait du bouche à oreille en consultation, sur le site Internet, etc., puis ils atterrissent dans le bureau d’un médiateur accrédité qui est soit avocat soit psychologue, bref, peu importe la… voyons, la profession à laquelle il appartient. Ils font leur médiation, et le médiateur, lui, a la formation et les capacités de finaliser, si on veut, l’aspect procédural de l’entente, qu’il consignera, ou pourra référer le justiciable à un avocat si jamais l’ex-couple n’arrive plus à s’entendre. Ça fait que c’est certain que ça prend une certaine façon, mais, dépendamment de quel contexte, on a des solutions différentes.
Mme Hivon: O.K. Sur le fait… Est-ce que l’obligation de considérer doit absolument être encadrée pour qu’elle ait vraiment une force?
M. Noreau (Pierre): Très certainement.
Mme Hivon: Bon, c’est clair.
M. Noreau (Pierre): Très certainement. Sur les questions de médiation, il y a eu des débats importants là-dessus. Il y en a qui vont loin, qui vont jusqu’à rendre la médiation obligatoire. On a donné l’exemple du Pérou, mais ce n’est pas le seul. Dans l’État de Californie, en matière familiale, la médiation est obligatoire.
Bon, moi, je n’ai jamais promu l’idée d’une obligation, parce qu’évidemment il faut quand même que les parties soient d’accord pour la faire, mais je suis obligé de reconnaître — et là c’est plutôt le scientifique qui parle — que, même dans des cas dans les juridictions où la médiation est obligatoire, les taux de succès sont très, très élevés. Alors, j’indique ça pas parce que j’en fais moi-même la promotion, parce qu’il y a quelque chose qui, pour moi, sur le plan de la théorie de tout ça me dérange un peu, de dire: Vous allez vous asseoir puis vous allez vous entendre, même si je sais qu’en matière de relations de travail il y a pas mal de médiateurs puis de conciliateurs qui réussissent à régler les problèmes de cette façon-là. Donc, moi, j’ai une certaine… je suis réticent à ça, mais je suis obligé de constater que, dans les États où c’est obligatoire, ça fonctionne très, très bien. Alors, on n’ira pas jusqu’à le proposer ici, mais il faut quand même le savoir, et donc, moi, ça ne me dérange pas tellement que l’incitation soit plus importante que moins, sans aller jusqu’à rendre ça obligatoire. Pourquoi? Parce que ce n’est pas parce qu’il y a une incitation que ça rend ça inefficace. La démonstration est plutôt faite qu’en général les gens tentent d’arriver à une entente et y arrivent.
Sur la question de la représentation, la personne qui se représente seule, c’est vrai que la solution réside dans le fait qu’un professionnel, un médiateur est là, reçoit les parties, et puis c’est sa fonction de créer l’équilibre nécessaire entre… comme le juge qui est en conférence de règlement à l’amiable, hein? Il y a des cas où les gens ne sont pas toujours représentés par avocat, c’est le travail du juge, à ce moment-là, de le faire, et c’est ce que le médiateur ou le conciliateur doit faire également si ça vient… si cette opération-là est menée avant la judiciarisation.
**(12 h 10)**
Mme Hivon: Je veux vous entendre sur la question des incitatifs, vous n’en avez pas parlé dans vos remarques introductives, dans votre présentation, mais les incitatifs formels, soit de manière fiscale, d’avoir recours à ces modes alternatifs. Vous parlez aussi de la remise des frais judiciaires en cas de règlement. Moi, c’est des approches que je trouve séduisantes pour inciter encore plus, mais plusieurs sont venus nous dire, la semaine dernière, qu’en même temps, la médiation, si on veut qu’elle reste ce qu’elle doit être — et ils s’inscrivent un peu dans la logique de ne pas aller vers quelque chose d’obligatoire — si en fait on met des incitatifs puis un peu plus de pression pour que les gens aillent vers la médiation, est-ce que ça peut être contre-productif puis que, dans le fond, les gens le fassent un peu comme une formalité, mais que, dans les faits, il y ait moins, nécessairement, de conditions préalables qui optimiseraient les chances de succès mais qu’ils le fassent plus… Par exemple, certains disaient qu’ils pourraient rentrer dans le système peut-être plus rapidement, ne pas avoir à refaire toutes les étapes, si jamais… Est-ce que les incitatifs peuvent nuire ou bien si vous n’y voyez que des avantages?
M. Noreau (Pierre): Non, moi, je pense qu’on prend toujours des décisions dans un certain cadre de contraintes, hein, il y en a pour n’importe quel choix qu’on doit faire dans la vie, on travaille… il n’y a jamais de situation où on est totalement libres de prendre une décision, il y a toujours des éléments qui nous obligent à considérer où on est par rapport… Et un système de contraintes, ce n’est pas quelque chose d’aberrant, dans la vie, ce n’est pas quelque chose… et, conséquemment, qu’il y ait des incitatifs, moi, je ne vois pas de problème.
Est-ce que ça peut devenir… Est-ce qu’il peut y avoir des effets inattendus à l’imposition d’une contrainte ou d’une autre? C’est possible. C’est pour ça qu’il faut étudier le processus, c’est pour ça qu’il faut regarder comment ça évolue. C’est à ce moment-là qu’on peut corriger. Et, si on considère qu’il y a des effets inattendus à une contrainte qu’on met parce qu’elle crée, elle incite, elle oblige de réfléchir ou d’agir d’une certaine façon, on la corrigera, mais au moins on sera en mesure de savoir et de mesurer qu’est-ce qui a un effet positif et qu’est-ce qui a un effet inhibiteur puis on sera en mesure de mesurer les effets imprévisibles et peut-être, dans certains cas, non souhaités d’une certaine contrainte. Mais évidemment, pour ça, il faut faire le suivi de ce qu’on impose comme réforme.
Le Président (M. Drainville): On va reporter la minute qu’il reste, Mme la députée de Joliette, sur votre prochain bloc. M. le ministre.
M. Fournier: Oui. Pour le plus grand bonheur de notre président de commission, parlons Longueuil un peu. Et on a eu des présentations sur, je le disais tantôt, la gestion hâtive et tardive. Pour la gestion tardive, on nous dit à peu près ceci: Lorsque les gens en savent plus, ont plus fait le tour de toutes les considérations, ils sont plus en mesure d’arriver à avoir une certaine forme de règlement. Je crois que c’était ce matin, là, qu’on nous a prétendu que, dans le fond, c’est une perte de temps, un juge qui ne connaît pas la situation au départ, il n’a pas toutes les informations, ce n’est pas en 30 minutes qu’il va pouvoir régler ce que l’avocat a déjà tout préparé, puis il vient s’immiscer dans le dossier.
Ceci étant, entre gestion hâtive et tardive, le projet de loi ouvre la porte à la hâtive et la fixe plutôt entre les deux, et je vous entends bien me dire: Ramenez donc ça au plus hâtif possible, je l’entends. Parlez-moi de Longueuil, parlez-moi de la façon dont ça se passait, comment on peut répondre à l’argument que, même là où nous, on le met de façon générale, ça n’a aucun rapport parce que les parties ne sont pas prêtes. Et là je comprends tout le débat entre cristalliser le conflit, qui est peut-être encore plus difficile à défaire… Quand c’est plus jello, c’est différent que lorsque c’est pris dans le ciment, là, alors je peux bien comprendre. Mais comment ça se… Parlez-moi de Longueuil comme tel pour que je puisse bien voir les différences.
M. Noreau (Pierre): À Longueuil, c’est intéressant — puis Huguette, peut-être, complétera — ça s’est fait très simplement parce qu’on a utilisé une nouvelle technologie, dans le système judiciaire, qu’on appelle le téléphone, et beaucoup de l’intervention du juge a été fondée sur l’audioconférence, dans le fond, qui était peu utilisée jusque-là dans la pratique quotidienne, surtout que le juge attendait que le dossier finisse par arriver sur sa table, atterrisse sur sa table avant de réagir, et les choses sont avantageuses lorsqu’on le traite au départ parce que les parties le traitent dans les termes dans lesquels ils le vivent, alors que plus on attend, plus on redéfinit la situation en fonction de la… on requalifie la situation à partir des catégories juridiques, et c’est là que ça devient incompréhensible pour le justiciable, quand il se rend compte que ce n’est pas un chien, c’est un bien meuble, ou etc. Tu sais, à un moment donné, il y a une redéfinition totale de la situation dans des termes que le justiciable ne comprend plus du tout, de sorte que, si jamais il fait un gain à la fin, ce n’est jamais pour la raison qu’il croit et puis ce n’est pas toujours le gain qu’il croit non plus. L’avantage d’intervenir au départ, c’est qu’on est au fondement de ce qu’est le problème lui-même, tel qu’il est vécu par les gens qui le vivent. Et, s’ils n’arrivent pas à le régler à ce niveau-là, on pourra toujours passer à la deuxième abstraction, puis la troisième, puis la quatrième, puis à la fin ça se réglera sur le plan procédural. Puis, dans bien des cas, c’est comme ça que ça se règle plutôt qu’au plan du fond où, épuisés, on finit par céder parce qu’on n’a plus d’argent à donner à son propre procureur.
Et, conséquemment, le fait d’attendre présente beaucoup d’inconvénients. D’abord, ça augmente considérablement les coûts. Plus on attend… C’est d’autant plus le cas que la plupart des paiements d’honoraires sont faits… bien c’est des honoraires à l’heure, donc les avocats sont payés à l’heure. Plus on prend de temps, plus l’avocat va investir, désinvestir, réinvestir dans le dossier, plus les coûts augmentent, et finalement on en vient aussi à une situation aussi assez paradoxale où l’intérêt du praticien vient s’opposer à l’intérêt du justiciable, parce que plus on passe de temps, plus le praticien gagne sa vie puis moins le justiciable est capable de suivre, jusqu’à ce que finalement il cède à une entente qu’il ne peut pas faire autrement que d’accepter parce qu’il est au bout de ses ressources. Alors, c’est ça, le risque d’attendre trop. Et puis l’avantage d’attendre peu, c’est de donner au justiciable la possibilité de régler ça dans les termes où il comprend, lui, la situation.
L’expérience de Longueuil, c’est une expérience qui est très empirique. Comme j’ai dit, on avait une idée, on a travaillé sur un cadre général, une convention a été signée entre la Cour du Québec et le Barreau. C’est un élément essentiel de tout projet pilote, il faut que le barreau régional ou le barreau du district où on le fait soit d’accord, embarque là-dedans. D’ailleurs, à la fin, justement, comme je disais, c’est les avocats qui ont demandé que ça se poursuive à Longueuil. Et puis ça se faisait de façon très pratique, à coups de téléphone, et tous les dossiers qui ont été passés ont bénéficié de ça. Il y a des dossiers qui se sont réglés. Il y a au moins 50 % des dossiers qui se sont réglés par cette voie-là ou en passant par la conférence de règlement à l’amiable, parce que ça devenait aussi une voie d’entrée vers la conférence de règlement à l’amiable. Ça, c’est un avantage qu’on n’avait pas envisagé a priori. Puis tous les dossiers qui n’ont pas fait nécessairement l’objet d’un règlement ou d’un passage en CRA ont bénéficié de la gestion d’instance pour des questions de délai, pour des questions d’expertise, pour des questions de décisions prises au préalable sur un certain nombre de problèmes pendants, des questions d’admissibilité ou d’admission de la preuve, etc., et donc il y a beaucoup, beaucoup d’avantages secondaires aussi à régler très rapidement ces questions-là. Et, par la suite, pour les parties qui décident de procéder comme habituellement, on procède. Il y a une économie en fait de temps et, pour le justiciable, une économie d’argent.
Je voulais indiquer aussi qu’on a calculé ça, on a fait le calcul de cette économie-là, on a demandé aux avocats qu’est-ce que ça a coûté puis qu’est-ce que ça aurait coûté, et ce qui a été révélé, c’est que ça prenait le tiers du temps au palais, ça prenait le tiers du temps de travail et que ça coûtait le tiers des coûts que ça aurait coûté normalement, des coûts qui ne vont pas toujours dans les poches des avocats, d’ailleurs. C’est des coûts d’expertise, c’est des coûts qui vont de toute façon financer d’autre chose que le salaire ou les honoraires des avocats. Dans ce sens-là, le justiciable avait beaucoup d’avantages à ce que ce soit traité plus tôt que tard.
Et là, bon, je vous donne les éléments qui me viennent. Je ne sais pas si Huguette peut intervenir là-dessus.
Mme St-Louis (Huguette): Bien, moi, je dirais que la meilleure façon que le justiciable reste maître de son dossier, c’est de faire entrer le juge dans le dossier le plus rapidement possible, parce que finalement le justiciable est consulté à chaque étape. Et c’est ce qui est arrivé dans le projet de Longueuil, c’est que quand, le dossier, il y a eu une comparution, tout ça, le juge avait… bon, on a sélectionné des dossiers pour le projet pilote, mais le juge communiquait avec les avocats, c’est-à-dire la secrétaire du juge, disant qu’il y aurait une conférence téléphonique à tel jour, à telle heure, et là le juge avait déjà regardé les… Il demandait aux avocats de préciser le litige puis comment ça s’en allait, puis là, bien, si c’était nécessaire, il proposait une rencontre.
En fait, originellement, le projet, on voulait que le juge convoque les parties tout de suite avec leurs avocats, et il s’est avéré que ça aurait peut-être coûté plus cher si ça avait été comme ça, parce que, dans bien des cas, il y avait moyen déjà de discuter avec les avocats du dossier. Donc, avec cette méthode-là, les…
Le Président (M. Drainville): En conclusion.
Mme St-Louis (Huguette): Pardon?
Le Président (M. Drainville): En conclusion. Je m’excuse.
Mme St-Louis (Huguette): Alors, avec cette méthode-là, les gens étaient plus au courant de comment le dossier évoluait que quand on attend 45 jours pour faire un protocole et puis que le juge va être un peu plus comme un «rubber stamp» pour ça. Mais je vais laisser à Pierre la conclusion, parce qu’il nous reste…
Mme Sarrazin (Marie-Claude): O.K. Bien, peut-être juste dire que l’histoire de l’intervention rapide, c’est, oui, pour favoriser le règlement rapide des litiges, mais c’est surtout pour permettre un meilleur contrôle de la proportionnalité des moyens pris lorsqu’on doit saisir l’ordre judiciaire, parce qu’il y a des fois où on n’y arrivera pas. Par contre, si on va voir le juge 45 jours ou six mois plus tard, bien il y a déjà des frais d’expert d’engagés, il y a déjà des interrogatoires qui se sont mal passées, 150 engagements de demandés, des objections à débattre, tandis que l’intervention d’un juge plus rapidement peut amener à mieux saisir le litige, convenir d’une expertise commune, etc.
Le Président (M. Drainville): Et on doit vraiment s’arrêter, je m’excuse. Mme la députée de Joliette.
**(12 h 20)**
Mme Hivon: Oui. Je voudrais vous entendre sur l’article 5, donc: «Les parties peuvent prévenir ou régler leur différend en faisant appel à des normes et à des critères autres que ceux du droit…» Je trouve ça très intéressant parce que, dans votre mémoire, vous y consacrez, à la page 19, en fait, un paragraphe, vous dites que vous vous questionnez à savoir si cet élément-là ne proviendrait pas d’un article, donc, de Jean-Guy Belley qui reprenait cette idée-là. Moi aussi, je me demande un peu d’où il vient, et en fait il y en a d’autres comme vous qui l’ont effleuré mais qui ne semblent pas vraiment vouloir en discuter. Moi, je pense qu’il faut vraiment discuter de cet article 5 là et donc je voudrais voir avec vous ce que vous comprenez de «normes et critères autres que ceux du droit». Est-ce que ça peut faire référence aux normes religieuses? Évidemment, tout le monde a ça à l’esprit. Est-ce qu’il y a des périls à avoir un tel libellé dans notre code?
M. Noreau (Pierre): Je dirais non pour une raison simple, c’est que, là, on est en train de parler de choses qui se font à tous les jours. On règle les problèmes auxquels on est confrontés à partir, souvent, des considérations qu’on trouve important de mobiliser pour les régler, et donc on n’est pas en face d’une situation complètement nouvelle. Les gens ne régissent pas leurs rapports sociaux uniquement en fonction du droit tel qu’ils l’imaginent ou même qu’ils le connaissent, ils gèrent leurs problèmes à partir de leurs considérations personnelles.
Évidemment, on a tendance… et puis je pense que, là, il y a un effet de période à opposer toujours le droit étatique avec le droit religieux, mais en fait, là, les systèmes de référence, dans la vie, il y en a pas mal. Dans une famille, il y en a, des règles qui ne sont pas des règles juridiques mais qui servent à alimenter et puis à déterminer les comportements puis qui servent de référence lorsqu’il s’agit de régler des problèmes. Moi, sur mon frigidaire, là, il y en a, une série de règles dans la maison, qu’est-ce qu’on fait puis qu’est-ce qu’on ne fait pas. Pensez-vous que c’est légal? Ce n’est pas illégal, c’est dans l’ordre public, ça respecte la charte, mais c’est des règles spécifiques dans la maison chez nous: comment on fait un lunch, comment est-ce qu’on lave la vaisselle, qui c’est qui la lave, quand il la lave, qui va m’aider à laver le plancher. Ces règles-là, c’est des règles qui gèrent notre vie quotidienne. C’est du droit social, du droit que ma société familiale génère. Alors, quand on a des différends parce qu’on ne sait plus qui c’est qui doit laver la vaisselle, ce n’est pas compliqué, on regarde, puis là, bien, on trouve la solution.
Donc, ce que je veux dire, c’est qu’on passe notre vie… À l’intérieur de la vie dans les bureaux, il y a tout un équilibre qui se crée quand vous êtes sur le même étage, là: qui utilise la photocopie, comment est-ce qu’on se sert de la cafetière, le papier est où, qui c’est qui alimente la photocopieuse. Il y a un paquet de règles comme ça qui s’établissent, qui ne sont pas toujours écrites mais qui servent à gérer les problèmes lorsqu’ils se présentent, parce qu’on dit: Qu’est-ce qu’on fait d’habitude? On fait ça. Bon, on va continuer à faire ça. Ce que je veux dire, c’est que l’idée générale qui est derrière n’est pas problématique, en tant que tel. O.K.? C’est ce que je veux dire, c’est qu’on gère beaucoup de problèmes à partir d’autres normes que les normes strictement juridiques prévues par la loi. C’est un état de fait. C’est une chose, là, constante dans la vie.
Maintenant, si on veut opposer le droit, mettons, de l’État et le droit religieux — parce que c’est ça qui sert d’épouvantail dans cette question-là, en fait — est-ce que ça n’ouvre pas la porte à d’autres modes de gestion ou d’intervention qui seraient structurés autour des communautés de foi ou autour des religions, etc.? Je dirais que… Enlevez l’article, si vous voulez, mais ça existe déjà, ça va continuer à se faire.
Nous, dans le temps, dans le village où je pratiquais, c’était l’aide juridique ou c’était le curé, et donc, d’une certaine façon, il y avait un rôle social par des gens, puis c’étaient les religieux. Alors, quand même j’aurais voulu l’empêcher, là, en disant: N’allez pas voir le curé, venez nous voir, tu sais, les gens voulaient régler leurs problèmes, ils se faisaient aider par le tiers qu’ils considéraient le mieux situé pour les aider. Est-ce que c’est quelque chose qui existe dans les autres religions que les religions qui étaient les religions du village où j’étais? Bien, très certainement. J’imagine que, les religieux musulmans ou au sein de la communauté juive, il existe un paquet de pratiques de cette nature-là.
Là, la question, c’est de savoir: Est-ce qu’on consacre ça et est-ce qu’on en fait un idéal dans l’article 5, d’une certaine façon? Est-ce qu’on n’encourage pas ces pratiques-là et qu’on contourne constamment le droit étatique pour référer à d’autres systèmes? À partir du moment où c’est à l’intérieur de l’ordre public puis ce n’est pas contre les chartes, d’une certaine façon on est encore dans notre ordre juridique dans la mesure où ce sont des pratiques qui ne sont pas nécessairement illégales, puis tiennent à des pratiques quotidiennes dans beaucoup de milieux, et puis règlent beaucoup de problèmes dans le courant de la vie, comme un professeur dans sa classe, comme un enseignant ou comme… Et donc, comprenez-vous, on peut faire de ça une grande question de principe, mais en fait on est en train de parler de quelque chose de très courant, en fait.
Mme Hivon: Et, concrètement, on est dans un instrument qui s’appelle le Code de procédure civile — peut-être qu’il devrait avoir un autre nom, mais ça, c’est un autre débat — et on vient le mettre noir sur blanc. S’il n’y a pas de problème, si je vous suis, qu’est-ce que ça donne de le mettre là, qu’est-ce que ça donne d’écrire ça dans… cette espèce d’idée?
M. Noreau (Pierre): Bien, moi, je pense que l’idée, c’est d’inciter les gens à tenir compte de la façon dont eux posent les problèmes, s’il s’agit de régler ces problèmes-là. Maintenant, moi, ce que je veux, c’est le rattacher à la question de la conciliation, parce que je le vois, en fait, comme un élément là-dedans. Au fond, indirectement, la question, ça pourrait être: Est-ce que les gens ne pourraient pas dire: Nous, on a rencontré les exigences de l’article 1 en allant voir quelqu’un qui officie comme arbitre dans notre communauté de foi, par exemple? Ça pourrait être ça, des médiateurs qui seraient des médiateurs religieux, par exemple. Bon, outre le fait qu’on ne pourra jamais empêcher quelqu’un d’aller se servir de ces références-là, je pense que, si nous, on propose la constitution d’un corps de médiateurs civils reconnus, c’est justement pour assurer une standardisation des systèmes de référence qui sont mobilisés lorsque deux personnes veulent régler leurs problèmes en utilisant les services d’un conciliateur, mais je pense que, ce faisant… Et le problème se poserait, par exemple, en médiation familiale. En médiation familiale, c’est ce qu’on fait, et le problème de la référence religieuse ne se pose pas en médiation familiale, actuellement, parce qu’on a standardisé et on a fait de ces gens-là plus ou moins des soutiens au système juridique tel que nous, on le conçoit. Et je pense que, si on le fait au niveau de la médiation ou de la conciliation civile, on va éviter les mêmes types de problème.
Le Président (M. Drainville): Et c’est malheureusement terminé. Merci beaucoup de votre participation à ces consultations, c’est très apprécié.
On va suspendre nos travaux jusqu’à 14 heures et on reprendra à ce moment-là avec d’autres groupes pour continuer ces consultations. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à 12 h 27)
(Reprise à 14 h 5)
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Alors, à l’ordre, s’il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.
Nous allons poursuivre sans plus tarder les audiences publiques sur l’avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile. Mme Monastesse, bienvenue. Je vous inviterais à vous présenter, les personnes qui vous accompagnent, et ensuite à faire votre exposé. La parole est donc à vous. Vous disposez de 15 minutes, et par la suite on va faire un échange de 10 minutes de chaque bord pour la période de questions. Alors, la parole est à vous.
Fédération de ressources d’hébergement
pour femmes violentées et en difficulté
du Québec (FRHFVDQ)
Mme Monastesse (Manon): Merci. M. le ministre, MM. et Mmes députés. Alors, Mme Sylvie Bourque, qui est la présidente de la fédération, m’accompagne aujourd’hui. Alors, merci de nous recevoir.
Tout d’abord, la fédération regroupe 37 maisons d’hébergement réparties à travers 11 maisons administratives du Québec. Alors, nous accueillons des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants et des femmes aux prises avec des difficultés.
Alors, les maisons membres de la fédération ont accueilli, en 2010-2011, près de 9 000 femmes et enfants, c’est en nette progression, et nous avons refusé au moment de la demande d’hébergement plus de 10 000 d’entre eux, faute de place disponible au moment de la demande. Qui plus est, nous soulignons que le taux d’occupation national est de 96 %, qui est stable par rapport à l’année dernière mais qui est en hausse de 12 % par rapport à l’année 2008-2009. Quant à la moyenne du séjour en maison d’hébergement, celle-ci a diminué de moitié par rapport à l’année dernière, passant de 42 jours à 17 jours, dû à la pression du nombre grandissant de demandes d’hébergement.
Alors, notre présentation portera plus particulièrement sur le chapitre II, la médiation en cours d’instance et les dispositions relatives s’y rattachant, qui s’inspire du Troisième rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale. Or, depuis la mise sur pied des services de médiation familiale, la médiation familiale dans un contexte de violence conjugale et familiale est un enjeu majeur pour la fédération et ses maisons membres et surtout pour les femmes et les enfants violentés, hébergés ou non, auprès desquels nous intervenons. Nous avions rédigé à cet effet, en octobre 2009, un mémoire intitulé Réactions quant au 3e rapport d’étape du Comité de suivi sur l’implantation de la médiation familiale, présentant les enjeux soulevés, entre autres, quant à la sécurité des victimes de violence conjugale et familiale ainsi que nos recommandations. Ce mémoire fut déposé auprès de divers ministères et instances gouvernementales concernés, dont le ministère de la Justice et de la Culture, Communications et Condition féminine, de même qu’au Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle. Qui plus est, nos recommandations ont également été déposées dans le cadre des consultations visant l’élaboration du deuxième plan d’action de la politique d’égalité et du troisième plan d’action gouvernemental en violence conjugale.
Nos recommandations sont restées, malheureusement, lettre morte auprès du ministère de la Justice, et nous continuons de constater les effets néfastes de l’implantation de la médiation en contexte de violence conjugale grâce aux témoignages même des victimes qui sollicitent nos services, contrevenant ainsi à l’esprit même du nouveau projet de loi stipulant en préambule que «cet avant-projet de loi vise à instituer le nouveau Code de procédure civile ayant principalement pour objectifs d’assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure, l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre et le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice». Nous constatons à regret que le libellé et l’esprit des articles du chapitre II de l’avant-projet de loi tiennent encore peu compte de la problématique de la violence conjugale et familiale et de ses impacts sur les victimes.
**(14 h 10)**
Conséquemment, la fédération maintient son désaccord avec la poursuite de la médiation en contexte de violence conjugale lorsque celle-ci a été dépistée. En effet, les prémisses nécessaires à la réussite du processus de médiation ne sont pas présentes dans un tel contexte, puisque la violence conditionne un rapport de pouvoir inéquitable, contraire aux fondements d’une négociation saine et respectueuse à la base même du concept de médiation et de l’esprit de l’avant-projet de loi. Dans cette perspective, la sécurité physique et psychologique des victimes, tel que stipulé dans les neuf principes directeurs de la politique gouvernementale en matière d’intervention en violence conjugale, doit primer sur toute autre considération et donc invalider toute poursuite de quelque façon que ce soit du processus de médiation.
Malgré toute la volonté des médiateurs et médiatrices, majoritairement des avocats, d’être formés quant à l’identification et les impacts de la violence conjugale, nous ne pouvons endosser le fait que l’on s’en remette à leur jugement quant à leur capacité de poursuivre le processus de médiation dans un tel contexte. L’objectif fondamental de la formation doit leur permettre de dépister et de référer, le cas échéant, aux ressources spécialisées dans le domaine de l’intervention en matière de violence conjugale et de judiciariser le dossier.
Qui plus est, en aucun cas les femmes violentées ne devraient être obligées d’assister au nouveau séminaire de parentalité et médiation, tel que libellé dans l’article 415. Nous soulignons que le motif sérieux doit être maintenu.
Alors, dans le présent mémoire, nous vous avons fait part de façon plus précise de notre argumentaire. Quand on regarde un peu l’évaluation de notre collaboration, suite à l’adoption de la loi n° 65 il y avait un comité de suivi qui avait été formé par le ministère de la Justice afin de suivre l’actualisation des objectifs visés par la loi. La fédération fut dès l’origine un membre de ce comité de suivi.
En 2004, il y avait déjà deux rapports qui avaient été déposés par ledit comité. Le comité de suivi arrivait alors au terme de la troisième étape de son mandat, presque exclusivement consacré à l’analyse de la problématique de la violence conjugale en contexte de médiation familiale. C’est concernant ce volet qu’ont ressurgi les discussions entourant les recommandations traitées dans les précédents rapports, dont les séminaires sur la parentalité après la rupture, le motif sérieux, la tarification, la gratuité et autres. Qui plus est, les commentaires émis par la représentante des associations provinciales qui interviennent auprès des femmes victimes de violence conjugale n’apparaissaient pas dans ces derniers ainsi que leurs revendications — déposées depuis fort longtemps — à l’effet que les médiateurs endossent la politique gouvernementale en matière de violence conjugale du Québec de 1995 et ses neuf principes directeurs, dont: «La société doit refuser toute forme de violence et la dénoncer;
«L’élimination de la violence conjugale repose d’abord sur des rapports d’égalité entre les sexes;
«La sécurité et la protection des femmes victimes et des enfants ont priorité en matière d’intervention.»
On avait également souligné que, dans le rapport pancanadien sur les droits de garde et de visite L’enfant d’abord, qui datait de 2001, on avançait comme conclusion, en ce qui a trait à la violence, que la Loi sur le divorce devrait traiter explicitement des problèmes de violence familiale. Il faut trouver un juste équilibre entre l’insistance de la Loi sur le divorce à garantir un maximum de communication d’un enfant avec ses parents et le besoin de protéger les enfants de toute violence familiale. On recommandait alors que la loi ne contienne aucune présomption sur le degré de communication d’un enfant avec ses parents, que l’intérêt de l’enfant soit défini par des critères législatifs tels que les antécédents de violence familiale et le potentiel de violence dans l’avenir, l’amélioration de la communication entre les deux parents quand cette démarche est sécuritaire et constructive, de ne pas rendre la médiation obligatoire, d’offrir des services de médiation à des parties bien informées qui possèdent des pouvoirs de négociation égaux et dont la participation est volontaire là où existe un mécanisme de contrôle adéquat qui permet de dépister et, généralement, d’exclure les cas de violence familiale. Le rapport ajoutait que les procédures judiciaires visant à régler les litiges entourant les arrangements parentaux sont encore nécessaires dans bien des situations. Il en est ainsi, par exemple, dans les cas de violence familiale, lorsque la médiation ne convenait pas ou que la médiation ou d’autres méthodes de résolution de conflits ont échoué. Dans le cas d’un ex-époux violent, un plan parental peut être un outil très efficace de contrôle.
On souligne également qu’en juin 2003 le Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale, familiale et sexuelle du Québec avait cru nécessaire de réaffirmer sa position sur la médiation familiale dans un contexte de violence qu’il avait déjà prise en 2001: «Ainsi, le comité juge que la médiation familiale n’est pas appropriée dans un contexte de violence conjugale et demeure aussi convaincu qu’aucune obligation relative à une participation à un processus de médiation, dont la séance d’information, ne devrait jamais être imposée à une victime de violence conjugale.» Cette position est également celle des services pour conjoints violents. Devant l’impossibilité de faire valoir devant le comité notre expertise et nos recommandations, la fédération, le regroupement et la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec ont mis fin à leur participation, après sept ans de collaboration, et ont soumis en novembre 2004 un rapport dissident contenant les éléments ci-dessus exposés et les recommandations présentées en annexe 4 du rapport sans être contextualisées.
Alors, quand on a regardé le troisième rapport d’étape du comité de suivi, ça a suscité pour nous plusieurs questionnements et des réserves plus… et des réserves sans avoir vraiment les réponses.
Alors, on a, premièrement, identifié qu’au niveau des statistiques il n’y avait pas les données du ministère de la Sécurité publique du Québec qui présentent même sous forme de tableau selon le sexe l’incidence des actes criminels dans un contexte conjugal, où il n’y a nulle… où c’est évident qu’il n’y a pas de symétrie des actes de violence qui est constatée.
Nous soulignons également que, tout au long du chapitre II, on dénote une difficulté à départager, au sein du couple en processus de séparation, les situations à haut niveau de conflit des situations où sévit la violence conjugale, qui peuvent comporter un haut risque de létalité et de danger pour la sécurité des victimes femmes et enfants de même que pour les agresseurs. Les données statistiques canadiennes et québécoises démontrent néanmoins que les contextes de rupture, de séparation et de divorce où interviennent les médiateurs sont hautement à risque de violence, ce qu’on ne voit pas vraiment dans le troisième rapport.
D’autre part, nous soulevons le fait que le rapport ne fasse aucunement état du contexte de violence sur les enfants, qui sont pourtant au centre du processus de médiation. Toutefois, à l’instar de la pratique de nos maisons d’hébergement, moult études font état des impacts dévastateurs de la violence sur la santé physique, psychique ainsi qu’au niveau de l’adaptation scolaire des enfants vivant dans un contexte de violence conjugale et familiale.
Alors, en regard de cet état de fait, nous constatons que nos préoccupations d’autrefois quant à l’analyse faite par les médiateurs de la problématique de la violence conjugale et leurs principes d’intervention sont encore d’actualité. En effet, certains médiateurs se perçoivent encore, malgré les formations, comme des générateurs d’idées et de nouvelles options dont la responsabilité est de veiller à ce que les couples règlent les enjeux de leur divorce sans faire de victime, en restaurant la communication entre eux et en facilitant l’accès des enfants à chacun des parents. C’est donc dire que ces médiateurs présupposent l’existence d’un rapport égalitaire entre les différents acteurs quel que soit le contexte, puisqu’il n’y a pas de victime ni d’agresseur.
Alors, déjà en 1992, il y avait un texte qui avait été écrit, un article par Alarie et Leboeuf qui disait que cette occultation du rapport de pouvoir… «Dans ce contexte, la médiation apparaît comme un processus inéquitable en ce sens où il y a déséquilibre de pouvoir dans la relation du couple au profit du conjoint qui utilise la violence comme moyen de contrôle. Les solutions proposées le sont dans un contexte de coercition où la coopération est impossible. Elles représentent donc difficilement un compromis négocié dans le respect et le meilleur intérêt de l’enfant.»
Elles s’interrogeaient aussi sur les habiletés des médiateurs en contexte de violence conjugale: «Malgré l’inégalité de pouvoir inhérente à la relation de violence conjugale, les médiateurs croient qu’ils peuvent, par leur intervention, actualiser les principes d’une médiation classique. Ils considèrent également que la médiation permet le développement de la communication entre les deux parties, l’apprentissage d’habiletés sociales ainsi que l’établissement de frontières claires, acquisitions suffisantes pour mettre fin à la violence et permettre aux femmes de reprendre du pouvoir sur leur vie.»
**(14 h 20)**
La Présidente (Mme Rotiroti): Je vous demande de conclure, il vous reste à peu près 50 secondes.
Mme Monastesse (Manon): Ah, mon Dieu! D’accord. On va aller tout de suite…
Une voix: …
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y. On va prendre le temps sur le côté ministériel, oui, parfait.
Mme Monastesse (Manon): Alors, je peux… Bien, je vais sauter tout de suite à la conclusion. Alors, considérant l’état de la situation et les éléments d’analyse que nous vous avons présentés dans ce mémoire, considérant que nos questionnements, nos préoccupations et nos objections sont toujours d’actualité quant à l’implantation de la médiation familiale en contexte de violence conjugale et familiale, considérant que nous constatons que le libellé et l’esprit des articles du chapitre II de l’avant-projet de loi tiennent encore peu compte de la problématique de violence conjugale et familiale et de ses impacts sur les victimes, considérant que la fédération maintient son désaccord avec la poursuite de la médiation en contexte de violence conjugale lorsque celle-ci a été dépistée — en effet, les prémisses nécessaires à la réussite du processus de médiation ne sont pas présentes dans un tel contexte, puisque la violence conditionne un rapport de pouvoir inéquitable contraire aux fondements d’une négociation saine et respectueuse, à la base même du concept de médiation et de l’esprit de l’avant-projet de loi — considérant que la sécurité physique et psychologique des victimes, tel que stipulé par les neuf principes directeurs de la politique, doit primer sur toute autre considération et donc invalider toute poursuite de quelque façon que ce soit du processus de médiation, considérant que, malgré toute la volonté des médiateurs et médiatrices — majoritairement des avocats — d’être formés quant à l’identification et les impacts de la violence conjugale, nous ne pouvons endosser le fait que l’on s’en remette à leur jugement quant à leur capacité de poursuivre le processus de médiation dans un tel contexte — l’objectif fondamental de la formation doit leur permettre de dépister et de référer, le cas échéant, aux ressources spécialisées dans le domaine de l’intervention en matière de violence conjugale et de judiciariser le dossier — alors la Fédération de ressources d’hébergement pour femmes violentées en difficulté du Québec maintient ses recommandations énoncées dans le rapport dissident soumis en novembre 2004 ainsi que dans son mémoire soumis en octobre 2009 et demande à ce que les articles du chapitre II de l’avant-projet de loi soient amendés afin de stipuler explicitement que la médiation n’est pas une solution à privilégier ni à promouvoir en présence de la violence conjugale, que le dépistage de la violence conjugale… de la violence soit effectué avant le début de la médiation, que les médiateurs, lorsqu’ils ont détecté la violence, soient tenus d’expliquer aux personnes concernées que la médiation n’est pas appropriée dans leur situation et leur conseiller de recourir aux tribunaux et que les articles soient amendés afin que, dans toute promotion sur la médiation, un avertissement soit ajouté relativement à l’usage de la médiation dans des cas où il y a violence conjugale.
Alors, qui plus est, en aucun cas les femmes violentées ne devraient être obligées d’assister au nouveau séminaire de la parentalité et médiation tel que libellé dans l’article 415. Nous soulignons que le motif sérieux doit être maintenu.
En ce qui concerne les enfants, la médiation familiale est perçue, le plus souvent à juste titre, comme méthode de règlement des conflits qui vise d’abord et avant tout à rechercher leur meilleur intérêt. Or, dans une situation de violence conjugale, le meilleur intérêt de l’enfant est d’être soustrait à cette situation de violence et d’être en sécurité. On sait aussi que la sécurité des enfants exposés à la violence conjugale est indissociable de celle de leur mère. Voilà donc une autre raison qui motive notre position contre l’utilisation de la médiation familiale ou tout autre mode alternatif de règlement de conflits. Rappelons que la violence conjugale doit être différenciée du conflit qui peut éclater au moment de la rupture du couple, et, bien que la réponse des tribunaux soit souvent imparfaite, il est préférable pour une victime de violence conjugale et pour ses enfants d’être représentés par un avocat qui saura défendre leurs droits et leurs intérêts, notamment le droit à la sécurité. Merci.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. On va passer à l’échange du côté ministériel. M. le ministre.
M. Fournier: Merci beaucoup. Merci à vous d’être avec nous. Je voulais vous laisser faire votre présentation parce que j’aurai peu de questions. J’en aurai une, en fait, mais simplement pour vous dire que vous êtes… Non, vous n’êtes pas venues pour rien quand même, là. Il y a au moins un autre groupe — je ne me souviens plus lequel — qui est venu nous voir, il y a deux semaines, pour exposer des positions identiques et pour lesquelles j’ai été très sensible. On en avait d’ailleurs discuté par la suite.
Peut-être pour faire un petit détour, évidemment on parle déjà un peu de ce que c’est, la médiation, et, sans la nommer, j’arriverai tantôt sur l’article qui nomme la violence, mais autant 616 que 619 font état quand même de l’équilibre nécessaire entre les parties pour que cela fonctionne. Dans le cas de 418, bien c’est même un peu plus précis. Lorsque le tribunal veut l’ordonner, la médiation, on lit ceci: «…le tribunal prend en considération le fait que les parties ont déjà ou non vu un médiateur accrédité, l’équilibre des forces en présence, l’existence ou non d’une situation de violence familiale ou conjugale et l’intérêt des parties et de leurs enfants.»
Je fais ce détour-là pour dire à peu près ceci: Ce dont vous nous parlez a été en partie considéré en partie, nommé, compris. Cependant, vous ouvrez un autre angle qui pousse un peu plus loin, pour lequel je serais bien embêté de vous offrir un contre-argument. On nous l’a déjà dit puis on comprend tous, là, que la médiation, ça ne se fait pas quand il y a un déséquilibre. C’est vrai pour tout le monde. Dans ce cas-là, je veux dire, ce n’est même plus… on ne parle plus de déséquilibre, là. La situation, c’est vraiment d’un autre ordre.
Ma question pour vous, c’est: À partir du moment où on est capables de constater et que donc, dans un changement de régime, parce que tous ne sont pas victimes, donc, pour les autres on peut se donner cet outil-là, on doit se donner cet outil-là qui fonctionne, dans le cas des victimes, lorsque c’est vu, lorsque c’est identifié, quel est le chemin que vous croyez que nous devrions suivre? Rien? Juste l’adjudication ordinaire, le Code de procédure ordinaire? Est-ce qu’il y a des gestes qui doivent être posés? Oublions ce dont vous nous dites qui n’est pas approprié. Qu’il le soit pour d’autres couples mais ne l’est pas pour ceux que vous défendez, soit. Qu’est-ce qu’on fait dans le cas des couples pour lesquels, si on vous écoute, on prend ça, puis ce n’est plus bon? Ça prend quelque chose d’autre, on ne laissera pas le vide. Qu’est-ce que vous nous proposez pour combler ce vide? Et c’est ma question pour vous.
Mme Monastesse (Manon): Oui. Bien, écoutez, on a aussi identifié, là, les articles, le 418 et le 616. Je veux dire, c’est très louable dans l’esprit des articles de l’avant-projet de loi, tout à fait. Ceci dit, nous, dans la pratique — c’est parce que je veux faire un préambule — on voit… comme on l’a dit, à plus de 90 % ce sont des avocats qui sont des médiateurs, et, malgré le fait qu’ils reçoivent une certaine formation, d’un nombre x d’heures, ça n’en fait pas des experts au niveau de l’intervention en contexte de violence conjugale. Et nous, on a tous les jours des récits d’aberrations, pour ne vous donner qu’un seul cas d’espèce qui malheureusement se répète, où les personnes, le couple en présence est d’une autre… parle une autre langue, a une autre langue maternelle, autre que le français et l’anglais, et on a vu dans des cas où le médiateur a accepté, sans la présence d’un interprète, que le mari s’adresse à sa femme dans sa langue d’origine maternelle. Alors, le médiateur n’était absolument pas au courant des tenants et des aboutissants de la discussion et a permis cela, en sachant très bien que c’était un couple où il y avait déjà un contexte de violence conjugale. Alors, je pourrais vous en donner, là, un certain nombre de cas où il y a vraiment des aberrations.
Mais, pour répondre à votre question, c’est déjà le processus que l’on fait, parce que les femmes qui viennent en maison d’hébergement, on les met en garde par rapport à la médiation, on leur donne tous les tenants et les aboutissants, oui, pour qu’elles puissent prendre une décision éclairée, et majoritairement elles décident de ne pas aller en médiation, mais nous les recevons, et nous les soutenons dans toutes leurs démarches au point de vue juridique et au niveau de la garde des enfants, et nous les référons à des avocats qui connaissent bien et qui comprennent bien tous les enjeux dans un contexte de violence conjugale. Alors, on fait déjà le travail. Et, en ce qui concerne les conjoints violents, ils ont accès à des associations, des organismes qui interviennent auprès des conjoints violents. Ça prend des avocats, mais il faut vraiment que ce soit judiciarisé, et on le fait déjà. La voie d’accotement, on la prend déjà, parce qu’on ne recommande jamais la médiation.
**(14 h 30)**
M. Fournier: Je sais que j’embarque peut-être sur mon autre 10, mais…
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, rapidement, allez-y.
M. Fournier: Je vais le finir, puis après ça… pour ce cas-ci, parce que c’est la seule question, là, sur laquelle je veux m’arrêter. Je comprends les associations de l’une et de l’autre, là, je comprends, mais on a un système — parlons de la parentalité — pour lequel vous dites: Nous, violentés, franchement ce n’est pas notre place, là, ce n’est pas là qu’on va aller, puis ce n’est pas très adapté comme cours pour le conjoint violent, ce que j’ai déjà entendu, et, oui, je comprends ça. N’y a-t-il pas lieu d’avoir une adaptation — puis on l’appellera différemment, là — d’avoir quelque chose de particulier? Je pense aux conjoints violents, là. Vous savez, s’il y a un cours de parentalité avant la médiation — puis je ne parle pas des violents, là — c’est pour la prise de conscience qu’il y a quelque chose d’autre que deux parties, il y en a une troisième, puis tout le monde peut-être a besoin de se faire rafraîchir la mémoire là-dessus, tiens, on va parler poliment. Il y en a, tu sais, les violents, franchement, là, on va partir d’un peu plus loin, là. Alors, est-ce qu’il y a une adaptation, est-ce qu’il y a un autre genre de préparation à faire face à ce litige, à ce conflit, à cette problématique qui doit être choisi comme chemin plutôt que la parentalité, je le comprends bien, puis qui n’est pas juste de dire: Bien, il y a des associations qui vont s’occuper d’eux? Il n’y a pas d’autre chose qui doit être fait?
Mme Monastesse (Manon): Bien, au niveau de l’appareil de la justice, je veux dire, on le voit ailleurs, il y a des exemples au niveau… Des pratiques prometteuses, ce serait d’avoir un tribunal spécialisé en médiation familiale… Pas en médiation, pardon. C’est tout un lapsus!
M. Fournier: …danger, là.
Mme Monastesse (Manon): Mais ce serait d’avoir des tribunaux spécialisés qui tiennent compte… qui ne font que des cas de violence conjugale et familiale. Et ça se fait ailleurs. Ça se fait dans différentes provinces du Canada, ça se fait à New York. On a regardé beaucoup le modèle américain, puis il faut dire que ce n’est pas le même système de justice, mais ça se fait en Ontario et dans d’autres provinces avec différents systèmes, mais ce sont… où, là, vraiment, les procureurs sont spécialisés en violence conjugale, ils ne traitent que ces cas-là. Alors, pour nous, ce serait l’idéal parce que tout le monde serait spécialisé, le juge est spécialisé, les procureurs sont spécialisés, et ils ne font que ça, ils ne traitent que ces cas-là.
La Présidente (Mme Rotiroti): M. le ministre, est-ce que vous voulez continuer sur…
M. Fournier: Je vais reprendre mon souffle.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Alors, on va passer à l’opposition officielle, à la députée de Joliette et porte-parole de l’opposition officielle en matière de la justice.
Mme Hivon: Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, je veux vous souhaiter la bienvenue à mon tour, Mme Monastesse, Mme Bourque. Ça me fait plaisir de vous entendre et de voir qu’une organisation comme la vôtre, qui a des moyens limités, a quand même pris le temps de concocter ce mémoire et de venir nous le présenter. Alors, je ne doute pas que c’est un enjeu important pour vous et je pense qu’on le comprend très bien.
On a eu un premier éclairage il y a deux semaines par un autre regroupement, donc, que vous devez connaître aussi. Moi, en fait, ma question, elle est un peu double, ça va un peu dans le même sens. Si on voulait… Je comprends votre rêve ou ce que vous souhaiteriez idéalement, qu’il y ait une instance dédiée à ces cas-là, mais, si je vous disais: On sépare médiation et parentalité, O.K., dans le sens que, là, la séance porte sur les deux, et qu’on se disait: Dans les cas de violence conjugale, on sépare les deux, est-ce que, selon vous… Parce qu’on se fait dire qu’il y a aussi, en matière de parentalité, des enjeux spécifiques et évidemment très complexes liés à l’exercice de la parentalité dans un contexte où il y a eu violence conjugale. Est-ce que, pour vous, un séminaire de parentalité pourrait quand même être quelque chose d’intéressant, de manière globale?
Et deuxième volet: Si, plutôt qu’être donné par des médiateurs ou des gens, là, désignés pour tels, le séminaire de parentalité adapté à la réalité de la violence conjugale était donné par des organismes qui sont déjà au fait de la problématique, qui sont déjà en contact avec les gens, est-ce que, pour vous, ce serait une amélioration, quelque chose de concevable?
La Présidente (Mme Rotiroti): Mme Bourque.
Mme Bourque (Sylvie): Il faudrait… On ne l’a jamais vu, on n’a jamais vu séparés les deux, là, ça a toujours été mis ensemble. À prime abord, ma réflexion, ce serait de dire que, déjà dans le concept de parentalité, là non plus… les femmes partent d’un autre point de vue, elles se sentent déjà très responsables de toute la situation, se responsabilisent même de la violence du conjoint par rapport à la situation, donc là… Et souvent, pour les conjoints, ils sont plutôt très loin de cette réalité-là, et je ne pense pas qu’en une séance ou… que ça puisse avoir un impact vraiment sur la situation au moment de la séparation. Je pense qu’on est beaucoup plus dans un registre de judiciarisation, et d’aller avec juge et avocats, et de référer les avocats et les gens à des organismes pour pouvoir les aider.
Mme Hivon: Parce que, pour des gens qui baignent moins au quotidien dans la réalité qui est la vôtre, puis à la lumière des échanges qu’on avait eus aussi avec les autres ressources en matière de violence conjugale, la question pourrait se poser de dire: Mais il y a quand même des enjeux, parce que c’est sûr que les femmes qui vont dans vos ressources vont être accompagnées, vont être aidées à cheminer, tout ça. Ce n’est pas le cas de toutes les femmes qui sont aux prises avec la violence, parce que toutes ne demandent pas de l’aide dans les ressources comme les vôtres ou d’autres groupes qui peuvent exister, et c’est le cas aussi pour les hommes qui sont des homme violents, qui, pour plusieurs, ne demanderont pas l’aide.
Donc, comment on fait pour essayer de favoriser, je dirais, le minimum de poursuite de relation convenable pour le bien-être des enfants à la suite d’une rupture, dans un contexte de violence conjugale, quand on pense qu’il doit y avoir des mécanismes à être mis en place pour favoriser ça? L’exercice de la parentalité, j’imagine, dans un contexte de violence conjugale, est encore plus difficile, comporte des enjeux encore plus complexes, bon, tout ça. Donc, est-ce qu’il y a un moyen d’aller rejoindre, je dirais, tous ces gens-là qui doivent continuer à être parents, certains avec des droits de garde très, très limités, d’autres avec des droits peut-être plus étendus? Comment on fait si on a cette volonté-là? Est-ce qu’il y a un moyen d’y arriver?
Mme Monastesse (Manon): C’est parce que la prémisse de base, c’est que, quand on regarde, quand on… ce n’est pas en vain qu’on dit dans la politique, dans les principes directeurs qu’il faut s’assurer de la sécurité des victimes de violence conjugale, parce que, d’elles-mêmes… Un contexte de violence conjugale, ça s’intègre et ça s’incruste de façon progressive, ce n’est pas du jour au lendemain que le conjoint est violent, et autant quand on intervient on ne peut pas défaire cette dynamique-là aussi d’une façon… du jour au lendemain.
Alors, au niveau de la sécurité, nous, ce que l’on voit, c’est quand c’est judiciarisé, parce que ça protège les femmes et les enfants qui sont victimes parce que, quand il y a eu jugement à la cour civile, avec toutes les… voyons, les…
Une voix: …
Mme Monastesse (Manon): Pardon?
Une voix: …
**(14 h 40)**
Mme Monastesse (Manon): Oui, c’est ça. En tout cas, avec tous les détails, si jamais le conjoint violent commet une infraction ou ne respecte pas toutes les clauses, à ce moment-là on a un levier pour mieux protéger la femme. Puis il ne faut jamais oublier que, dans toutes les études, c’est très clair que le moment de la rupture, de la séparation et quand les procédures s’enchaînent, s’enclenchent, c’est le moment le plus crucial au niveau des homicides, des filicides, des infanticides, c’est le moment qui est très crucial, alors ça prend vraiment une protection importante. Et on le voit dans de nombreux cas d’homicides conjugaux et des filicides, c’est à ce moment-là que ça se produit, c’est au moment où la femme décide vraiment de quitter son conjoint. C’est à ce moment-là qu’elle est le plus en danger et que les enfants sont le plus en danger.
Alors, déjà, le concept de médiation, c’est vraiment… c’est quelque chose qui ne peut même pas s’appliquer, et on ne voit pas comment… Comme le disait Mme Bourque, même dans certaines… même s’il y a une séance, deux séances, trois séances, ce n’est pas assez dans le temps pour mettre en place, premièrement, des mécanismes de dépistage et, deuxièmement, des mécanismes de sécurité, parce que ça peut donner un faux sentiment de sécurité et ça peut donner aussi aux conjoints violents un faux sentiment que… parce que, pour eux, dans leur tête, c’est qu’ils vont toujours pouvoir avoir un certain contrôle sur leurs conjoints, et ça peut donner un faux sentiment qu’ils vont réussir quelque part à avoir toujours un certain contrôle. Et on sait que, même quand il y a la séparation, la violence perdure et beaucoup via la garde des enfants. C’est là que la violence, à ce moment-là, va pouvoir s’exercer encore, quand les clauses ou les restrictions sont mal appliquées ou sont mal définies. Et il faut toujours avoir dans l’esprit que les homicides arrivent souvent à ce moment-là, c’est un moment extrêmement critique. Même au niveau des enlèvements d’enfant internationaux, pour avoir travaillé dans ce domaine-là, c’est le moment critique, c’est à ce moment-là que ça arrive.
Mme Hivon: Donc, si je vous comprends bien, même si on met de côté toute l’idée de médiation, que vous rejetez complètement, je le comprends, et qu’on gardait juste l’aspect parentalité pour un peu… pas pour donc s’entendre sur la séparation ou les modalités mais plus pour dire: Voici peut-être des éléments pertinents pour la suite des choses parce que vous restez parents toute votre vie, et que cela se faisait de manière séparée, bien sûr, entre les ex-conjoints, et que, par exemple, c’était pris en charge par des gens qui ont des formations spécifiques dans le domaine de la violence conjugale, vous ne pensez pas que c’est quelque chose de souhaitable ou qui pourrait amener des résultats.
Mme Bourque (Sylvie): On n’est pas contre la vertu. Si à certaines séances… comme vous disiez, s’ils sont séparés…
Une voix: …
Mme Bourque (Sylvie): Pardon?
Mme Hivon: Ça, je pense que c’est déjà prévu, là.
Mme Bourque (Sylvie): C’est déjà prévu, c’est ça, effectivement. Ça pourrait… C’est ça, on ne pense pas… Je comprends qu’on ait beaucoup d’espoir que ça puisse transformer du tout au tout ou que ça puisse, en ce sens-là…
Mme Hivon: Je comprends que vous ne partagez pas vraiment l’espoir…
Mme Bourque (Sylvie): Non.
Mme Hivon: …parce que vous dites: C’est trop restreint dans le temps, c’est un peu de la pensée magique de penser, en une session, qu’on va changer les choses. Mais est-ce que…
Mme Bourque (Sylvie): Ça peut aussi alimenter l’espoir de la femme que ça puisse s’arranger ou que monsieur aura compris et qu’on n’est plus… C’est tout le danger qui est là aussi dans des séances comme ça, donner, comme disait Mme Monastesse, un faux sentiment de sécurité aussi ou de: Bon, ça a pu avoir un impact, et puis de, disons, laisser tomber la garde, d’une certaine façon.
Mme Hivon: Mais, si on…
La Présidente (Mme Rotiroti): Il vous reste à peu près…
Mme Hivon: O.K. Au prochain bloc.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui? Comme vous voulez, il vous reste encore 20 secondes.
Mme Hivon: Bien, je vais… Oui, juste là-dessus. Mais, si on poussait la logique à dire: Est-ce qu’il pourrait y avoir le bénéfice ne serait-ce que de rejoindre tous ces gens-là… Parce que, là, je comprends que, dès lors qu’on serait dans un contexte donné de violence conjugale, tous les hommes — qui vont rester des pères théoriquement — qui n’ont pas recours à des ressources n’auraient aucune information. Est-ce qu’il n’y a pas là un mécanisme pour essayer de les amener aussi à cheminer par rapport à leur parentalité? Là, j’explore avec vous, là. C’est parce que ce n’est pas une problématique simple, là.
Mme Monastesse (Manon): Bien, c’est parce que nos craintes viennent aussi des faits que l’on constate. On a assisté… Il y a deux ans, il y avait un séminaire de l’association des médiateurs et médiatrices qui parlait des défis de l’implantation de la médiation en contexte de violence conjugale. On a assisté à… ils nous ont présenté un peu comment ils voulaient présenter la fameuse séance de parentalité, en aucun cas ils ne parlaient de la violence conjugale, que c’était une possibilité, alors même on leur a mentionné: Mais, écoutez, si vous n’en faites même pas état, que vous n’en parlez même pas, alors c’est évident que vous n’allez même pas pouvoir dépister.
On n’est absolument pas contre le fait que les médiateurs soient formés pour le dépistage, mais, par la suite, on ne peut pas… Parce que ce qu’on comprenait de ce fameux séminaire, c’est que, oui, on va les former 12 heures, six heures. Moi, je ne deviendrais pas avocate en 12 heures, là, alors je ne vois pas comment un médiateur, même si c’est 100 heures, 200 heures, devient un expert en intervention en violence conjugale dans un espace de 10 séances de médiation quand même les services pour conjoints violents nous disent: Ça prend des mois pour défaire toute cette pensée au niveau du contrôle et de la domination.
Alors — là, je suis en train de perdre le fil de mon idée — on n’est pas contre le fait que les médiateurs dépistent, mais, du moment qu’ils dépistent, il faut qu’ils réfèrent aux services qui sont spécialisés. Mais vous voyez que, même au niveau de la présentation de ce fameux séminaire de parentalité, si on ne fait pas état de ce que c’est que la violence conjugale et qu’on ne fait pas une bonne distinction entre ce que c’est, les conflits qui peuvent survenir lors d’une séparation et la violence conjugale… Au niveau même de la population, ce n’est pas toujours évident de démêler qu’est-ce que c’est qu’un contexte de violence et qu’est-ce que c’est qu’un contexte de conflit. Alors, s’ils n’en font pas état de manière très claire et qu’ils ne donnent pas accès aux ressources… On leur disait: Il faudrait mettre des dépliants parce que ça se passe en région, ça peut se passer de différentes façon, qu’il y ait des dépliants, qu’ils puissent avoir accès à des services. Bien, déjà, c’est voué à un faux… à un très bas taux de dépistage si on n’en parle pas.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. On passe du côté ministériel. M. le ministre.
M. Fournier: C’est drôle parce que vous êtes partie sur une piste de réponse qui disait que vous perdiez le fil et vous étiez en train de répondre à la question que je veux vous poser. C’est de la prémonition, d’après moi.
Je vais sortir du cadre complètement du droit puis de la procédure civile, puis embarquons plutôt dans votre champ d’expertise. Alors, vous aviez commencé en disant: Détricoter la violence ou l’abus, ce n’est pas une question de séances, c’est une question de mois. J’imagine que, si vous aviez continué, vous auriez dit «voire d’années». Parlez-moi plutôt de ce rayon d’action là qui est votre expertise. Est-ce qu’on peut espérer que cesse, à un moment donné… Il y a un enfant ou il y a des enfants. Est-ce qu’on peut espérer que cesse une relation où la violence passée — parce que, là, le couple n’est plus ensemble, c’est à espérer qu’il n’y a plus de violence — n’est plus un facteur entre les parties ou ça reste là la vie durant, que ce n’est pas possible de rebâtir? Si oui, s’il y a une lueur d’espoir, votre expérience, c’est qu’elle se réalise au bout de quoi, de plusieurs mois, d’années? Et la proportion, c’est quoi, c’est 10 % qui se règle, c’est 50 %? Quel est le… Parlez-moi, dans le fond, du concret, là, de la vraie vie qui est vécue.
Mme Bourque (Sylvie): Le pronostic à long terme, d’une certaine façon?
M. Fournier: Bien, quand il y a quelqu’un de violent, là, qu’il y a un conjoint qui a été abusé, il y a un violent et puis… qu’est-ce qui se passe dans le continuum, là? On peut y aller par anecdotes, là, ce n’est pas très grave, je veux avoir une idée générale. Il y a des cas de figure qui sont au pire, et au mieux, puis entre les deux. Qu’est-ce qui existe dans ces trois cas-là?
Mme Bourque (Sylvie): Bien, au pire, les enfants sont rendus adultes, et il y a encore du contrôle de la part du conjoint. Au mieux, bon, ça se passe bien, puis on est dans une relation un peu plus égalitaire parce que la femme a repris du pouvoir parce qu’elle n’est plus sujette au contrôle et à la domination du conjoint, donc elle est plus à même de s’affirmer et de pouvoir mettre des balises qui vont assurer sa sécurité et la sécurité de ses enfants.
M. Fournier: Arrêtons à ce cas-là. Ce cas-là se présente peu souvent, fréquemment, souvent, le cas où se termine une relation de déséquilibre?
Mme Bourque (Sylvie): On cherche des statistiques, je crois, là, mais c’est que ça ne se fait pas du moment où il y a la séparation, c’est qu’on s’entend que c’est au fil des mois et des années que la femme peut reprendre du pouvoir et que l’homme commence à comprendre que ça ne marchera peut-être pas et puis que… ou il se prend une deuxième conjointe et puis il pourra exercer son contrôle et sa domination sur une deuxième conjointe, parce qu’on s’entend que la violence qui est exercée, c’est une demande de pouvoir, de contrôle sur l’autre, alors ça peut se répéter dans plusieurs relations de couple. En tout cas, je ne veux pas… O.K. J’allais parler de…
M. Fournier: Bien, essentiellement, est-ce qu’un conjoint violent peut sortir de ce pattern de violence? Et, si oui, généralement, ça peut prendre combien de temps et…
**(14 h 50)**
Mme Bourque (Sylvie): …demander plus aux organismes qui s’occupent des conjoints violents. Par contre, ce que je peux dire de notre expérience, de notre côté, c’est qu’il y a un cheminement qui doit être fait. Il y a une prise de conscience, premièrement, de sa propre violence, de sa propre responsabilité dans ces gestes-là, ce qui est le premier pas à faire pour faire quoi que ce soit, là, que ce soit d’arrêter de boire, d’arrêter… bon, et souvent cette prise de conscience là, c’est la première difficulté pour le conjoint, parce que, pour lui, c’est toujours la faute de l’autre, c’est si elle n’avait pas fait ça et ci. Alors, il projette toujours sa responsabilité, alors la première prise de conscience, c’est ça, de… Et ça…
M. Fournier: …prise de conscience peut être longue à venir.
Mme Bourque (Sylvie): Oui. Et je ne veux pas parler pour les organismes qui interviennent auprès des conjoints violents, ça serait à eux de répondre à cette question-là, la proportion qu’ils peuvent avoir d’hommes qui viennent, et etc., mais c’est un premier pas, c’est pour ça. Quand on parle de séances de parentalité, est-ce que c’est… il s’agirait aussi de voir le contenu, comment que ça pourrait être amené, et tout ça, mais…
M. Fournier: Ce qu’on essaie de voir, c’est de se dire… Puis la médiation, c’est une chose; la parentalité, c’est une autre chose. C’est préparatoire à… Convenons qu’il y a déséquilibre et il n’y aurait pas lieu à médiation. Convenons que la parentalité est mal adaptée à un couple ayant subi ou faisant subir la violence. La question qui nous vient à l’esprit, c’est: N’y a-t-il pas quelque chose d’autre qui peut être fait? Réponse: Peut-être long terme, faire prendre conscience de la violence. Et puis là, bien, ce que je comprends, c’est que ça fait longtemps que le jugement, au fond, a été rendu avant que le monsieur finisse par prendre conscience que, ah, j’étais violent. C’est ce que je comprends.
Mme Bourque (Sylvie): …responsabiliser par rapport à ça.
Mme Monastesse (Manon): C’est ça, qui est un des neuf principes directeurs.
M. Fournier: Pardon?
Mme Monastesse (Manon): Un des neuf principes directeurs, c’est la responsabilisation des conjoints violents.
M. Fournier: Oui, mais ce que je comprends, c’est qu’on a fini la…
Mme Bourque (Sylvie): On a dépassé, souvent, la période critique.
M. Fournier: …le code est inutile, le jugement est rendu, on est rendu dans d’autre chose, et là il peut y avoir, à un moment donné, une prise de conscience qui peut faire cesser une relation. Est-ce que, là, ça ouvrira la porte à des changements au niveau de l’accès, la garde? Bon. Mais, à ce que je comprends, c’est bien longtemps après la rupture.
Mme Monastesse (Manon): Mais le fait que ça soit judiciarisé, c’est que c’est sûr que ce n’est pas magique, la judiciarisation, mais les dernières études démontrent que c’est quand même un message clair de la société d’envoyé aux conjoints violents que c’est inacceptable, et puis la judiciarisation fait en sorte que ça protège à longue échéance les victimes, parce que, s’il y a bris de condition ou quoi que ce soit, ça donne une portée pour pouvoir intenter d’autres procédures. Mais il faut que le conjoint violent puisse avoir… qu’il sente vraiment qu’il y a un contrôle qui s’exerce sur lui puis qu’on le suive quand même, là, qu’il y ait un certain suivi.
Ceci étant dit, la judiciarisation, ce n’est pas la panacée, ce n’est pas la solution magique. Il y a beaucoup…
M. Fournier: …non plus, là.
Mme Bourque (Sylvie): Mais c’est une façon d’essayer de rétablir l’équilibre de pouvoir.
Mme Monastesse (Manon): L’équilibre de pouvoir qui n’est pas là.
Mme Bourque (Sylvie): Qui n’est pas là au point de départ.
Mme Monastesse (Manon): Et puis, je veux dire, quand on parle de cas, le nombre de cas aussi que les conjoints… Le conjoint violent, il a des codes très particuliers par rapport à sa conjointe, et le nombre de cas, quand ils arrivent en médiation… la conjointe sait très bien, de la façon qu’il est habillé, de la façon de mettre les clés sur la table, ça veut dire: Tu as intérêt à te surveiller parce qu’il va arriver quelque chose, parce qu’ils ont des codes comme ça que les médiateurs ne peuvent pas dépister. Et puis on l’a vu aux États-Unis, oui, les médiateurs qui interviennent en contexte de violence conjugale, ceux qui le font, ils ont tout un dispositif de sécurité, un bouton de panique, tout ça, puis ils rencontrent le conjoint violent seulement 10 fois, là, puis ils s’assurent eux-mêmes, en tant que médiateurs, d’avoir tout un dispositif de sécurité. Alors là, qu’est-ce qui arrive dehors? Et puis il y a eu un cas en Europe… Oui?
La Présidente (Mme Rotiroti): Désolée, on dépasse le temps. On va passer au côté de l’opposition, la députée de Joliette.
Mme Hivon: Merci. Bien, je vous permets de terminer, parce que c’est intéressant.
Mme Monastesse (Manon): Bien, il y a eu un cas en France où, suite à une séance de médiation, l’homme, le conjoint a tué sa conjointe suite à une séance de médiation. Parce que, pour nous, le danger, c’est qu’il y ait un faux sentiment de sécurité, et il y a eu certains sondages auprès des médiateurs et où est-ce que c’était clairement un très petit pourcentage de médiateurs qui s’assuraient d’avoir vraiment des… De s’assurer de la sécurité, ça veut dire de faire venir le conjoint en premier, la femme par la suite, tout ça. Alors, c’est très inégal, hein? Il y a à peu près 900 médiateurs au Québec, et nous, on a entendu des histoires très problématiques à travers le Québec, alors c’est pour ça que vraiment on est très… C’est vraiment quelque chose, malheureusement, qui peut difficilement s’appliquer.
Mme Hivon: Et ma dernière question, là, je comprends qu’on se situe aux confins du social et de la justice, là, mais, dans votre deuxième recommandation, vous dites: «Que le dépistage de la violence soit effectué avant le début de la médiation.» Moi, je trouve que c’est une excellente idée, mais comment on fait pour dépister ça quand on est en amont complètement du processus? Parce que c’est ça, tout le défi. Même si, évidemment, on se rend à vos arguments de dire: On exclut, comment on va savoir qu’on est en présence d’un cas de violence conjugale, quand on sait aussi tous les tabous qui peuvent entourer ça? Donc, comment on fait pour concrétiser, dans votre esprit, votre deuxième recommandation?
Mme Monastesse (Manon): Bien, je crois que tout simplement, bien, ce serait une des possibles avenues — ce n’est pas simple, là, ce n’est jamais simple — qu’il y ait un questionnaire assez simple, préalable pour dépister si vraiment on arrive… on est dans un contexte de violence. Il y aurait un questionnaire qui pourrait être soumis à la fois au conjoint et à la fois à la conjointe, qui nous permettrait… Alors, ce serait standard, c’est tous les couples, supposons, qui demandent, là, une procédure au niveau… qui font les démarches au niveau du divorce ou de la garde d’enfants. Il pourrait y avoir un questionnaire très simple et qui pourrait permettre d’identifier… Ce n’est jamais à 100 %, mais ce serait une avenue possible.
Mme Bourque (Sylvie): Bien, je pense aussi — puis ça fait partie d’une de nos recommandations — s’il y avait un message clair qui était envoyé disant que la médiation familiale n’est pas recommandée en situation de violence conjugale, déjà là, pour celles qui ont bien identifié leur situation et qui savent qu’elles sont victimes de violence conjugale, c’est une issue qu’elles fermeraient à ce moment-là, alors que, quand elles arrivent en maison d’hébergement et qu’elles disent: Je vais aller en médiation, pour elles, c’est une façon de ne pas… moins confrontante que de dire au conjoint: Mon avocat va contacter ton avocat. Elle pense que… Son désir, c’est toujours que ça se passe le mieux possible. Et, quand on leur explique de quelle façon ça va se dérouler, elles changent d’idée. Donc, je pense que d’envoyer ce message clair — et ce n’est définitivement pas le message qui est envoyé jusqu’à maintenant de la part de la médiation familiale — si on envoie le message clair que ce n’est pas recommandé dans cette situation-là, je pense que, déjà là, il y aurait un bassin de situations qui ne se retrouveraient pas là.
Et, je dirais, pour répondre un peu à votre question, M. le ministre, le rôle du ministère de la Justice, quant à moi, dans les situations de violence conjugale, c’est d’essayer de rétablir ce rapport de force là, et, en ce sens — puis là j’amène un autre dossier, mais quand même je me permets de le lancer — toute la question des droits d’accès supervisés, je pense que ça aussi est un enjeu majeur dans les contextes de violence conjugale, de séparation en contexte de violence conjugale, parce que ça met encore les gens à risque, les femmes et les enfants à risque. Et je pense qu’à ce niveau-là le ministère de la Justice peut jouer un rôle aussi essentiel, dans cet aspect-là de séparation en situation de violence conjugale, et c’est dans ce sens-là que je vois le rôle du ministère de la Justice de rétablir le rapport de force. Et, si monsieur éventuellement prend conscience de sa situation et décide de se prendre en main et d’aller chercher de l’aide, bien tant mieux, mais c’est sûr que le premier message, c’est que la violence conjugale, c’est criminel, et le ministère de la Justice est là dans cet aspect-là des choses.
Une voix: …
Mme Bourque (Sylvie): …des droits d’accès.
La Présidente (Mme Rotiroti): Bon. Bien, merci beaucoup à la Fédération des ressources d’hébergement pour les femmes violentées et en difficulté du Québec. Merci pour votre mémoire et votre présentation.
On va suspendre quelques minutes pour qu’on puisse placer l’Association du Barreau canadien, division Québec. Merci.
(Suspension de la séance à 15 heures)
(Reprise à 15 h 3)
La Présidente (Mme Rotiroti): Nous allons poursuivre sans plus tarder les audiences. Je voudrais saluer l’association… Attendez, on a un petit problème technique. Bon. Alors, comme je disais, je voudrais saluer l’Association du Barreau canadien, division Québec. Je vous rappelle que vous avez 15 minutes pour exposer votre présentation. Par la suite, on va passer à une période d’échange de 10 minutes de chaque côté.
Alors, est-ce que c’est toujours M. Pierre Giroux qui va commencer, qui va prendre la parole?
Association du Barreau canadien,
division Québec (ABC-Québec)
M. Leduc (Antoine): C’est Me Antoine Leduc qui va commencer.
La Présidente (Mme Rotiroti): Parfait. Alors, on va débuter avec Me Leduc, et, par la suite, si vous pouvez présenter les gens qui vous accompagnent aussi pour les fins d’enregistrement, s’il vous plaît.
M. Leduc (Antoine): Très bien.
La Présidente (Mme Rotiroti): La parole est à vous.
M. Leduc (Antoine): Mme la Présidente, M. le ministre, Mmes, MM. les députés, nous sommes honorés d’être ici devant vous aujourd’hui au nom de l’Association du Barreau canadien, division Québec. Et je voudrais vous présenter les membres du Comité de la législation et de la réforme du droit de notre association qui sont ici présents aujourd’hui: alors, à mon extrême gauche, vous avez Me Ann Soden, qui est une spécialiste dans le domaine du droit des aînés et qui a été présidente fondatrice de la section Droit des aînés au niveau national, pancanadien: à mon extrême droite, vous avez Me Sylvie Leduc, qui est une avocate spécialisée dans le domaine du droit de la famille; le coprésident de notre comité sur la législation et réforme de droit, Me Pierre Giroux, un spécialiste du droit des affaires municipales, questions de droit public, droit administratif: à ma gauche, Me Babak Barin, qui est un avocat spécialisé dans le domaine de l’arbitrage, de la médiation et des modes alternatifs de résolution des conflits; et je suis Me Antoine Leduc, le coprésident de ce comité, spécialiste en litige commercial, faillite, insolvabilité et droit bancaire.
Alors, aujourd’hui, nous attendions avec impatience cette occasion de pouvoir échanger avec vous sur ce projet de réforme du Code de procédure civile qui, aux yeux de notre association, présente le plus grand intérêt. Il y a évidemment des éléments qui méritent d’être salués — j’y viendrai — dans ce projet de réforme, mais il y a d’autres éléments qui suscitent jusqu’à un certain point l’inquiétude de notre association. Et bien sûr nous sommes d’accord avec la volonté exprimée par le législateur d’accélérer les délais de la justice civile, de faire en sorte que sa qualité et que le caractère proportionnel de la justice civile soient respectés, mais nous nous questionnons sur la façon dont le gouvernement s’y prend dans cet avant-projet de loi et nous espérons faire des suggestions qui permettront de bonifier, le cas échéant, le projet de loi.
À cet égard, la première source d’inquiétude tient dans les premières dispositions de votre projet de loi, et je commencerai en traitant brièvement de la disposition préliminaire et des dispositions 1 à 7, où l’on nous indique une certaine hiérarchisation des modes de règlement des conflits où on pourrait penser, à la lecture de ces dispositions, que dorénavant ce sont plutôt les modes alternatifs de résolution des conflits qui occuperont l’avant-scène, et la justice civile sera reléguée au second plan.
Source d’inquiétude additionnelle dans le fait qu’on invite maintenant les parties à choisir la méthodologie qui s’appliquera au règlement de leurs litiges, sans nécessairement qu’il s’agisse du respect de la règle de droit, et, pour ce faire, on invite les parties à consulter un tiers. Alors, on soumet respectueusement au législateur que de telles mesures ouvrent probablement la porte à des dérives qui ne sont pas imaginées dans le cas actuel, mais on pourrait penser que des parties choisissent de régler un litige privé auprès d’un tiers qui serait peut-être un membre représentant d’une autorité religieuse ou ecclésiastique, selon les critères de ce droit ecclésiastique. Et, même s’il y a certaines balises qui sont prévues dans l’avant-projet de loi pour faire en sorte que l’on s’assure que les modes privés de règlement des conflits respectent les droits et libertés de la personne, à l’aune de ce critère nous vous soumettons qu’il risque d’en découler plus d’incertitude, du moins dans les premiers temps, et que c’est peut-être une boîte de Pandore qu’il vaut mieux ne pas ouvrir.
En ce qui concerne la gestion de l’instance, évidemment, dans le 15 minutes qui nous est imparti, il est impossible d’aller dans le détail, mais nous allons exploiter quelques idées maîtresses, et la première a trait à la question du protocole de l’instance, où on invite les procureurs, à la phase initiale des procédures, à s’entendre entre eux et entre les parties pour fixer à un degré assez avancé tous les éléments qui devront être considérés pour mettre la cause en état, alors qu’on est seulement dans les 30 premiers jours de l’instance. Alors, on vous soumet que, dans un tel contexte, c’est peut-être précipiter les choses et, selon notre expérience pratique, on ne pense pas que c’est réaliste. Dans un tel contexte, on risque peut-être même de bafouer les droits des parties à un procès juste et équitable et à l’administration de la preuve.
Dans les éléments aussi à retenir concernant les mesures préalables, mentionnons toute la question de l’expertise, l’expertise unique qui est favorisée et qui pourrait être ordonnée par le tribunal. Nous avons de sérieuses réserves à l’égard de cette proposition et nous doutons de la constitutionnalité même d’une telle proposition. Si l’expertise unique, bien sûr, est de consentement des parties, nous n’avons pas d’objection, mais il faudra s’assurer de bien la baliser et de faire en sorte que le processus contradictoire qui est à la base même de notre procédure civile soit respecté. D’ailleurs, vous verrez, dans le mémoire que nous vous avons soumis, que nous avons obtenu à cet effet un avis juridique du constitutionnaliste réputé le Pr Henri Brun, de la Faculté de droit de l’Université Laval, qui va exactement dans ce sens-là.
En ce qui concerne aussi les mesures préalables, il y a la question, évidemment, de la défense orale. On érige en principe la question de la défense orale et on n’a pas nécessairement de critère qui soit aussi précis que dans le code actuel. Nous soumettons qu’il faudrait peut-être songer à retourner aux critères qui sont dans le code actuel, parce qu’ils sont objectifs, et à permettre aux parties, de consentement ou selon l’autorisation du tribunal, de pouvoir produire une défense écrite.
**(15 h 10)**
En ce qui concerne les interrogatoires, évidemment, les objectifs d’accès à la justice et de favoriser le règlement des litiges ne seront pas accomplis, puisqu’on retourne à des règles antérieures à la réforme de 2003 faisant en sorte que les interrogatoires préalables seront produits par l’une ou l’autre des parties de leur plein gré. Autrement dit, la partie qui interroge n’aura pas la latitude voulue ou la discrétion requise pour ne pas produire son interrogatoire, et les interrogatoires préalables sont des occasions assez importantes de règlement des litiges dans nos pratiques quotidiennes. Alors, nous sommes un peu sceptiques devant l’utilité de ces mesures.
En ce qui concerne le droit de la famille, un élément positif à souligner: les conjoints de fait vont désormais pouvoir intenter tous leurs recours dans une seule et même procédure, alors que, dans l’état actuel du droit, ce n’est pas le cas. Alors, l’Association du Barreau canadien salue cette innovation.
Par contre, il faudrait prendre garde à ne pas augmenter le nombre de formulaires ou de documents administratifs qui doivent être remplis par les parties. La réforme actuelle tend plutôt vers l’inflation, alors on invite le législateur à plus de circonspection dans ce domaine.
En droit administratif, nous saluons également le fait que tous les recours en contrôle judiciaire font maintenant l’objet d’une procédure simplifiée. C’est un progrès important qui mérite d’être souligné.
En ce qui concerne les procédures en matière non contentieuse, on prône la simplification des procédures, mais simplifier les procédures dans un tel contexte où… Les personnes qui sont en perte d’autonomie ou qui doivent faire l’objet de mesures de protection, simplifier la procédure se ferait probablement au détriment de leurs droits, et notre association croit plutôt qu’on devrait aller, dans ce contexte bien précis, vers une médiation obligatoire qui permettrait à toutes les expertises d’être entendues, parce que c’est un cas où les sensibilités sont souvent à fleur de peau.
Enfin, avant de céder la parole à mon associé, à mon collègue Babak Barin qui va vous parler d’arbitrage brièvement, nous déplorons l’aspect de la réforme concernant les ventes sous contrôle de justice et le fait qu’un monopole soit maintenant conféré aux huissiers de justice pour administrer cette procédure des recours hypothécaires et qui est beaucoup plus lourde et qui sera beaucoup plus coûteuse que la procédure actuelle, qui est d’ailleurs elle-même en pratique, pour votre information, considérée trop lourde, du moins en droit commercial, qui fait en sorte que les praticiens optent plutôt maintenant pour des recours en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, parce qu’on n’est pas assujettis à toutes les contraintes et à tous les délais qui sont prescrits par le Code civil et le Code de procédure civile.
Alors, voilà, de façon très succincte, un panorama des commentaires de notre association. Je cède maintenant la parole pour quelques minutes à mon collègue Babak, qui va vous expliquer la position du Barreau concernant l’arbitrage.
La Présidente (Mme Rotiroti): Juste avant que vous commenciez, il vous reste cinq minutes pour votre présentation.
M. Barin (Babak): Mme la Présidente, M. le ministre, Mmes et MM. les députés, je vous remercie, de ma part aussi, de nous avoir accordé l’occasion d’être devant vous cet après-midi. Je vais, comme mon collègue vous a mentionné, me limiter sur des dispositions qui concernent l’arbitrage et la médiation et j’aurai deux commentaires à vous faire.
La réforme, selon nous, du droit de l’arbitrage conventionnel, en 1986, a mené à l’adoption d’un texte moderne fort semblable à celui de la loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, et le livre VII, titre I et titre II, sous la rubrique des arbitrages, demeure aujourd’hui, selon nous, malgré certaines faiblesses et lacunes que la jurisprudence a su pallier en grande partie depuis cette réforme, un texte non seulement convenable, mais tout à fait satisfaisant et apte à répondre aux besoins de ses utilisateurs. De notre avis, la réorganisation proposée par l’avant-projet aura pour effet de créer une incertitude, une confusion et une discorde sur l’interprétation à donner à certaines dispositions et aussi de fragiliser par le fait même la volonté des parties d’avoir recours à l’arbitrage. Selon nous, il serait préférable de maintenir le statu quo tout en apportant quelques modifications qui sont essentielles.
En ce qui concerne les dispositions qui sont liées à la médiation, les dispositions applicables à la médiation comme telle ne font aucune référence à la loi type, encore, de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international sur la conciliation qui a été préparée par cette commission en 2002. Il serait donc, de notre avis, dommage de procéder à une révision de notre Code de procédure civile sans avoir aucune référence à tel instrument. Et je peux vous dire que, personnellement, j’étais là en tant qu’un des représentants du gouvernement du Canada, lors de ce débat et la préparation de ce document, et ces documents ne s’appliquent pas seulement à des conciliations ou des médiations internationales, donc il y a beaucoup d’utilité qu’on peut y avoir ou sortir de ces documents.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. On va passer du côté ministériel pour la période d’échange. M. le ministre.
M. Fournier: Oui, merci. Merci à vous d’être avec nous pour contribuer à l’amélioration de ce projet, de cet avant-projet qui est en élaboration depuis au moins une dizaine d’années, sinon plus, qui a permis aux différents intervenants et au ministère de la Justice de discuter et d’avoir des échanges avec autant la magistrature, les huissiers, les notaires, évidemment le Barreau tout au cours du temps. Et puis, pour ceux qui n’avaient pas eu l’occasion, bien l’avant-projet de loi permet de réentendre. Donc, on a, je crois, la formule la meilleure pour pouvoir entendre tous ceux qui ont à intervenir sur le dossier — et on le fait avec beaucoup de plaisir — et permettre à chacun de venir justement livrer un peu comment il voit les choses. Je note qu’il y a certains éléments sur lesquels vous êtes intervenus, par exemple sur l’arbitrage… Vous avez sans doute suivi les travaux la… pas la semaine dernière, la semaine d’avant, et je dirais qu’on a eu une présentation substantielle sur le sujet, qui a fait sa marque, je dirais, donc on va y porter une attention toute particulière; certains éléments aussi qui ont été mentionnés sur les effets positifs en fonction de règlements qui peuvent intervenir suite à des interrogatoires, qui permet donc de remettre… de se reposer des questions sur la façon dont tout ça a été conçu, ce qui fait donc que je suis en train de vous dire qu’on écoute pas mal ce qui nous est dit pour voir comment on peut les adapter.
Je vais donc, une fois que je vous ai dit ça, m’arrêter à… Je note pour l’administratif et pour la famille, mais, pour le reste, que des problèmes. Alors, on va s’intéresser aux problèmes en commençant peut-être par le premier, qui est le coeur un peu de tout ça. Vous avez vu l’Observatoire du droit à la justice, là, qui est venu ce matin et d’autres la semaine dernière qui sont, je dirais, de l’école de plus en plus répandue et de laquelle nous voulons être, celle de la justice participative, qui n’enlève pas les droits de cité de la justice adjudicatrice.
Ceci étant, je vais m’arrêter sur une chose. Vous décelez — et vous n’êtes pas les seuls — vous décelez dans le choix volontaire qui a été fait de mettre d’entrée de jeu la possibilité à des recours alternatifs, à des modes de règlement alternatifs… vous y voyez une certaine forme de hiérarchisation, vous y voyez que ça puisse porter atteinte, hein, à la justice adjudicatrice. On peut regarder le début, on peut le voir dans l’ordre chronologique aussi, hein? Je vous le soumets comme ça, puis on échange. On peut voir ça dans l’ordre chronologique, c’est-à-dire qu’on n’est pas obligé d’aller tout de suite devant le juge, on peut envisager d’autres méthodes, d’où l’idée ici de le mettre à ce point-là dans le code qui est dans un continuum, on peut passer à cette étape-là en premier. Parce qu’on peut aussi calculer le nombre d’articles et puis se rendre compte que, pour ce qui est de la justice… appelons-la plus traditionnelle — quelqu’un est venu nous parler de la crémeuse et de la traditionnelle — la justice plus traditionnelle, si on compte le nombre d’articles, c’est difficile de vous suivre et de prétendre qu’ici il y a un choix qui est fait de s’éloigner de la justice traditionnelle.
Alors, je ne sais pas comment vous pouvez commenter mes propos, parce que moi, je crois qu’on fait le bon geste et que ça n’enlève pas l’importance à donner à la justice adjudicatrice.
**(15 h 20)**
M. Leduc (Antoine): Alors, M. le ministre, merci pour cette question. Évidemment, comme on l’a dit dans notre document et on vous le réitère aujourd’hui, l’Association du Barreau canadien n’est pas contre le principe de la justice participative, mais, de la façon dont les dispositions sont rédigées, elles laissent entendre — et les notes explicatives aussi de l’avant-projet de loi vont dans ce sens-là — que les parties auraient au moins l’obligation de considérer les méthodes alternatives de résolution des conflits. Et, évidemment, nous, nous n’avons pas d’objection, puis je pense que je parle au nom de mes collègues en vous faisant l’affirmation suivante: On règle à peu près la majorité de nos causes. Alors, les plus problématiques, c’est évidemment celles qui restent devant les tribunaux, mais il y a des causes qui ne peuvent pas, ab initio, faire l’objet d’une discussion de règlement. Vous avez, par exemple, des parties — et ça arrive plus souvent qu’on le pense — qui sont de mauvaise foi, et vous avez un droit que vous voulez faire sanctionner, et vous savez d’ores et déjà que, si vous appelez l’avocat de la partie adverse ou si vous prévenez la partie adverse de votre intention de faire sanctionner votre droit, non seulement il n’y aura pas de discussion possible, mais vous allez peut-être risquer de perdre l’occasion d’exercer vos droits, par exemple dans les matières qui nécessitent des injonctions. Souvent, quand on doit recourir aux tribunaux, ça se fait même de manière ex parte, c’est-à-dire sans que l’autre partie soit même prévenue, parce qu’il y a péril en la demeure et il y a un préjudice probablement irréparable qui va s’ensuivre. Et, à ce moment-là, la question que nous, on vous pose, comme législateurs, c’est de savoir: Est-ce que les parties vont être obligées d’arriver devant la juge et de dire: Bien, M. le juge, là, je suis en injonction, il est 1 heure du matin, pouvez-vous m’émettre l’injonction pour demain matin? Et là le juge va lui faire le commentaire suivant: Mais avez-vous appelé le collègue et puis est-ce qu’il a été prévenu? Bien, je ne peux pas vous entendre.
Jusqu’où ça va aller, cette modulation-là, en autant que la justice participative veuille dire que ça se fait sur une base consensuelle et volontaire et que le juge ne saurait forcer les parties d’y recourir, surtout dans les cas où c’est impossible de penser y aller? C’est là notre préoccupation et c’est dans ce sens-là que nous vous mettons en garde contre une possible interprétation par les juges qui ferait en sorte qu’on repousse les parties et on les envoie soi-disant faire leurs devoirs parce qu’il y aurait probablement une meilleure façon de résoudre le problème.
Et le dernier argument que je ferai — et, si on a encore quelques minutes, je laisserai peut-être la parole à mon collègue Babak Barin, qui est spécialiste des modes alternatifs — je vous dirais que le droit est important. Les modes alternatifs, c’est bien, mais l’idée de faire sanctionner un droit, c’est aussi important. Et l’idée d’avoir accès à un juge indépendant, quels que soient les motifs des parties, c’est un principe fondamental de notre société démocratique.
M. Fournier: Si vous me permettez — parce que je sais qu’on va me couper — juste revenir là-dessus, parce que c’est le verre à moitié plein, à moitié vide ou trop plein ou trop vide, là. Vous êtes pour la justice participative. En même temps, la façon dont vous me la nommez, vous me dites: Il y a l’injonction puis peut-être un tas d’autres inconnues, qui fait que finalement, vous savez, M. le ministre, la vraie justice, c’est le juge. Moi, je ne pense pas que c’est la vraie justice, je pense que la justice peut s’exprimer différemment.
Mais ce qui m’intéresse, là, d’aller pointu, là: ce qu’on veut, c’est considérer. Ça ne veut pas dire entrer dans la danse, là, je le disais un peu plus tôt. C’est considérer est-ce que c’est possible ou pas.
Est-ce que juste ça, vous trouvez ça abusif? Est-ce que de prévoir une exception ou quelques exceptions que vous pouvez nous conseiller… Par exemple, l’injonction, vous dites: Bien, voilà, là il y a un cas où il y a problématique. Est-ce qu’il y en a d’autres? Est-ce que vous pouvez nous servir d’écho des problèmes qui sont posés ici plutôt que de dire: Oui, c’est bien, mais, dans le fond, laissez ça comme c’est présentement?
M. Leduc (Antoine): Bien, c’est-à-dire que, M. le ministre, quand on dit qu’il n’y a pas qu’une seule forme de justice, il faut faire bien attention quand on s’embarque sur ce terrain-là, parce que c’est un terrain assez glissant. Il y a des gens aujourd’hui qui sont les tenants, au point de vue de la théorique juridique, de ce qu’on appelle le pluralisme juridique — on a sûrement vu ça dans les textes qu’on vous a soumis — qui fait en sorte que, le droit, ce n’est pas le législateur qui a le monopole de ça puis ce n’est pas les juges qui ont le monopole de ça.
Alors, vous nous demandez de vous dire, M. le ministre: Est-ce qu’on ne devrait pas plutôt y aller avec le projet de loi tel qu’il est puis prévoir un certain nombre d’exceptions? Nous, ce qu’on vous soumet et, ceci dit, respectueusement, c’est que c’est l’inverse. L’exception, dans une société libre et démocratique, ce sont les modes alternatifs de résolution des conflits, qui ont leur utilité, le Barreau en est, mais pourquoi essayer de réinventer la roue dans un système qui est supposé de sanctionner les droits, qui sont l’expression d’une volonté populaire et démocratique dont le législateur est le dépositaire? C’est ça, le point de vue du Barreau.
M. Barin (Babak): Tout simplement ajouter que je pense que, comme vous l’avez mentionné vous-même, M. le ministre, il y a aussi une problématique avec la définition de «considérer». Je veux dire, considérer, pour quelqu’un, peut être quelque chose; pour quelqu’un d’autre, ça pourrait être d’autre chose.
Et, là-dessus, quand vous avez des avocats et surtout des bons plaideurs, bien vous pouvez aussi ajouter «suffisamment considérer». Alors, à ce moment-là, qu’est-ce qui a été suffisamment considéré ou pas, à quel moment? Moi, je peux vous dire qu’en pratique vous allez pouvoir trouver des gens très créatifs qui vont vous arriver en disant: Oui, il y avait cette intention entre les parties, voici ce que le code dit, mais, bon, on a considéré, mais on n’a pas vraiment suffisamment considéré ces méthodes alternatives de différend. Alors là, déjà vous avez un litige qui est né, qui s’augmente juste à savoir si vous avez eu assez de temps pour négocier ou non. Alors, ça, c’est le genre de chose qui, dans tous les cas, peu importe que ce soient des injonctions ou d’autres exemples, va vous créer ou créer pour des parties des différends qui ne sont pas nécessaires, selon nous.
M. Fournier: Alors, pour vous, il n’y a pas de moyen que vous pouvez nous suggérer pour amener les gens à essayer de participer eux-mêmes à régler leurs conflits, si tant est que, comme on nous le dit, la société est prête à ça, que les gens veulent bien avoir des moyens et aller vers l’arbitrage ou la médiation, mais le législateur ne devrait pas prévoir des dispositions comme celle-là, c’est ce que je comprends, parce que, dans le fond, ça va bien. C’est ça?
M. Leduc (Antoine): Bien, c’est-à-dire qu’avec respect, M. le ministre, vous avez déjà bien fait votre travail. Le législateur a déjà prévu, entre autres, dans le code de déontologie qui nous régit, des principes qui font en sorte que les avocats doivent, en autant que possible, se faire les amiables compositeurs et doivent forcer ou encourager les parties à considérer toutes les solutions, et c’est ce que les avocats font déjà dans l’exercice de leur profession. Je ne vous dis pas que tout est parfait dans le système actuel, mais en même temps on a un système qui fonctionne plutôt bien, malgré certains constats qui peuvent faire l’objet de longues discussions à d’autres égards.
M. Barin (Babak): Je peux aussi ajouter, si vous me permettez, le fait que je pense que, dans tout ça, l’éducation, que ça soit du public, que ça soit, si vous voulez, les parties, que ça soit des avocats ou que ça soit des juges, fait une grande sorte, et ça va probablement être une des choses les plus importantes à considérer. Je peux aussi vous dire que, par exemple, au Barreau du Québec, depuis un an et demi maintenant — ça, c’est la deuxième année — il y a un dossier qui est offert, il y a un dossier de maître, ce qu’on appelle un dossier de maître, c’est un dossier de l’arbitrage qui est offert aux jeunes, des jeunes avocats qui sortent de l’école de droit et qui veulent devenir des praticiens. Donc, ils ont le choix de choisir ce mode, si vous voulez, de résolution de conflits là où il n’était pas présent il y a deux ans. Donc, il y a des efforts qui se font tant au Barreau qu’à l’extérieur qui pouvaient simplement aider ce genre de chose, si vous voulez.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. On va passer la parole à l’opposition officielle, à Mme la députée de Joliette et porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice.
Mme Hivon: Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, à mon tour de vous remercier de votre présentation, de votre mémoire fort étoffé.
Écoutez, vous plaidez très bien votre cause, mais je vous ferais un parallèle. En fait, vous nous dites que le système fonctionne très bien, le droit fonctionne bien, effectivement le législateur doit, via les instruments de droit, refléter les valeurs, bon, de la société, et tout, mais je vous ferais le parallèle avec le monde de la santé. On dit souvent que le problème, dans le monde de la santé, ce n’est pas pour ceux qui ont accès puis qui ont des services, que la satisfaction est assez grande quand on se rend et qu’on a des services, qu’on passe à l’urgence, bon, tout ça. Le problème, c’est pour ceux qui n’ont pas accès. C’est ceux qui n’ont pas de médecin de famille, c’est ceux qui attendent 27 heures à l’urgence, c’est ceux qui n’arrivent pas à avoir des soins en temps utile ou qui attendent une chirurgie pendant deux ans. Moi, je vous dirais: Peut-être que le système, il fonctionne bien pour ceux qui peuvent avoir recours aux services d’un avocat, qui sont capables de se payer cette justice, je dirais, traditionnelle et que c’est conforme un peu à la manière dont ils conçoivent les choses, mais qu’est-ce qu’on fait de tous les gens qui n’ont pas accès et qui, pour eux, quand un problème juridique leur tombe dessus ou qu’ils anticipent un problème juridique, c’est le stress, c’est l’angoisse parce qu’ils n’ont pas les moyens?
Donc, je pense qu’il y a un peu ça dans la philosophie qui est souhaitée, c’est un peu de se dire: Les gens ont souvent le sentiment — c’est ce qui nous est rapporté — de perdre le contrôle, une fois qu’ils sont entrés dans le cadre du processus judiciaire, sur les délais, sur les coûts, qu’ils n’ont plus la mainmise sur leurs procédures. Donc, jumelé au fait du problème d’accès, on peut se dire que peut-être que c’est souhaitable que les gens puissent prendre en charge dans une certaine mesure ou quand c’est possible leurs conflits, parce que le but de tout ça, oui, il y a le droit, mais il y a la justice et il y a de trouver une solution à un problème.
Donc, peut-être qu’effectivement c’est un changement un peu de philosophie, mais, compte tenu des problèmes que l’on vit, est-ce que vous ne pensez pas que c’est sain de considérer ces enjeux-là?
**(15 h 30)**
M. Giroux (Pierre): Est-ce que les gens vont avoir davantage les moyens, dans l’exemple que vous donnez, de payer? Parce qu’il va falloir payer les arbitres ou des médiateurs, conciliateurs, appelez-les comme vous voulez. Il va falloir les payer. Alors, est-ce que le règlement des conflits au moyen des modes alternatifs est une solution moins onéreuse pour les personnes? Je n’en suis pas sûr.
Actuellement, on n’a pas besoin de… évidemment on va payer un avocat, puis encore ce n’est pas obligatoire, il y a des gens qui se représentent eux-mêmes, mais on n’a pas à payer le juge, on le paie indirectement par nos taxes. Mais, dans la pratique ou la mise en oeuvre de règlements des conflits au moyen de modes alternatifs, il va falloir que quelqu’un débourse. Alors, ces gens-là qui n’ont pas les moyens de s’adresser à la justice dans le système traditionnel, je ne vois pas comment ils vont avoir davantage les moyens de le faire en ayant à payer soit pour un arbitre, un médiateur ou un conciliateur.
Mme Hivon: Vous ne pensez pas que les autres modes… Je suis bien d’accord qu’il y a des causes d’arbitrage excessivement complexes et qu’on n’est pas dans le même cas, mais il y a des causes, évidemment, beaucoup moins complexes qui peuvent être tout à fait indiquées pour un mode de médiation, pour une conciliation. Vous ne pensez pas que, dans ces cas-là, ça peut être souhaitable parce que ça va être plus rapide, donc peut-être moins coûteux, moins lourd en termes de procédure, moins de stress pour les parties parce qu’elles ne seront pas dans un processus qui va durer des années? En fait, ma question est simple. Je comprends que vous avez certaines réserves par rapport à peut-être l’accent qui est mis sur ces modes de règlement alternatifs au début du code. Moi, ce que j’essaie de voir, c’est: Est-ce que vous estimez qu’ils ont quand même leur place et qu’ils doivent être reconnus dans le nouveau code?
M. Giroux (Pierre): Ils doivent être reconnus, mais moi, en tout cas, je dis ceci: Il ne faudrait pas que le justiciable, qu’il soit représenté ou non lorsqu’il s’adresse à la cour, doive en quelque sorte s’excuser de ne pas avoir pu régler autrement son litige par des discussions, des négociations, des tractations, la conciliation, la médiation, etc. Alors, il y a quand même un droit d’accès à la justice, et c’est ça qu’on veut préserver, mais on n’est pas contre l’existence des modes alternatifs de règlement des conflits. Mais il ne faudrait pas que ça devienne non pas le mode alternatif mais que ça serait le mode principal et que la justice publique serait le mode subsidiaire.
Mme Hivon: Je vous comprends bien. Ça m’amène à l’article 5 — donc je suis très contente, vous en parlez, parce que plusieurs l’effleurent sans entrer dans le détail, là — qui fait référence aux normes autres que le droit. Je comprends que vous avez certaines inquiétudes, notamment en lien avec les normes religieuses. Vous l’avez exposé d’ailleurs, Me Leduc, dans vos remarques, dans votre présentation.
Tout à l’heure, je posais ces questions-là, je faisais part qu’il pouvait y avoir des inquiétudes à savoir ce que pouvaient être ces normes autres que le droit. Je posais les questions à l’Observatoire du droit à la justice, et ils me disaient: Mais rien n’empêche déjà, dans l’ordre actuel des choses, que certaines personnes aient recours, par exemple, à leur curé pour régler un problème ou aient recours à une autre instance qui est plus communautaire.
Donc là, je pose la question de l’autre angle, puisque vous défendez l’autre position, mais, à l’article 5, pour vous, quel est le problème de l’écrire dans le code plutôt que de dire: En fait, on vient juste écrire quelque chose noir sur blanc qui existe déjà?
M. Leduc (Antoine): Bien, si vous me permettez, Mme la députée de Joliette, je pense que, ce faisant, on tente de déboulonner peut-être une des dernières statues qu’il nous reste ou une des dernières institutions fondamentales de la société, en ce sens que ce n’est pas parce qu’on a déjà un mode de règlement informel qui existe que ce mode-là doit être entériné par le législateur, parce qu’à ce moment-ci, nous, notre crainte, c’est que c’est le début de l’effritement de ce système public. Et le système public de justice avec des juges indépendants, impartiaux qui permettent d’assurer les garanties de justice fondamentale, c’est probablement une des innovations les plus dignes de mention et dont l’Occident a été, dans sa tradition, le plus fier représentant. Ça, ce n’est pas moi qui le dis, il faut lire Jacques-Yvan Morin et il faut lire Guy Rocher, même, un sociologue du droit qui a écrit des articles sur les ordres juridiques. Il dit: C’est tout à fait normal que les sociologues s’intéressent à ces autres manifestations là des normes, mais le juriste ainsi que le législateur n’en sont pas là. On est ici pour parler des valeurs qui nous unissent et qui font en sorte que c’est le vivre-ensemble qui va s’exprimer dans notre société.
Les sociétés où vous n’avez pas un système de justice public qui fonctionne sont des sociétés problématiques, qui ne connaissent pas, en tout cas, la démocratie comme nous, nous la connaissons et qui sont des entraves à toutes les libertés que vous pouvez imaginer et au commerce. Prenez, par exemple, les pays qui sont en voie de développement, le cas de l’Égypte, par exemple, où vous n’avez pas nécessairement un système de justice qui est parmi les plus faciles au monde. Et ce sont des problèmes auxquels sont aux prises tous les pays en voie de développement et pour lesquels les organisations internationales, dont la Banque Mondiale et le Fonds monétaire international, déploient des efforts considérables justement pour faire en sorte qu’on passe de ces modes informels pour aller à ces modes plus formels, et qu’ils soient reconnus, et que les gens décident de vivre et d’obéir à la sanction du pouvoir judiciaire plutôt que de se faire justice eux-mêmes. Et ce sont là les principes qui sont des principes fondamentaux dans notre société, que nous sommes venus vous rappeler avec beaucoup de déférence aujourd’hui.
M. Barin (Babak): Mme la députée de Joliette, si vous me permettez, pour ajouter quelque chose d’autre, je ne pense pas que personne au sein du Barreau canadien, à Québec, est contre un mode alternatif de différend. Je pense que ce qui est problématique et ce qui devient de plus en plus délicat, c’est quand on essaie de légiférer, si vous voulez, le consensualisme, hein, ce qui est consensuel entre les parties, quand on essaie de le légiférer.
Là, vous avez posé une question à propos de l’article 5. Si vous voulez, ce à quoi je peux vous référer, c’est l’article 2639 du Code civil du Québec. Si vous considérez ce que 2639 du Code civil vous dit, 2639 ne permet pas à certains sujets d’être assujettis à l’arbitrage. Alors, ça, c’est la disposition du Code civil qui ne permet pas à une partie de soumettre certaines disputes à l’arbitrage, dont les questions de famille, les questions de capacité, les questions qui intéressent l’ordre public.
Alors, ce que je vous demande: Si on considère l’article 5 comme tel qu’il est, les parties peuvent prévenir ou régler des différends en faisant appel à des normes et des critères autres que ceux du droit. Alors, est-ce que cet article-là n’empiéterait pas sur 2639? Et est-ce que les bons avocats, les bons plaideurs et d’autres que je vous avais mentionnés ne peuvent pas utiliser 2639 avec l’article 5 pour en faire en sorte que, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir être capables d’assujettir certaines disputes à l’arbitrage? C’est des questions que je vous pose, puis je pense que ça mérite une réflexion.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. On passe la parole au ministre de la Justice.
**(15 h 40)**
M. Fournier: Je vous ai entendus sur le bon plaideur, et tout ça, puis je pense qu’effectivement on peut interpréter les articles. Par contre, d’alléguer qu’on assiste ici à une première étape d’effritement de notre système judiciaire tel qu’on le connaît et que ça nous ramène des siècles en arrière, permettez-moi de vous dire en toute déférence que je trouve ça un petit peu exagéré. Je ne sais pas comment vous pouvez arriver à le dire, mais je l’ai bien entendu. Et, encore une fois, ici, puis je peux bien… Puis on est en avant-projet de loi, on cherche à améliorer, mais on peut aussi réagir quand on qualifie le projet qui est devant nous de recul historique, d’effritement d’un système dont l’objectif ici est de le redonner aux citoyens. Premier constat.
Le Barreau du Québec — je ne sais pas si vous y concourez — appelle ça le décochage judiciaire, ce à quoi nous assistons. Les corporations utilisent les tribunaux; les citoyens, de moins en moins, parce qu’il y a un problème d’accès, il y a un problème de coût. Devant cet état de fait, les citoyens veulent se redonner une justice, veulent y avoir droit. Alors, il y a un appétit partout, pas juste au Québec, un appétit partout pour… découlant de l’empowerment, puis tout ça. Les citoyens veulent avoir une justice dans laquelle ils participent un peu plus. L’Observatoire du droit nous rappelait un peu plus tôt que, les gens, ce n’est pas nécessairement d’avoir leur journée à la cour qu’ils veulent mais de régler leurs problèmes, et je crois à cela. L’objectif ici, c’est aussi d’assurer qu’on règle les problèmes, et il n’y a pas qu’un juge pour régler des problèmes. D’ailleurs, il y a plein de dossiers qui ne vont jamais à la cour parce que les gens s’entendent, et le législateur peut très bien porter comme message qu’il encourage les gens à s’entendre, et ce n’est pas effriter la justice ou le système de justice traditionnel. Je fais juste le dire comme ça.
Puis, sur les libellés, on peut s’entendre. Je crois que, sur la nature même de l’initiative qu’est cet avant-projet de loi, il y a une qualification que vous avez utilisée qui ne me semble pas appropriée par l’objet même de l’avant-projet de loi. Et, même lorsqu’on veut plaider et qu’on ajoute des mots comme «suffisamment considérer», ajoutez-en deux autres, et puis on arrive à l’effritement. Mais, si on regarde ce qui est écrit — et encore qu’on peut le bonifier — quand on sait que l’intention n’est pas de détruire un système, bien on part sur une base autre et on dit: Bien, comment on peut libeller?
Ma collègue de Joliette soulève des questions sur l’article 5 très fondées. On a eu un aperçu de la réponse par l’Observatoire du droit. Dans le fond, les gens nous disent: Si on ne va pas à la cour puis qu’on s’entend sur des critères familiaux, sur des usages domestiques — l’exemple nous était donné — est-ce qu’il faut ne pas reconnaître ce genre d’entente là? Je veux dire, si les gens veulent s’entendre, qui est-on pour imposer la sanction législative ou judiciaire quand des parties consentent, quand ce n’est pas contraire à l’ordre public, là, on se comprend, là?
Alors, j’oserais presque continuer. Lorsque vous procédez à des arbitrages, parce que telle est votre spécialité, est-ce que tout se décide en fonction de la règle de droit? Est-ce que d’autres considérations peuvent… Est-ce qu’il y a des compromis, par exemple? Une partie qui pense qu’elle aurait un droit entier mais finalement accepte pour quelque chose d’autre, est-ce que c’est condamnable?
M. Barin (Babak): Si je peux me permettre, oui, il y a plusieurs considérations qui sont tenues lorsque vous êtes dans un arbitrage, mais, en fin de compte — vous le savez mieux que moi — si votre arbitrage aboutit à une sentence dont les parties acceptent et se conforment, vous n’aurez jamais un problème, mais il y a souvent des situations où il y a une sentence qui est rendue pour des raisons autres que les parties ont plaidées, puis, à ce moment-là, cette sentence peut être attaquée justement parce qu’il y a certains critères qui ne sont pas respectés, par exemple l’ordre public étant un. Alors, à ce moment-là, s’il s’agit d’une question d’ordre public, oui, la sentence va être attaquée, mais, si les parties se conforment avec la sentence telle qu’elle est rendue, bien, dans plusieurs cas, vous n’allez même pas savoir qu’il y avait une sentence arbitrale. Donc, ça dépend, si vous voulez, de l’étendue de cette utilisation.
Alors, ce que moi, j’ai à vous dire concernant cette question de considérer ou suffisamment considérer, c’est que je ne pense pas que le législateur ait besoin de nécessairement, si vous voulez, pousser les gens vers cette considération en le légiférant, je pense qu’il y a d’autres moyens de le faire. Ce n’est pas nécessairement dire qu’on est contre l’idée de l’avoir dans le code. Je pense que la médiation a une place dans le code, je pense que l’arbitrage a une place dans le code. Mais est-ce que vous avez jamais pu réussir ou est-ce qu’un juge a jamais pu réussir à forcer deux parties à négocier? Est-ce qu’on est capables de dire: Vous êtes obligés de négocier? Non. Donc, une obligation existe. J’espère que les gens qui y sont vont considérer la question de négociation, mais de forcer les gens de négocier, ça ne marchera pas.
M. Fournier: Vous savez qu’on ne force pas les gens à négocier, hein, vous le savez.
M. Barin (Babak): Non, non, non. Ça, je suis d’accord. Mais ce que je vois, par contre, c’est qu’il y a un élément de considération, donc les gens doivent considérer. Alors, ça veut dire quoi, ce «considérer»? Est-ce que je le considère puis je le laisse de côté? Est-ce que je le considère, mais je l’utilise? Est-ce que je le considère, mais ça ne me tente pas? Donc, vous savez, en ce qui concerne le consensualisme, ça prend, comme on dit en anglais, «two people to tango», vous en avez toujours besoin de deux pour faire le tango.
M. Fournier: J’ai trouvé que vous aviez quand même assez bien défini «considérer», quand même. Vous m’avez un peu convaincu.
M. Leduc (Antoine): Avec votre permission, Mme la Présidente, si je peux ajouter, pour finir sur cette question-là, M. le ministre, je pense qu’en tout respect, encore une fois, la question de l’accès à la justice, on confond peut-être ici entre l’accessibilité au système de justice et les moyens pour y parvenir. Et, quand j’entends les moyens — et je vous pose la question — est-ce que c’est vraiment une question de faire en sorte qu’on énonce dans un certain nombre d’articles des mesures qui vont favoriser la conciliation entre les parties? Ce avec quoi nous sommes évidemment d’accord, on ne peut pas être contre cela, mais la question que je vous pose, c’est au point de vue économique. Je pense que les mesures se situent peut-être ailleurs, et elles sont peut-être en amont, à savoir toute la question du régime d’aide juridique et toutes les autres façons de permettre aux parties qui n’arriveraient pas à s’entendre au terme d’un processus de conciliation à avoir accès à ce système judiciaire public, et je pense qu’il y a des efforts qui ont été faits au cours des dernières années par le Barreau du Québec en ce sens-là. Et je sais que votre gouvernement actuel est sensible à ces moyens-là qui devraient aussi permettre aux parties de se réapproprier le système, comme vous le dites si bien, mais je pense que ce système-là, il n’est pas exclusif seulement aux corporations. Il faudrait revoir les statistiques, mais le gros des causes sont en matière familiale, si je ne me trompe pas.
La Présidente (Mme Rotiroti): …M. le ministre.
M. Fournier: Oui. Évidemment, si on regarde les matières familiales, peut-être que mon exemple est moins bon, mais, si on regarde l’ensemble, on va s’apercevoir que c’est beaucoup du domaine des corporations. Ceci étant, c’est un ensemble. L’accès à la justice, c’est un ensemble de mesures; nous n’en sommes que sur une ici.
Et, puisqu’il ne reste plus de temps, sachez que nous serons toujours attentifs aux propositions que vous nous ferez. Peut-être qu’on aurait pu parler un peu plus longtemps des projets pilotes, malheureusement le temps nous manque, parce qu’il y avait non seulement des exemples avec l’observatoire sur la gestion hâtive, que vous proposez plutôt tardive, si j’ai bien compris, mais, juste avant vous, on est venu nous voir sur la violence conjugale, et puis peut-être qu’il y a lieu d’envisager des projets pilotes à cet égard-là.
Donc, j’ai compris qu’il y avait une certaine retenue, je le dis comme ça. Peut-être que vous pourriez, plus tard, nous faire valoir des points de vue là-dessus.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci, M. le ministre. On retourne à l’opposition officielle, à la députée de Joliette.
Mme Hivon: Oui. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Alors, je vais poursuivre. Je voulais aussi aborder la question de la gestion de l’instance, on a vraiment deux courants devant nous.
Vous représentez un courant qui vient nous dire que, tel que c’est prévu, ça arrive trop rapidement, donc que ça pourrait être trop lourd, que les exigences sont trop formelles. Enfin, je vais vous laisser le libeller comme vous le souhaitez.
Par ailleurs, on a eu l’observatoire, juste avant vous, qui a fait l’évaluation du projet pilote de gestion d’instance dans le district de Longueuil, qui semble vraiment avoir été un succès. Il y a eu d’autres projets pilotes récemment qui n’ont pas eu ce même succès là, là, ça, c’est clair, mais celui-là en tout cas semble avoir connu un bon succès, les praticiens, très grande majorité, les avocats très satisfaits, bon, tout ça.
Ce qu’on nous expose, c’est que c’était un projet… ils venaient plaider l’inverse de vous au ministre, que la gestion arrive plus tôt, encore plus tôt dans le processus pour que vraiment il y ait un contrôle accru. La juge St-Louis était présente, ancienne juge en chef de la Cour du Québec qui venait nous dire que ça faisait un monde de différence que le juge intervienne plus tôt. Évidemment, vous allez me dire qu’elle prêche pour sa paroisse, je veux entendre l’autre point de vue, mais donc elle donne une direction. Elle nous parlait qu’on avait utilisé des modes technologiques postrévolutionnaires, le téléphone beaucoup, donc qu’il y avait souvent des conférences qui se faisaient par téléphone pour régler des choses rapidement.
Comment vous réconciliez ça? Est-ce que pour certains éléments ça pourrait peut-être être bénéfique que ça arrive plus tôt puis, pour d’autres, peut-être que c’est trop hâtif parce qu’il reste des choses à déterminer dans l’angle qu’on veut prendre pour la cause? Comment vous réconciliez ça, du fait qu’il y a eu un si grand succès à Longueuil et que c’est arrivé quand même hâtivement, avec le fait qu’on vienne nous dire que ce soit si difficile même au stade où on le prévoit, qui est plus tard que ce qui était le cas pour le projet pilote?
M. Leduc (Antoine): Mme la députée, moi, ce que je vous dirais à ce sujet-là, c’est que d’abord on n’a pas eu l’avantage de prendre connaissance des rapports qui ont été faits concernant le projet pilote de Longueuil, ce que nous ferons évidemment avec intérêt. Ce que nous disons, par contre, dans le mémoire qui a été déposé, ce n’est pas que nous sommes contre toute forme de gestion hâtive de l’instance mais qu’il y aurait plutôt lieu — et c’est la proposition que nous faisons — de scinder cette gestion-là selon différents moments et selon aussi la nature de la cause qui sera entendue, parce qu’évidemment il y a certaines causes qui vont s’y prêter mieux et d’autres qui vont s’y prêter moins bien.
Alors, dans un tel cas, évidemment, penser qu’on va régler tout en 45 jours, si c’est une cause commerciale avec des parties multiples et avec même des parties qui sont à l’étranger, c’est illusoire de penser qu’on va pouvoir régler ce type de cause là à l’intérieur d’un délai de 45 jours, en tout cas au niveau du protocole d’instance. Par ailleurs, si on pouvait le scinder, qu’un juge soit saisi dès l’origine de l’action, de la cause en question, et que, là, à différentes étapes, là… et il y a des suggestions qui vous sont faites, je ne m’en souviens pas par coeur, là, mais en tout cas on pourrait penser qu’après, par exemple, la défense ou avant les interrogatoires il puisse y avoir des conférences de gestion qui soient aménagées justement pour essayer de réévaluer au fur et à mesure la procédure. Ça, le Barreau ne s’y objecte pas. C’est juste qu’il faut être réaliste dans ce qu’on envisage de demander aux avocats selon aussi la nature de la cause.
**(15 h 50)**
Mme Hivon: Parfait. Pour l’expertise unique, je comprends que vous n’y êtes pas très favorables, c’est-à-dire pas favorables au fait qu’elle soit imposée. La plupart de ceux qui sont venus nous parler de l’expertise unique jusqu’à ce jour étaient des représentants d’association professionnelle. Donc, ils nous plaidaient que, dans leur type de pratique, c’était problématique d’envisager l’obligation d’une expertise unique, donc ils demandaient une exclusion en matière de responsabilité professionnelle.
Pour l’Association du Barreau canadien, est-ce que l’expertise unique pourrait être un véhicule qui demeure quand le juge l’ordonne pour des raisons de proportionnalité, dans certains cas, ou vous voulez que ça soit enlevé pour tous les cas, ou est-ce que vous adhérez, un peu comme les associations professionnelles, au fait que l’exclusion pourrait être uniquement en matière de responsabilité professionnelle?
M. Leduc (Antoine): Bien, c’est-à-dire que, nous, ce que nous soulevons ici — et ça sera au législateur après de prendre sa décision — c’est que la constitutionnalité pourrait être remise en doute, d’une telle mesure, si l’expert unique pouvait être ordonné derechef par le juge. Alors, nous, nous n’y sommes pas objectés si c’est consensuel, mais la position du Barreau canadien à ce sujet-là, c’est que nous sommes contre l’imposition à quelque type de litige que ce soit d’une expertise unique.
Mme Hivon: Parfait. Donc, vous pensez que sous aucun prétexte la règle de la proportionnalité ne pourrait faire en sorte de donner ce pouvoir-là aux juges. Votre position est claire.
Est-ce que par ailleurs, de manière générale, vous reconnaissez un bien-fondé à la règle de la proportionnalité pour venir, par exemple, mettre certaines balises? Certains avant vous ont parlé de la question du… quand la valeur du litige est de 100 000 $, en haut de 100 000 $, en bas de 100 000 $, la différence que ça peut faire pour la durée des interrogatoires, par exemple. Est-ce que ça, c’est quelque chose que vous recevez positivement ou, de manière globale, vous trouvez qu’il ne devrait pas y avoir ce type de distinction?
M. Leduc (Antoine): Bien, c’est-à-dire que… Encore une fois, peu importe que le litige vaille 100 000 $, plus ou moins. Parfois, je vous confierai que, dans des causes de moindre importance, ce sont les causes les plus complexes, et on voit des causes où on se chicane pour un montant de 10 000 $ ou 15 000 $ sur des questions de principe qui se rendent jusqu’à la Cour suprême. Et, dans un tel contexte, d’essayer de limiter tous azimuts les interrogatoires en fonction de la valeur du montant en litige nous apparaît un peu excessif.
Par contre, il est possible de suggérer de telles mesures si on permettait aux parties d’en être relevées par le juge sur explication suffisante. Et ça, je pense que c’est ce que notre mémoire dit et c’est la position du Barreau canadien.
Mme Hivon: Donc, vous le prenez, c’est ça, de l’autre sens. Puis, pour ce qui est des interrogatoires préalables, bon, vous en parlez, le fait qu’ils doivent maintenant être déposés dans leur entièreté. Vous vous y objectez fermement. Je voudrais comprendre quel peut être le si grand préjudice qui peut être vécu des suites de ça. Est-ce que ça ne peut pas amener l’avocat à restreindre un peu les questions pour aller plus droit au but? Je comprends que des fois on veut amener les choses avec un certain nombre de détails, mais, avec la durée qui s’ensuit, c’est quoi, le préjudice si grand pour vous dans votre réalité de praticien?
M. Leduc (Antoine): Bien, la réalité, c’est que, si on fait ça, il n’y en aura plus, d’interrogatoire, ou presque plus, parce que l’objectif de l’interrogatoire préalable est justement, pour une partie demanderesse et un plaideur, d’évaluer la justesse d’une cause et de savoir si la cause vaut ce qu’on prétend qu’elle vaut. Et, dans un tel contexte, si la partie demanderesse fait un interrogatoire préalable et qu’elle n’est pas tenue de le produire ou qu’elle peut le produire à sa discrétion, à ce moment-là, elle a toute latitude de poser les questions qu’elle veut pour bien comprendre la cause, et éventuellement, si elle constate que sa cause est moins bonne qu’elle ne le pensait, le procureur, en principe, doit inciter le client à régler la cause. Et on le voit souvent dans notre réalité de praticien, ça arrive de façon très courante qu’on règle des causes dans un tel contexte. À l’inverse, avec la nouvelle règle, bien, à ce moment-là, la partie demanderesse va être beaucoup plus circonspecte, il est vrai, dans ses questions, mais on perd peut-être une occasion de régler le litige, ce qui est la volonté pourtant exprimée du législateur dans le contexte de cet avant-projet de loi.
La Présidente (Mme Rotiroti): Il reste 1 min 30 s, Mme la députée.
Mme Hivon: Merci. Alors, une toute petite question. Sur la question du concept de dignité — je suis à la page 11 — pour la question de la publicité des débats, l’association des avocats en droit des médias sont venus nous voir, ils avaient des commentaires à nous faire aussi par rapport à la notion de dignité. Je comprends qu’à la page 11 vous dites que ça pourrait être interprété comme signifiant «susceptibilité». Je veux comprendre ce que vous voulez dire.
M. Leduc (Antoine): Bien, ce qu’on veut dire, c’est que, l’argumentaire qui est devant vous, ce n’est pas la dignité de la personne par rapport à son appréciation subjective qui doit être prise en compte mais plutôt par rapport à un critère abstrait qui est celui de l’intérêt public à la confidentialité. Et ça, on vous réfère aux différentes causes et arrêts de principe qui ont été rendus par la Cour suprême, qui ont clairement balisé ces droits. Et, avec la formulation actuelle dans l’avant-projet de loi, on semble vouloir s’écarter un peu de ces critères-là et aller de façon plus large pour permettre une confidentialité accrue des débats, ce qui inquiète l’Association du Barreau canadien.
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, ça met un terme à nos échanges. Je vous souhaite… Merci beaucoup à l’Association du Barreau canadien, division Québec, pour votre présentation.
On va suspendre quelques minutes pour accueillir les prochains intervenants, l’Association professionnelle des sténographes officiels du Québec.
(Suspension de la séance à 15 h 57)
(Reprise à 15 h 59)
La Présidente (Mme Rotiroti): Bienvenue à l’Association professionnelle des sténographes officiels du Québec. Alors, je vous rappelle que vous avez 15 minutes pour faire votre présentation, je vous demande de présenter les gens qui vous accompagnent, et par la suite on passera à l’étape de l’échange de l’opposition officielle et le côté gouvernemental. Alors, si vous pouvez… C’est qui qui va commencer à faire la présentation? Oui?
Association professionnelle des sténographes
officiels du Québec (APSOQ)
Mme Fanizzi (Rosa): …présenter. Mon nom est Rosa Fanizzi. Je suis la présidente de l’Association professionnelle des sténographes.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. Alors, allez-y, la parole est à vous.
**(16 heures)**
Mme Fanizzi (Rosa): Je suis accompagnée aujourd’hui de Me Jean-François Longtin et Me Jean-François Noiseux, qui sont nos conseillers juridiques — merci, O.K. — ainsi que de M. André Boudreau, qui est sténographe et président de l’École de sténographie judiciaire du Québec, et de M. Jean-Philippe Clément, sténographe et membre du conseil d’administration de l’association des sténographes.
Notre association et les sténographes tenaient absolument à participer à ces audiences sur l’avant-projet de loi. Nous vous remercions de l’occasion que vous nous donnez d’être ici, de préciser certains points et répondre à nos questions quant au mémoire que vous avez entre les mains.
Les sténographes sont présents dans le processus judiciaire depuis plusieurs siècles maintenant et, en tant que tels, sont des témoins privilégiés de sa pratique quotidienne. Nous agissons évidemment dans le cadre de procès, d’interrogatoires hors cour mais aussi dans des audiences disciplinaires, lors de colloques ou d’assemblées d’actionnaires par exemple, et nous avons aussi de nouvelles portes qui s’ouvrent à nous et nous touchons à autre chose que le droit, tel que les conférences, le sous-titrage et l’arbitrage.
L’un de nos rôles, lors de ces activités, est de prendre les notes de ce qui se dit, de les conserver et de les transcrire fidèlement lorsque requis. Mais il y a plus. Nous sommes des officiers de justice soumis au contrôle de la Cour supérieure et, à ce titre, non seulement devons-nous certifier sous notre serment d’office que les notes recueillies sont exactes, mais nous avons aussi le pouvoir d’intervenir directement lors d’un interrogatoire si on juge que le respect dû à un témoin n’est pas respecté. Les sténographes assument une responsabilité face au justiciable quant à l’intégrité du processus judiciaire et au respect de ses droits, tel que plus amplement décrit dans notre mémoire. Je ne reprendrai pas ici ce qui y est contenu. Nous voulons simplement apporter quelques précisions, entre autres sur la formation et sur le contrôle de la pratique des sténographes.
Je vais demander tout d’abord à M. André Boudreau, président de l’École de sténographie, de vous faire un bref historique sur la formation des sténographes et d’expliquer la genèse de l’école actuelle. Par la suite, Me Jean-François Longtin et Me Jean-François Noiseux vous expliqueront sommairement l’aspect contrôle et discipline qui régit notre pratique. Merci beaucoup.
M. Boudreau (André): Membres de la commission, je crois qu’il serait sage, avant de faire notre présentation, de vous décrire en quelques mots ce qu’est un sténographe officiel. On peut le définir ainsi: C’est une personne formée qui note la parole aussi rapidement qu’elle est prononcée à l’aide d’une méthode reconnue par la loi.
Présentement, elle est formée par l’École de sténographie judiciaire du Québec, une école instaurée en partenariat avec le Barreau du Québec et l’Association professionnelle des sténographes officiels du Québec. On y enseigne la plus haute technologie en matière de prise et de transcription et un volet Droit et éthique. L’étudiant est accompagné par un sténographe officiel lors de son stage.
En français, nous ne connaissons pas d’école semblable à la nôtre. Bien qu’il faudrait en avoir une, nous n’avons pas de division anglophone. Un élément intéressant: l’enseignement peut être fait à distance, ce qui permet la formation de candidats provenant des régions les plus éloignées. Notre école est une école privée de niveau collégial approuvée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Si vous sentiez le besoin d’avoir une démonstration de cette formidable technologie de sténotypie assistée par ordinateur, il nous fera plaisir de répondre à votre demande.
En anglais, il y a une école en Ontario, une en Alberta et une en Colombie-Britannique. Aux États-Unis, il y a 68 écoles reconnues par la National Court Reporters Association qui forment des sténotypistes, la méthode que nous enseignons. Il y a 12 écoles affiliées à la National Verbatim Reporters Association qui forment des sténomasques.
Selon le U.S. Department of Labor, en 2008 il y avait 21 500 sténographes officiels en exercice. On prévoyait, entre 2008 et 2018, une augmentation de 18 % des emplois dans ce domaine, ce qui surpasse la moyenne nationale, qui se situe entre 7 % et 13 %. En faisant un calcul rapide, on arriverait à un chiffre quand même assez impressionnant.
Cette information nous démontre que les instances se sont prononcées en faveur du système de sténographie judiciaire et ont conjointement mis tous les efforts pour améliorer la technologie. Ça témoigne de la confiance du justiciable envers le sténographe officiel, ce qui n’est pas rien quand on pense que les États-Unis sont le pays où la technologie est la plus avancée.
Au Québec, le sténographe officiel est un officier de la Cour supérieure, un officier de justice, un officier public. Nous sommes convaincus que notre système de sténographie officiel offre aux justiciables toutes les garanties nécessaires et assure la protection de leurs intérêts. Le sténographe officiel est soumis au contrôle du Comité sur la sténographie, qui est composé de trois avocats nommés par le Barreau du Québec, trois sténographes officiels nommés par l’Association professionnelle des sténographes et un membre désigné par le ministre de la Justice.
On remarque chez le justiciable une certaine frustration découlant du fait qu’il n’a pas l’impression d’être en mesure de s’exprimer lorsqu’il le désire, et ce sentiment semble engendrer une partie importante des délais. Ce qui au départ semblait simple prend des proportions inattendues et certainement difficiles à contrôler. Ça le rend irritable et vulnérable, ce qui l’amène à être indifférent face à la justice, à ne plus croire en celle-ci.
Permettez-moi une observation. Je suis sténographe depuis plusieurs années. De l’équipe volante du ministère de la Justice, j’ai été transféré dans le district judiciaire de Joliette, où j’y suis depuis ce temps. Ça me rappelle l’année de l’Expo. Pendant presque toute ma carrière, j’ai travaillé à la cour. À cette époque, il n’y avait aucun autre moyen de prise. Je travaillais à la cour criminelle, mais, en région, on nous demandait de faire de temps en temps des affaires civiles. La première fois que l’on m’a demandé de faire des interrogatoires hors cour, étant un officier de la Cour supérieure, j’ai fait appel à un juge de la Cour supérieure pour connaître comment ça fonctionnait. Il m’a dit: Ce n’est pas compliqué, les interrogatoires, tu as un demandeur et un défendeur. Le défendeur interroge le demandeur, le demandeur, avec la transcription des notes que tu lui auras remise, interrogera le défendeur, et ensuite les avocats verront avec leurs clients respectifs s’ils sont en mesure de régler le dossier.
Avant le dépôt de notre mémoire en mai 2000 — parce qu’on a déposé un mémoire devant le comité Ferland en mai 2000 — nous avions fait un sondage qui n’était pas scientifique, bien évidemment, mais les avocats consultés nous avaient dit qu’assez souvent, après les interrogatoires hors cour, plusieurs dossiers se réglaient. Ici, j’ouvre une parenthèse: nous l’avons dit également devant le comité Ferland, qu’il faudrait arrêter de dire que les avocats abusent de la procédure. Ce n’est pas ce que nous avons constaté.
On m’a fait remarquer que, si ça ne se réglait pas à l’interrogatoire, ça commençait comme ça et ça finissait comme ça. La transcription, disait-il, suivra le dossier jusqu’au jugement final, et le justiciable aura la garantie que ce qui a été écrit a été conservé par un officier de justice. C’est la base de notre système, et le sténographe officiel est un rouage incontournable, incontournable pour l’administration de la justice. Les interrogatoires sont faits comme s’ils étaient faits devant le tribunal. Ce juge de la Cour supérieure est devenu juge en chef de la Cour suprême du Canada, M. Antonio Lamer.
**(16 h 10)**
Jusqu’à maintenant, j’ai toujours conservé cette image d’une justice simple. Cependant, ce que nous avons observé, c’est qu’il s’est créé un fossé énorme entre le justiciable et la justice. Le principal grief vient du fait que le justiciable trouve qu’il y a beaucoup de gestion, de contraintes et d’impondérables. Le justiciable semble exclu du processus de la justice et il a de plus en plus de difficultés à s’y retrouver.
J’ai été justiciable quatre fois, à quatre périodes différentes, et j’ai été à même de constater cette réalité: le justiciable a des obligations mais aussi des droits. Laissons à celui-ci ce privilège exceptionnel de décider s’il veut interroger ou pas, peu importe le montant. Il est convaincu que c’est la façon de connaître les prétentions de son adversaire, et, lorsqu’on est justiciable — vous l’avez peut-être déjà été — on a toujours l’impression qu’il va se passer quelque chose et que l’on sera en mesure de régler notre dossier. C’est un droit qu’il a et qu’il doit conserver, de pouvoir interroger. La justice, c’est une question de principe, ce n’est pas une question d’argent. La journée où la justice devient une question d’argent, c’est qu’il n’y en a plus.
Il ne doit pas y avoir de modes en justice — nous ajouterions «en éducation aussi». Le changement est très souvent le pire ennemi. Comme un expert l’a déjà dit: Je ne peux plus témoigner comme je témoignais, et très souvent ça m’embête. C’est devenu plus compliqué, plus angoissant. Pourtant, je fais le même métier, et mes rapports sont à peu près toujours les mêmes.
J’ai écrit ces quelques lignes pour ne pas pendre trop de temps, c’est le conseil que m’a donné ma présidente — je suis plus à l’aise quand je ne lis pas. Nous n’avons pas beaucoup de mérite. Ensemble, nous avons des centaines d’années d’expertise en cette matière et nous pratiquons ce métier avec passion, honnêteté et intégrité. Nous sommes au coeur de l’action, nous avons été et nous sommes des observateurs importants, et au faîte de nos responsabilités et obligations il y a toujours eu et il y aura toujours comme seul objectif la protection du justiciable. C’est pour le justiciable que la justice existe. En rendant ça simple, en rendant ça simple… — excusez-moi, c’est ce que je disais, j’ai de la difficulté parfois à lire — en rendant ça simple, nous obtiendrons plusieurs avantages. Il n’y a qu’un pas à franchir entre le justiciable et le sténographe officiel pour les souder ensemble. C’est la meilleure garantie que ce qui a été dit au cours des divers échanges ne soit pas déformé par le temps. Le sténographe officiel met tout par écrit et en fait la conservation, met tout par écrit et en fait la conservation. À cette condition, le justiciable n’aura aucune raison de prétendre que la justice est longue et coûteuse. En effectuant des changements, il faudra faire bien attention que la société ne subisse pas de préjudice sérieux qui compromettrait davantage la protection du justiciable et du public.
En terminant, je vous référerais à notre mémoire et particulièrement à sa conclusion, en page 12. Mme la Présidente, honorables ministre et députés, nous vous remercions de l’attention que vous nous avez accordée.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. Vous avez réussi à rester dans le temps, merci beaucoup. On passe la parole, à la période d’échange, au ministre de la Justice.
M. Fournier: Merci, Mme la Présidente. Et merci à vous d’être avec nous pour nous amener sur votre terrain, je le dis d’entrée de jeu, qui n’est pas un terrain que je connais, et c’était fort intéressant de vous entendre. J’ai l’impression que vous allez… Je veux vous entendre un petit peu plus, par contre, pour que vous m’en parliez encore un peu plus.
Peut-être un petit détour, commentaire comme ça, là: La justice, c’est une question de principe. J’entends dire que l’accès à la justice peut être une question d’argent. Alors, convenons que la justice, c’est une question de principe, mais, si d’aventure l’accès à la justice soulève en ce moment une question d’argent et de délai — et je crois pas mal ça parce que c’est assez dit, assez documenté — qu’est-ce que vous trouvez que nous devrions faire ou que nous faisons et que nous ne devrions pas faire pour rendre simple et plus économique l’exercice des recours?
M. Boudreau (André): Comme je disais, quand j’ai commencé à travailler c’était très simple, et ce qui engendre des coûts qui sont terribles pour le justiciable, c’est cette gestion qu’on met entre lui et la justice. Quand on va au comité des comptes, au Barreau du Québec, et qu’un compte d’avocat est contesté, bien on s’aperçoit qu’il a été trois, quatre fois devant différentes instances pour essayer, évidemment, de répondre à des demandes, le justiciable ne paie pas de compte à l’avocat en contestant. C’est un élément important, c’est parce que la justice est devenue trop compliquée pour le justiciable.
Je crois que le justiciable, là, il faut qu’il soit vraiment au centre de tous les débats. Ce n’est pas une question de juge, ce n’est pas une question d’avocat, de ministre ou de sténographe. C’est une question de justiciable, la justice. Il faut lui rendre ça simple.
On a constaté — puis je le dis avec beaucoup de respect, c’est de cette façon-là qu’on a vu que les avocats n’abusaient pas — qu’il y a des centaines d’interrogatoires qui durent 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d’heure, une heure, que les avocats nous avaient réservés pour deux et trois heures. C’est rare qu’un avocat réserve pour trois heures puis il en prend quatre, c’est la constatation qu’on a faite. Au départ, c’était simple, puis à un moment donné ça devient compliqué, avec le temps, parce que, s’il veut continuer la procédure, il faut qu’il réponde à toutes sortes de choses, ça devient coûteux.
Si vous me permettez, quand je disais tantôt que j’ai été quatre fois justiciable, c’était à des époques différentes. La dernière fois, pour obtenir justice, ça m’a coûté au moins trois fois plus de temps que ça m’avait coûté autrefois à cause de ce que je vous dis, trop de gestion. Ça, c’est coûteux pour le justiciable. Quand on parle d’interrogatoire hors cour, je ne suis pas certain que ce soit si dispendieux que ça. On a beau prendre une cause ou deux puis dire: Bien, ça a duré deux jours ou trois jours, l’interrogatoire, mais en région ce n’est pas ça qui existe, ce n’est pas vrai, les interrogatoires sont courts et pas coûteux aux justiciables.
M. Fournier: Je vais revenir sur la gestion tantôt parce que j’aimerais ça que vous me précisiez aussi la gestion, je voudrais que vous me précisiez ce que vous voulez dire. Je vais rester sur l’interrogatoire.
Vous dites: Les cas de figure qui se présentent, ce n’est vraiment pas si long que ça, il n’y a pas d’abus. La disposition qui est faite ici est justement basée sur des moyennes de temps qui a été pris, et même un peu à l’excès, et donc, lorsqu’il y a des durées de prévues, elles ne sont pas abusives, on n’a pas imposé un plancher si bas que ça devient impossible. On a simplement essayé de limiter les cas où ça pourrait se présenter, les abus.
Alors, dans les dispositions qu’il y a sur les interrogatoires, là, sur les durées qu’il y a, est-ce que vous trouvez que ce n’est pas utile de mettre ça?
M. Boudreau (André): Non, pas du tout.
M. Fournier: Même s’il y a des limites et puis…
M. Boudreau (André): Non, pas du tout. On a perdu confiance aux avocats, terrible. C’est dommage, on ne devrait pas faire ça. C’est le contraire.
M. Fournier: On devrait lui laisser toutes les possibilités?
M. Boudreau (André): …c’est le justiciable qui devrait décider avec son avocat le type d’interrogatoire.
M. Fournier: O.K. Je ne veux pas vous challenger, mais les échos que j’ai sont plutôt à l’effet que le client, avec son avocat, le client est plutôt sous l’autorité — c’est un mot un peu fort, «autorité» — sous les conseils professionnels de son avocat. C’est lui qui sait mieux, l’avocat. Pour le client, là, qui prend son avocat, là, toute sa confiance est attribuée à l’avocat.
Or, les échos qu’on a, c’est que parfois il est même important de mettre un juge pour essayer de ménager les ardeurs, d’amener la proportionnalité. C’est vers ça qu’on est, là. Et ce qui a été prévu, ce n’est pas de dire: Il n’y a pas d’interrogatoire. Ce qui a été prévu, c’est de dire: Il y aura des limites de temps.
Juste de prévoir des limites de temps qui sont pourtant des moyennes, pour vous, ça devient un élément inutile?
M. Boudreau (André): Je le crois sincèrement personnellement, ça n’engage pas la responsabilité de l’association. Je le crois. Avec tous les interrogatoires que j’ai faits dans ma vie… Je ne suis pas avocat, mais je peux vous dire que, si on me donne deux heures pour interroger, ça ne durera pas deux heures, parce que je peux utiliser tous les moyens que je connais pour que ça dure beaucoup plus que ça. Il va y avoir de l’abus, et les avocats vont devoir retourner devant les juges pour demander une extension d’interrogatoire, et ça ne finit plus, ça.
M. Fournier: Parlant de la gestion, tantôt vous disiez: Le problème entre le justiciable et… entre la première fois que vous y avez eu recours et la dernière fois, vous dites, c’est la gestion. Alors, dites-moi, gestion, de quelle gestion, de quoi vous parlez? Quelle est la problématique que vous voyez et, si tant est que vous l’identifiiez, quelle est la solution à apporter? Vous avez identifié un problème. Quelle solution doit-on apporter?
M. Boudreau (André): C’est que c’en est un, cas d’espèce, là, quand on dit qu’on va mettre un temps pour les interrogatoires. On le sait, puis j’ai consulté des avocats même du Procureur général qui m’ont dit: Ça va prendre deux fois plus de temps, ça va coûter deux fois plus cher. C’en est un, irritant. C’est de la gestion qui est un peu bizarre.
M. Fournier: …trouvez-moi-z-en d’autres, problèmes de gestion que vous voyez.
M. Boudreau (André): Bien, je ne veux pas m’embarquer sur ce sujet-là parce que ça va peut-être impliquer d’autres métiers ou d’autres professions. Moi, je pense que vous êtes au courant autant que moi de la gestion qu’on impose aux justiciables de la part des tribunaux, entre autres, hein? Bon. Peut-être que Me Longtin pourrait répondre à ça plus facilement, parce qu’on commence à toucher à des règles de droit.
M. Fournier: On est entre nous, on est entre nous, là, allez-y.
**(16 h 20)**
M. Longtin (Jean-François): Oui. Bien, écoutez, je peux, si vous me permettez… Jean-François Longtin. On pourrait parler pendant des heures de la question du coût de l’introduction d’un recours judiciaire, du coût de la justice, de l’importance de l’argent par rapport au principe, mais je pense qu’on va avoir la rigueur de s’en tenir au contenu de la présentation de l’APSOQ, et ce qui m’est venu en tête, c’est justement le fait que, comme praticien… Parce que c’est ma vie. C’est ce que je fais depuis très longtemps, tellement longtemps que je ne m’en souviens pas, là, mais bon… Mais je suis un avocat de litige et j’ai fait des petits litiges, des moyens litiges. J’ai pratiqué aux côtés de votre voisin, Me Chamberland, à l’époque, au Procureur général du Québec, en pratique privée, je représente des corps publics, etc. Mais je peux vous dire une chose, c’est que la rigueur est la règle dans le cadre de la tenue des interrogatoires hors cour, avant défense ou après défense. Je crois que l’excès est l’exception. C’est mon expérience. Je crois que les avocats sont généralement et en quasi-totalité suffisamment rigoureux pour s’en tenir à ce qui est nécessaire.
Alors, ce qui est nécessaire, c’est d’aller voir dans le camp adverse lorsqu’on est en défense, d’aller voir ce que contient la demande, et c’est factuel. Le rôle… Les questions de droit, les avocats les traiteront par la suite, mais c’est purement les faits. Alors, on parle… Et il faut se rappeler, là, l’origine des dispositions 397, 398, c’est la notion de «full disclosure». En droit criminel, c’est la sacro-sainte divulgation de la preuve, mais l’écho de ça en matière civile, c’est les interrogatoires au préalable. Alors, la tenue de ces interrogatoires permet à chaque partie de jauger le bien-fondé de ce qu’on trouve d’un coté et de l’autre, et je ne crois pas… Puis là, écoutez, quand je dis «je», je suis ici comme conseiller juridique de l’APSOQ, mais je ne peux pas enlever mon chapeau d’avocat de litige. C’est peut-être pour ça qu’ils m’amènent, dans le fond, c’est que je ne crois pas que restreindre, poser des limites au temps consacré à un interrogatoire hors cour atteindra l’objectif escompté, à savoir diminuer les coûts, favoriser l’accès. Je suis plutôt porté à penser le contraire, et on peut imaginer des figures…
Parce que, là, je n’en suis pas encore au point où… à l’autre question, à savoir: il sera possible désormais que des interrogatoires soient tenus hors cour sans qu’il y ait un sténographe, chose, actuellement, qui ne se fait pas. J’y viendrai en deuxième point. Mais imaginons le scénario suivant où on a un délai imparti de deux heures. On n’éliminera pas les objections, on ne peut pas éliminer les objections. Je sais qu’il y a une velléité d’imposer que certaines objections soient prises sous réserve. Je dois vous dire que j’ai un petit problème avec ça, parce qu’il y a des objections qui… puis là je ne veux pas tomber dans le détail, mais il y a des objections qui doivent être tranchées avant que le processus continue, et qui bloquent, et qui nécessiteront le retour à l’interrogatoire, parce que, si la question est empêchée, qu’il y a une objection, ça devra être tranché par un juge, et là on suspend cette question-là. Un bon jour on va revenir, quand l’objection sera tranchée. Est-ce qu’on va revenir à l’intérieur de la même fourchette de deux heures? Écoutez, c’est long, là, mais vous voyez à peu près, là, dans…
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui?
M. Longtin (Jean-François): Excusez-moi. Oui, vous voyez à peu près, là, la problématique que ça soulève.
L’autre problème qui apparaît de l’ensemble du projet, à ce chapitre, c’est le fait qu’on puisse désormais, hors cour, interroger en l’absence de sténographe. Et, encore là, c’est l’avocat de litige expérimenté qui va vous parler, c’est que, vous savez, on a adopté assez récemment, dans le Règlement de procédure civile, l’article 45.1. J’imagine que vous êtes familiers avec cette disposition. Je pense que je vais le lire, l’article, parce que vous allez voir jusqu’à quel point c’est crucial, cette disposition. Et l’article 45.1, son titre, c’est Respect du témoin, et c’est le Règlement de procédure, donc les règles de pratique de la Cour supérieure. Alors, je cite: «Le respect dû au témoin commande que tout interrogatoire hors de cour soit conduit de la même manière qu’en audience du tribunal; s’il y a une dérogation au décorum ou au bon ordre, le sténographe peut suspendre la séance — le sténographe peut suspendre la séance — pour obtenir sur-le-champ une directive du juge pour sa continuation.»
Ça a l’air banal comme ça. Quand on est à la cour et qu’une situation commande une intervention du magistrat soit à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure mais où il y a de l’enquête, le juge va intervenir. Les avocats vont se faire forts d’attirer son attention ou il le fera lui-même. Mais, lorsqu’on est hors cour, ça prend un officier de justice pour garder l’ordre dans la cabane, passez-moi l’expression, et mes amis sténographes — je ne lui donnerai pas la parole parce qu’on va excéder notre temps juste là-dessus — l’ont vécue, la mise en oeuvre de cette disposition, et quelquefois c’est le justiciable… Quand M. Boudreau dit: Vous savez, le justiciable et le sténographe ne font qu’un, si on a une figure en tête, c’est bien celle-là. C’est que, vous savez, quand les avocats s’enflamment dans un débat d’objection ou quand un avocat devient un petit peu vindicatif par rapport à la partie qu’il interroge, la personne physique, là — que ce soit un débat qui implique des personnes morales ou non, c’est toujours un témoin qui est interrogé — le sténographe, sous l’égide de cette disposition-là, peut dire: Écoutez, je pense que vous dépassez les bornes, et généralement les avocats vont réagir justement en se calmant parce qu’il y a cette disposition. Et il y a des cas d’espèce où M. Boudreau lui-même mais plein d’autres sténographes sont allés voir le juge résident, ou le juge en chambre, ou peu importe pour dire: Écoutez, vous devez nous aider, vous devez calmer la donne.
Alors, le jour où il sera possible de tenir des interrogatoires hors cour sans la présence de l’officier de justice qu’est le sténographe, je pense, ouvrira la porte à tous les abus. Évidemment, comme je l’ai dit au tout début, il faut faire confiance aux avocats, mais quelquefois le contrôle…
La Présidente (Mme Rotiroti): En terminant, Me Longtin, s’il vous plaît.
M. Longtin (Jean-François): Pardon?
La Présidente (Mme Rotiroti): En terminant. On va passer…
M. Longtin (Jean-François): Quelquefois, le contrôle se perd, et il y a un sténographe qui est là pour ramener l’ordre. Voilà. Écoutez, c’est un sujet qu’on peut traiter longuement, je l’ai déjà fait. Alors, voilà. Désolé, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. La députée de Joliette.
Mme Hivon: Merci, Mme la Présidente. Merci de votre présentation. Bien heureuse d’apprendre que vous avez fait la majorité de vos années de sténographie, M. Boudreau, à Joliette. Je comprends qu’on est entre bonnes mains.
Je veux savoir… Peut-être une petite question préliminaire: Est-ce qu’en ce moment il y a une pénurie de sténographes?
M. Boudreau (André): Définitivement, oui.
Mme Hivon: Oui? Il y a à peu près… Il y a combien de nouveaux sténographes, peut-être, qui émergent dans une année? Est-ce que vous les…
M. Boudreau (André): Actuellement, il y a 156 sténographes en fonction. L’école en a formé une dizaine depuis trois ans, et on a actuellement 52 étudiants à l’école, dans deux divisions.
Mme Hivon: O.K., O.K.
M. Boudreau (André): C’est très bien.
Mme Hivon: Donc là, il y en… Oui?
M. Boudreau (André): …avec l’aide du Barreau. C’est exceptionnel, c’est une belle école.
Mme Hivon: O.K., parfait.
M. Boudreau (André): C’est deux ans de formation, soit dit en passant. Ce n’est pas facile, hein?
Mme Hivon: Donc là, s’il y en a 52, c’est parce qu’il y a un intérêt qui revient, parce que… Est-ce que c’est parce qu’il y a une prévision qu’il y en a plusieurs qui vont partir à la retraite puis il y a eu des efforts accrus pour essayer d’aller stimuler l’intérêt pour la profession?
M. Boudreau (André): Si vous me permettez, il y a eu un vide de formation pendant beaucoup d’années, et actuellement, bien, c’est sûr que les sténographes prennent de l’âge. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui veulent se retirer, alors inévitablement il va falloir les remplacer.
Et il faut dire aussi que la formation est importante au niveau technologique, parce que ce qu’on enseigne, ici, si on faisait une démonstration, vous avez tous des ordinateurs devant la table et le sténotypiste qui tape au fur et à mesure, vous voyez les questions et réponses qui rentrent. C’est pour ça qu’il y en a 22 000 aux États-Unis avec cette technologie, ils ont commencé ça dans O.J. Simpson. C’est incroyable, c’est des méthodes de temps réel. On fait une journée de cour, puis à 6 heures le soir vous avez toutes les notes de la journée. C’est ça qu’on enseigne.
Alors, évidemment, il en manque, il en manque beaucoup, parce qu’il y a beaucoup de procès où les avocats n’utilisent pas de sténographe parce qu’il n’y en a pas.
**(16 h 30)**
Mme Hivon: Est-ce que je comprends correctement que ce qui a motivé votre association à venir aujourd’hui, c’est deux points, je dirais, majeurs, la question que les sténographes doivent demeurer présents pour tout interrogatoire, donc, au préalable, donc d’exclure la possibilité qu’un sténographe ne soit pas présent, comme maître vient de l’expliquer, et l’autre, c’est de dire: Faites bien attention pour toute la question des interrogatoires qui… car vous semblez présumer qu’il pourrait y avoir de l’abus, on veut vous dire qu’il n’y a pas d’abus? C’est ça essentiellement, les deux éléments centraux, si je comprends bien?
Pour ce qui est de l’élément sur l’abus potentiel d’interrogatoire, parce que, si on vous dit ça, si le ministre vous dit ça, bien je pense qu’on entend un peu les mêmes choses, c’est qu’en fait on a comme deux sons de cloche. Alors, les avocats et vous, aujourd’hui, vous nous dites: Vraiment, les abus, c’est très rare. Par ailleurs, quand on demande aux gens quels sont les freins à l’accès à la justice, qu’est-ce qui fait en sorte que ça coûte si cher, que les délais sont ce qu’ils sont, on nous parle de deux éléments notamment, les interrogatoires, la multiplication des interrogatoires, la longueur des interrogatoires, tout ça, et aussi, bon, toute la question des expertises puis… bon, et que, du fait de la complexification des causes en matière civile, on voit une recrudescence du nombre d’interrogatoires, et tout ça.
Vous, vous avez un son de cloche un peu différent sur, je dirais… Si on les prend interrogatoire par interrogatoire, vous dites qu’il n’y a pas d’abus dans la durée, mais vous, de votre pratique, par votre expérience — puis aussi je comprends que vous avez été justiciable, comme vous l’avez dit aussi — est-ce que vous voyez par ailleurs que, du fait de la complexification, il y a effectivement, pour une cause donnée, une multiplication de procédures, d’interrogatoires, d’expertises et que ça, c’est en soi un frein potentiel à l’accès à la justice?
M. Boudreau (André): Je vais répondre à la première question: Nous ne sommes pas ici pour défendre les sténographes, nous sommes ici pour parler de la protection du justiciable. C’est sûr et certain que, si on garde ça simple, ce que vous avez dit, ça ne tient pas, mais, si c’est raisonnable puis si c’est vrai, ce que vous dites, oui, ça devient très compliqué. En région, je ne connais pas d’interrogatoires qui sont longs et abusifs. On en a peut-être dans les grands centres à l’occasion, des interrogatoires où ça dure une journée, deux jours, trois jours, je ne suis pas certain, mais je pense qu’il y a, quoi, 10 % ou 14 % des avocats qui font du litige, quelque chose de semblable. Il me semble, dans la région de Joliette, on avait fait le sondage à l’époque, en 2000: on n’arrivait même pas à 12 % des avocats qui faisaient du litige. Alors, cet élément-là ne tient pas. Oui, vas-y.
M. Longtin (Jean-François): Pour ne pas l’échapper, là, c’est que je pense que les gens qui ciblent les interrogatoires hors cour ou au préalable, avant défense ou après défense, comme étant un élément qui ajoute aux coûts et à la complexité des litiges malheureusement démontrent une certaine méconnaissance de l’environnement judiciaire civil. Il y a peut-être d’autre chose à bonifier, à améliorer, mais je pense que l’interrogatoire au préalable va toujours continuer de favoriser l’accès à la justice et la simplification des débats… et en présence d’un officier de justice quand c’est hors cour. À la cour, c’est autre chose, il y a un juge, mais hors cour ça prend un officier de justice. Ce n’est pas un décideur, mais c’est quelqu’un qui va garder de l’ordre, un certain décorum, parce qu’il se trouve toujours une personne au centre de cette activité qui est un justiciable, qui est représenté par avocat mais qu’il y a un autre devant lui qui essaie de tirer la couverte.
Alors, ça prend un officier de justice. Je pense que c’est ça, le message. Les expertises, ça n’a pas touché… le mémoire de l’APSOQ ne touche pas à ça. Je pourrais vous en dire long là-dessus, mais je ne le ferai pas parce que vous allez m’en empêcher de toute façon.
Mme Hivon: Est-ce que vous voyez une différence notable quand une des parties n’est pas représentée par avocat? Est-ce que ça complexifie, je dirais, votre travail… ou en fait, incidemment, est-ce que vous voyez plus, c’est ça, de complexité, plus d’incidents qui surviennent?
M. Boudreau (André): Dans les interrogatoires sous 543, entre autres, souvent le justiciable est seul, et ça m’a été donné d’intervenir lors d’un interrogatoire puis d’appeler mon juge coordonnateur, parce qu’il ne faut pas oublier que les sténographes, ils ont toujours un juge coordonnateur. Quand ce n’est pas le juge en chef, c’est un juge qui est nommé par le juge en chef. Et de fait, oui, ça m’a semblé très abusif, puis j’étais mal à l’aise avec ça. Mais, tant et aussi longtemps que le justiciable a ce droit de se défendre lui-même, c’est bien difficile de faire autrement, mais de plus en plus on voit des justiciables qui se défendent eux-mêmes. En matrimonial, entre autres, j’ai assisté, depuis quatre, cinq ans, à des interrogatoires faits par soit l’homme ou la femme. Une partie a un avocat; l’autre n’en a pas. Ça crée une disparité terrible, et on est mal à l’aise, nous, avec ça, mais évidemment on fait notre travail quand même.
Alors, dans ce sens-là, c’est sûr et certain qu’il y a vraiment une très grande disparité, puis il faut vraiment faire attention. Puis on est là, nous, quand il y a un abus comme tel, selon 45.1, d’appeler le juge, dire: Écoutez, moi, je ne suis plus capable de faire l’interrogatoire, il y a de l’abus de créé par quelqu’un, qui est, en général, un avocat de l’autre partie.
Mais ça se limite particulièrement dans les 543. Peut-être que d’autres sténographes l’ont vu dans d’autres interrogatoires, mais il y a un élément aussi important, c’est que j’ai travaillé beaucoup à la cour où un justiciable se représentait lui-même, et les juges avaient une tendance à protéger le justiciable contre les intérêts, parfois, d’autres personnes. On est tous un peu mal à l’aise quand un justiciable se présente sans avocat, et le meilleur conseil qu’on peut donner à un justiciable: Bien, écoute, essaie d’avoir un avocat, il y a de l’aide juridique aujourd’hui, il y a toutes sortes de moyens. Je m’imagine mal, pas de sténographe, un interrogatoire fait par un justiciable avec je ne sais pas quel moyen, comment on va pouvoir protéger ses intérêts.
M. Longtin (Jean-François): Peut-être pour…
La Présidente (Mme Rotiroti): Rapidement, oui. Rapidement, Me Longtin.
M. Longtin (Jean-François): Bien, en fait, c’est dans le même…
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, allez-y.
M. Longtin (Jean-François): Dans la même foulée, c’est qu’il faut voir aussi l’envers de la médaille, parce que, oui, il y a des justiciables démunis se représentant seuls et qui ont tout l’avantage d’avoir un tiers officier de justice qui va mettre de l’ordre, mais nous, comme avocats, représentant certaines parties, à l’occasion on est confrontés à des justiciables se représentant seuls, et tout le monde connaît la notion de quérulence. Il y a des justiciables qui se représentent seuls parce qu’il n’y a pas d’avocat — il faut bien le constater — qui va soutenir la cause parce qu’insoutenable, mais on ne peut pas empêcher le justiciable de générer un tel litige. Mais je vous prie de me croire que, lors d’interrogatoires hors cour, en présence d’un justiciable qui n’a pas été encore déclaré quérulent et qui exerce ses droits, ce n’est pas drôle, ce n’est pas drôle. Le sténographe aussi peut intervenir dans ces circonstances-là, il est toujours officier de justice. Sinon, il n’y en aura pas, d’interrogatoire hors cour, parce qu’en plus ce justiciable-là ne connaît pas les règles de procédure, les règles inhérentes à l’objection, etc., alors ça devient l’anarchie. Ça aussi, c’est un élément à considérer.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. Alors, on retourne au groupe parlementaire qui forme le gouvernement. M. le ministre.
M. Fournier: Mme la Présidente, peut-être juste pour une remise en contexte. Ma collègue le disait, parce que souvent on se réfère à certains éléments. Je vais prendre le premier, celui sur les interrogatoires. Le rapport d’évaluation qui a été fait de la réforme du Code de procédure civile de 2002, qui a été discuté, il y avait… et je cite le rapport: «Le premier constat, sur lequel tous les groupes consultés sont unanimes — “groupes consultés” étant magistrature, Barreau, greffiers, praticiens, je veux dire, juste pour qu’on se remette dans le contexte — c’est que l’expertise en matière civile et commerciale constitue, avec les interrogatoires préalables, [...]la principale source de délai et de coûts élevés des actions en justice.» Je ne veux pas partir un litige entre vous et nous, mais simplement pour dire que j’entends votre expérience, mais on ne fait pas ça pour rien non plus, là. Ce n’est pas parce qu’on a écouté la TV hier soir puis qu’on pense qu’il fallait faire ça, là, c’est parce que, depuis une dizaine d’années déjà, il y a des gens qui planchent là-dessus, des gens qui… et plusieurs. Ce n’est pas deux personnes, là, tu sais. Je parle du Barreau, je parle de la magistrature. Tu sais, ça commence par faire du monde qui sont assez impliqués dans le dossier. Alors, comment je peux dire qu’ils ont tort?
Je vais commencer par juste ceci, là: Avec tout respect, là, des expériences que vous nous relatez, quelle est l’étude que vous avez faite qui peut, pour moi, contrecarrer celle qui existe depuis une dizaine d’années et qui dit: Il y a une problématique d’interrogatoire — pour laquelle je ne cherche pas à dire qu’il y a une culpabilité chez l’avocat? Je comprends bien que l’argumentation pour le règlement… pour l’interrogatoire hors cour, c’est: Le sténographe peut nous prémunir de l’avocat exagérant, mais qu’il n’y en a pas dans l’interrogatoire. Je comprends qu’on a le même argument à l’inverse selon ce qu’on est en train de discuter, là. Mais commençons par l’interrogatoire. Ce qui est constaté, c’est qu’il y a une problématique. Alors, moi, j’ai le choix, je ne me ferme pas les yeux puis je dis: On essaie de faire quelque chose. Admettons que vous partez du même point que moi, là, il y a une problématique. Qu’est-ce qu’on fait?
**(16 h 40)**
M. Longtin (Jean-François): La citation — parce que ça avait retenu mon attention, ça, j’ai eu connaissance de cette citation-là — ce que je comprends d’abord, c’est que le premier constat en question, là, sur lequel tous les groupes consultés sont unanimes, c’est que l’expertise en matière civile et commerciale constitue la principale source de délai. On rajoute «avec les interrogatoires au préalable, et même davantage». Donc, je ne pense pas que l’interrogatoire au préalable… C’est une composante, là, qui a été ciblée, mais je ne pense pas que ce soit le principal morceau de cette… en anglais, ce «statement» là.
Mais, une fois qu’on a dit ça, c’est qu’écoutez, là, l’argumentaire au soutien de ça, je ne le connais pas. Je dois vous dire, là, on peut l’évoquer, mais je ne connais pas l’argumentaire. Et curieusement… Et puis je plaide ma méconnaissance de ça, si vous me permettez, là, mais je ne vois pas d’argument qui permet de soutenir que l’interrogatoire au préalable en soi constitue une embûche à l’accès à la justice et une augmentation des coûts.
M. Fournier: Non, ne faisons pas dire au texte ce qu’il ne dit pas. Il ne dit pas que l’interrogatoire au préalable, par sa nature, est une embûche, c’est l’utilisation de l’interrogatoire au préalable. Pas dans l’avocat qui a été défini sur les interrogatoires au préalable mais l’avocat qui a été défini sur hors cour, cet avocat-là a été vu comme parfois… pas dans tous les cas, mais qu’il peut aller au-delà de moyennes qui sont d’ailleurs stipulées ici, dans le code, là. La proposition, c’est d’arriver avec quelque chose qui permet de représenter ce qui statistiquement est conforme à une certaine réalité. C’est quand ça va au-delà où, là, on dit: Il doit y avoir une certaine limite. C’est pour ça que c’est là.
Mais je comprends très bien. Votre point, c’est de dire: Il n’y en a pas, de problème, ça fait que ne mettez pas de limite. Mais, s’il y en a un, là, je suis obligé de faire de l’aveuglement volontaire, hein, soit dit en passant.
M. Longtin (Jean-François): Si vous me permettez, je ne vous dis pas qu’il n’y a pas de problème et je ne vous dis pas que ça n’arrive pas, des abus. Écoutez, j’en vois dans ma pratique, là, des gens qui utilisent l’objection comme un moyen d’embûche au cheminement d’un interrogatoire. C’est malheureux, mais, je vous dirai, c’est l’exception, et c’est l’exception qui confirme la règle à l’effet que c’est utile.
Mais imaginons par contre qu’on met un frein, qu’on met des embûches au principe même des interrogatoires au préalable, avant ou après défense. C’est que la preuve qui ne sera pas faite là, elle va devoir être faite, et là on retombe dans le panneau de l’époque d’avant les préalables où, là, le procès devient une boîte à surprise, et ça, c’est dangereux, et ça, ça va coûter cher.
M. Fournier: …pas de problème, mais ce n’est ni blanc ni noir, c’est gris, puis on est dans le gris, là. Je ne pense pas qu’on veut revenir à ça, on veut justement ne pas tout mettre à procès. Honnêtement, je pense qu’il y a un compromis qui a été fait ici.
M. Longtin (Jean-François): Mais, si vous me permettez, en conclusion, là, à ce sujet-là, écoutez, ce n’est pas simple, là, et puis je vous le dis encore comme avocat, mais j’assiste ici l’APSOQ, là, mais je vous dirais que… à ce moment-là, rehaussez, encadrez encore plus le rôle du sténographe. Les abus qui seraient commis dans le contexte qu’on décrit ici ne seront plus commis si l’article 45.1 faisait l’objet d’un…
M. Fournier: Allons-y, merci. C’est le sujet, là, on est dans la même ligne. 45.1, vous l’utilisez de façon courante, quotidienne ou exceptionnelle, que le sténographe…
M. Longtin (Jean-François): Exceptionnelle.
M. Fournier: Exceptionnelle?
M. Boudreau (André): Oui, parce que les avocats n’abusent pas, en général. C’est ce qu’on essaie de dire aux justiciables: Ayez confiance aux avocats.
M. Fournier: Est-ce que… Là, je vais exagérer, O.K., levez-vous pas pour venir me battre, je vais exagérer, là: Si c’est exceptionnel, pourquoi mettre des limites et des contraintes comme celle d’avoir un sténographe?
M. Boudreau (André): C’est parce que, si ça arrive une fois, c’est une fois de trop.
M. Fournier: Qu’en est-il des cas où il y a abus des interrogatoires? S’il arrive une fois, c’est une fois de trop. Il faut mettre des limites.
M. Boudreau (André): Bien là, écoutez…
M. Fournier: J’essaie de… J’utilise l’argument d’un côté et de l’autre, là. C’est le même, non?
M. Boudreau (André): Vous savez, si vous me permettez, honorable ministre…
M. Fournier: Oui.
M. Boudreau (André): …quand j’ai lu ça, ce paragraphe-là, c’est suite aux explications de Jean-Pierre Ménard, je pense, que j’ai lues attentivement, et, quand je regarde le premier constat, sur lequel tous les groupes consultés… je crois que l’association des sténographes n’a jamais été consultée. Les premiers intervenants en cette matière, ce sont les sténographes officiels; on n’est pas consultés.
Devant le comité Ferland, Dr Ferland, en 2000, on a fait un mémoire, vous savez, et on dit ceci: Soyons pratiques, la prise des notes sténographiques est la partie la moins coûteuse du processus. Et il y a eu un échange entre tout le monde. Pourquoi éliminer une garantie de qualité s’il n’y a pratiquement aucune économie? A-t-on déjà songé à demander à l’Association professionnelle des sténographes officiels du Québec des suggestions quant à l’application de nouvelles procédures ou sur des économies qui pourraient être faites? Je me souviens très bien que le secrétaire de la commission m’avait rappelé quelques semaines plus tard parce que ça l’avait frappé, ce paragraphe-là, en disant: Oui, c’est peut-être vrai, on devrait peut-être vous consulter beaucoup plus souvent.
Ici, sur un élément plus qu’important, les premiers intervenants en cette matière ne sont pas consultés. On aurait eu beaucoup de choses à dire. C’est sûr qu’aujourd’hui on est pressés par le temps. Si vous aviez deux jours, on pourrait vous parler longuement de tout ça.
M. Fournier: …quelques mois.
M. Boudreau (André): Bien, ça, on pourrait revenir.
M. Fournier: C’est un avant-projet de loi ouvert à une consultation générale. Comment dire que vous n’êtes pas consultés? Je vous vois, et on a des mois, j’espère pas trop, mais quelques mois pour pouvoir en faire une mouture qui serait un projet de loi. Donc, ce n’est pas une porte fermée, c’est une main tendue. Toute proposition que vous feriez, on va l’analyser avec grand plaisir. Tant mieux, on pourra faire affaire ensemble.
Les questions que nous posons ici, par contre, parfois s’inspirent de groupes — peut-être pas le vôtre — qui ont posé des constats différents du vôtre. On va être obligés d’en tenir compte un peu. Et surtout sur la logique que vous avez sur les avocats dans les interrogatoires au préalable, l’expérience démontre qu’on peut leur faire confiance, mais, quand on est hors cour, là, un peu moins. Je veux juste vous dire que les arguments se croisent et s’entrechoquent.
M. Longtin (Jean-François): Peut-être une intervention.
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui, rapidement, parce qu’on va aller à…
M. Longtin (Jean-François): Oui. Bien, simple…
La Présidente (Mme Rotiroti): Oui. Bien, allez-y. Allez-y, Me Longtin.
M. Longtin (Jean-François): Simple remarque au sujet… parce qu’il y a toute la question du décorum, des abus dans un sens ou dans l’autre, mais… Puis, encore là, c’est le praticien qui vous parle. C’est que, vous savez, les enregistrements, on voit ça souvent dans le cadre d’interrogatoires qui sont tenus devant les tribunaux quasi judiciaires ou administratifs, qu’ils ne sont qu’enregistrés. Mais imaginons que c’est hors cour et que les décideurs ne sont pas là. C’est que, généralement, les moments chauds font l’objet d’escalades, de gens qui parlent ensemble, y compris le justiciable, et généralement ça aboutit à des inaudibles, ça. Et malheureusement la technologie de la reconnaissance de la voix n’est pas encore à point, et elle ne l’est pas non plus aux États-Unis. Ça, c’est un élément très important.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. On passe à l’opposition officielle, la députée de Joliette.
Mme Hivon: Oui. J’aimerais que vous poursuiviez. Quand vous dites: C’est un élément très important, donc même vous, les sténographes, avec la supertechnologie qui est maintenant la vôtre, il y a des moments où vous faites face à de l’inaudible et, j’imagine, de moins en moins, là. Je voudrais juste comprendre, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de vous avoir avec nous. Donc, malgré toutes les avancées technologiques, je comprends qu’il y a encore des freins, puis là, selon vous, ça, c’est un argument pour dire: Il faut que le sténographe soit présent, parce qu’il est là même quand il y a ces problèmes-là d’inaudibilité.
M. Longtin (Jean-François): Si vous me permettez, étant donné que j’ai embarqué sur ce terrain-là… M. Boudreau va compléter, là, mais je visais bien le cas de l’interrogatoire au préalable, avant défense ou après défense, hors cour. Quand on est en présence du décideur et qu’il y a un telle escalade, généralement on va crever l’abcès sur place, l’avocat un petit peu expérimenté, là, va éviter que ça reste dans le vide. Quand il n’y a pas de juge, quand il n’y a pas de décideur, si on a juste une machine, un appareil à enregistrer, malgré que ce soit très sophistiqué, un bon matin on va vouloir le faire transcrire. Même par un sténographe — ils vont vous le dire, les sténographes — on aura comme mention «inaudible», et, par expérience, les inaudibles sont souvent des moments clés.
Alors, c’était ça, ma remarque. M. Boudreau peut peut-être préciser maintenant.
**(16 h 50)**
M. Boudreau (André): La grande différence, puis, si on regarde la littérature américaine, c’est important, parce qu’ils sont beaucoup plus des sténographes que nous puis on l’a constaté aussi, c’est qu’un sténographe officiel, il a la faculté de faire répéter lorsqu’il ne comprend pas. L’enregistrement, quel qu’il soit, numérique ou mécanique, s’il y a deux, trois personnes qui parlent en même temps, quelqu’un qui tousse, il ne peut pas faire répéter.
J’ai fait, comme je l’ai dit tantôt, de la cour toute ma vie et, quand je rencontrais le juge avec les avocats pour préparer un peu le plan de match, je leur disais toujours: À l’occasion, je vais intervenir si je ne comprends pas parce qu’il y a un impondérable, le système de son… quelqu’un tousse, etc., parce que vous m’engagez pour obtenir le verbatim. C’est là qu’est la grande différence, cette obligation qu’a le sténographe d’obtenir le verbatim. Pour quoi? Pour le justiciable. C’est ça qu’est notre grande différence. Puis on n’a rien contre les moyens technologiques, au contraire. On ne dit pas que les sténographes devraient faire partie de toutes les instances, mais en litige je crois que oui.
Mme Hivon: Puis juste pour qu’on se comprenne clairement, puisqu’on parle beaucoup de coûts, et tout ça, aujourd’hui, en 2012, un interrogatoire avec la transcription, mettons, d’une durée de deux heures, ça peut coûter combien?
M. Boudreau (André): Bon, regardez bien, dans une heure il y a 60 pages environ de prises. Il y a des tarifs qui sont régis par décret. C’est ça, le fun dans notre système de droit, parce que le justiciable sait toujours combien ça va coûter ou à peu près de sténographie judiciaire. On est régis par un décret avec des tarifs: c’est 70 $ de l’heure, 3,20 $ la page pour la transcription. S’il y en a une heure, bien c’est une heure fois… 60 pages fois 3,20 $, plus 70 $ de l’heure. Ça prend quatre heures faire une heure de transcription, ça fait cinq heures pour 250 $, 300 $ environ. Puis je le dis souvent quand on fait la formation des jeunes étudiants, comment ça fonctionne. C’est le fun parce qu’il y a un décret, on ne peut pas dire: Lui, il charge plus cher, l’autre, quand c’est du litige. Si c’est des conférences, par exemple si Bell Canada utilise un sténographe pour des conférences, c’est une autre affaire, mais en litige c’est coulé dans le béton, les tarifs. C’est extraordinaire. C’est ça qui est bien.
Mme Hivon: Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Rotiroti): Vous avez terminé? Côté ministériel, est-ce qu’il y a d’autres commentaires? Non.
Alors, je voudrais remercier l’Association professionnelle des sténographes officiels du Québec. Merci d’avoir venu ce soir présenter votre mémoire.
Et on va suspendre quelques minutes pour que Mme Linda Bérubé, la prochaine intervenante, prenne place.
(Suspension de la séance à 16 h 53)
(Reprise à 16 h 56)
La Présidente (Mme Rotiroti): Alors, bonjour, Mme Bérubé. Bienvenue. Je vous rappelle que vous avez 15 minutes pour faire votre présentation, et par la suite on va procéder à la période d’échange de deux blocs de 10 minutes des deux côtés, du gouvernement et l’opposition officielle. Alors, la parole est à vous.
Mme Linda Bérubé
Mme Bérubé (Linda): Merci beaucoup, Mme la Présidente. M. le ministre, Mmes et MM. les députés, je vous remercie de m’accorder l’occasion de m’exprimer devant vous aujourd’hui. Je suis Linda Bérubé, je suis travailleuse sociale. J’ai côtoyé durant une trentaine d’années le monde de la justice, que ce soit à titre d’experte psychosociale à la Cour supérieure — où j’ai aussi été médiatrice — en tant qu’associée avec des avocates dans un centre de médiation familiale, en tant que présidente fondatrice de l’Association de médiation familiale du Québec, en tant que coauteure, avec une collègue avocate, d’un volume qui s’intitule La médiation familiale, étape par étape aux Publications CCH, en tant qu’enseignante au programme de prévention et de règlement des différends de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et aussi en tant que membre de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.
En dépit de cette expérience prolongée et ce contact avec les gens du milieu juridique, il m’arrive assez souvent de me sentir étrangère dans ce milieu, surtout quand j’entends des juristes débattre entre eux d’une question, un peu comme cet après-midi, par exemple. Dans leurs échanges, il existe un vocabulaire, des codes qui sont souvent hermétiques, et il est facile de se sentir exclu, et j’imagine que le citoyen ordinaire qui n’a pas mon expérience doit se sentir encore plus exclu. J’ai rencontré au cours d’une conférence un avocat, un jour, qui s’appelait Leonard Marlow, c’était un avocat new-yorkais, et qui m’a dit: Vous savez, faire appel à un avocat, c’est comme demander à quelqu’un de jouer une partie d’échecs à votre place; tout ce que vous pouvez faire, c’est de vous asseoir à côté et d’espérer qu’il va gagner.
C’est donc à titre de citoyenne et de médiatrice qui intervient principalement maintenant dans les conflits organisationnels, dans les conflits en entreprise et dans les conflits en matière de harcèlement, après une assez longue carrière en matière de médiation familiale… c’est à ce titre-là que je me présente à vous aujourd’hui. Mon travail situe mon intervention à l’intersection du domaine de la relation d’aide et du milieu juridique. J’occupe une place qui n’existait pas il y a 30 ans, parce qu’il y a 30 ans l’écart entre le milieu juridique et le milieu biopsychosocial — médical, psychologique, social — était encore beaucoup plus loin. Avec l’introduction des experts psychosociaux dans les cours, avec la médiation, ces deux milieux se sont rapprochés, et on peut maintenant espérer offrir aux citoyens qu’ils se sentent moins étrangers dans le milieu de la justice.
D’entrée de jeu, je veux vous dire que j’accueille très favorablement l’avant-projet de loi. Je crois non seulement pertinent, mais nécessaire d’inclure les principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement dans le livre I, le cadre général de la procédure civile.
On se demande parfois si c’est le code qui doit inclure une culture de résolution de conflits chez les citoyens ou si ce sont les citoyens qui demandent qu’on les aide à collaborer lorsqu’ils sont en conflit. C’est une question que j’ai entendu M. le ministre poser à quelques reprises. Si le législateur propose aujourd’hui d’introduire les principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends dans le livre I, c’est parce que, depuis 30 ans, le Québec a fait des pas de géant vers une justice qui est plus près des citoyens. Le terme «médiation» est dorénavant entré dans le vocabulaire, et ce, en partie — et beaucoup, je pourrais dire — grâce à la médiation familiale qui a été introduite dans la loi.
Par contre, la concurrence, la compétition en affaires, dans le sport, en politique, le débat contradictoire, Mme la députée parlait qu’elle entend toujours deux positions, et je suis bien placée pour vous dire qu’à titre d’experte psychosociale j’ai souvent entendu la position de monsieur et la position de madame et je me suis souvent retrouvée entre les deux à me dire: Qui dit vrai, qui a raison?
Donc, cette culture est encore profondément ancrée, cette culture de l’affrontement, chez nous, et ce n’est pas demain matin que le voisin de M. Fournier, auquel on a fait référence à quelques reprises dans cette commission pour évoquer le citoyen ordinaire… J’espère qu’il ne vous en rendra pas rancune quand vous allez tondre votre pelouse l’été prochain.
**(17 heures)**
M. Fournier: Je lui en ai parlé avant.
Mme Bérubé (Linda): Bon, d’accord. Ce n’est pas demain matin qu’il va s’interroger sur la pertinence d’introduire des articles sur les modes privés de règlement des différends dans le Code de procédure civile, d’abord parce qu’il n’est sans doute pas en chicane et ensuite parce que, s’il l’était et s’il a vaguement entendu parler du code civil de procédure, il n’a sans doute pas encore eu le temps de le lire.
Par contre, si sa femme lui annonce demain matin qu’elle le quitte ou s’il reçoit une mise en demeure de son voisin, là le voisin de M. Fournier va réagir. Il ne va pas se demander comment il pourrait collaborer, il va vouloir se défendre. Et comment on se défend? En allant voir un avocat, bien sûr, c’est logique. Il va lui demander, à son avocat: Qu’est-ce que je peux faire pour ne pas que ça me coûte trop cher, pour ne pas que ça me fasse mal puis pour ne pas que ça prenne trop de temps? Et c’est là que ça se corse, parce que, quel que soit le mode de résolution de conflits, cela aura un prix, cela risque d’être éprouvant et cela va prendre du temps, en médiation comme ailleurs.
Le voisin de M. Fournier ne pouvait pas se faire une opinion sur la meilleure façon d’aborder un conflit parce qu’il n’avait pas eu la nécessité, il n’avait pas eu le besoin de penser à ça avant. Et je peux vous dire que, lorsque j’avais un cabinet de médiation familiale, notre plus gros problème, c’était… On faisait de la publicité, on faisait de la publicité, mais la publicité vous passe par-dessus la tête quand vous n’êtes pas concerné. Donc, il fallait toujours renouveler la publicité pour qu’au bon moment, au bon endroit la personne qui en avait besoin soit informée, et ça, c’est tout un défi.
Le citoyen ordinaire s’intéresse à ces questions lorsque lui-même ou l’un de ses proches est concerné. Voilà pourquoi les personnes qui ont réfléchi à la question, que ce soit par leur vécu personnel, parce qu’ils l’ont eux-mêmes vécu, ou par leur vécu professionnel parce qu’ils y ont réfléchi, ils ont travaillé dans ce milieu-là… que ces personnes qui proposent des façons de prévenir et de résoudre les conflits autrement que ne le fait habituellement le système judiciaire doivent être entendues.
Ce dont le voisin de M. Fournier a besoin, c’est d’être accompagné dans une situation difficile et aidé à faire un choix éclairé sur la meilleure façon de s’y prendre pour trouver une solution à son problème, et cette façon peut changer au fur et à mesure de l’évolution de sa situation. Ça veut dire qu’à un moment donné il pourrait avoir besoin de médiation et peut-être à un même moment donné dans sa vie il pourrait avoir besoin d’une CRA ou il pourrait avoir besoin d’un avocat. Quand une situation est complexe, on ne doit pas limiter les choix, on doit ouvrir les choix. Dès que faire se peut, il a besoin d’une information complète sur les manières qui existent d’aborder son problème. Il est important qu’il soit informé de tous les choix qui s’offrent à lui et de leurs conséquences.
Les principes de la procédure applicable aux modes privés de prévention et de règlement des différends doivent être inclus dans le livre I parce que le citoyen ordinaire a besoin, lorsqu’il aura à choisir parmi les différentes orientations possibles de son dossier, de voir nommé et reconnu le chemin parcouru en matière de médiation et des autres modes de prévention et de règlement des différends. Il a besoin d’être rassuré quant à la valeur et à la pertinence de ces approches. C’est nécessaire aussi parce que les professionnels de toutes les disciplines qui se sont investis dans le développement d’approches participatives ont besoin d’être soutenus dans la poursuite de leurs efforts.
En dépit des progrès réalisés en matière de résolution de conflits, il faut admettre qu’il reste encore beaucoup de travail à faire. L’envie de collaborer n’est pas instinctive chez les personnes en conflit, c’est plutôt l’envie de défendre qui prime. Il faut cependant savoir que, chez les êtres humains, il y a toujours les deux tendances présentes à l’intérieur des personnes, l’envie de se défendre et l’envie de s’entendre, l’envie de se défendre pour dire: J’existe, je veux ceci, je tiens à cela, et l’envie de s’entendre parce que je sais que je ne pourrai peut-être pas y arriver tout seul. Donc, il s’agit de savoir laquelle de ces deux tendances-là on veut nourrir. Est-ce qu’on veut nourrir l’envie de se battre ou nourrir l’envie de se défendre… l’envie de s’entendre, plutôt?
Le citoyen moyen aux prises avec un conflit croit que son avocat va le défendre, que le juge va lui rendre justice, réparer les torts et lui donner raison. Il est souvent prêt à mettre le prix pour y arriver. Combien de fois j’ai rencontré et je rencontre encore, surtout quand j’interviens en matière de harcèlement psychologique… quand je me rends compte que ce n’est pas nécessairement des situations de harcèlement mais que les gens tiennent à avoir une enquête, tiennent à ce qu’on fasse la lumière, tiennent à ce qu’on mette les faits, tiennent à ce que ce soit présenté et que quelqu’un tranche, peu importent les coûts financiers et humains, peu importe si on sait qu’au bout de la ligne ils vont arriver sur le mur. Tout le monde le sait, mais ils veulent y aller pareil, et ils ont le droit d’y aller, et malheureusement, parfois, bien ils y vont et ils frappent le mur. Puis parfois, bien, ils réalisent qu’ils peuvent s’y prendre autrement, parfois non.
Le recours au tribunal ne permet pas de prendre en compte les multiples aspects qui sont souvent à la racine des conflits, pas parce que les tribunaux ne sont pas bons, parce que les tribunaux ne sont pas conçus pour ça, ne sont pas conçus pour comprendre les problèmes de communication, pour tenir compte des relations blessées ou brisées, de tenir compte des différences de perception ou de valeurs, de tenir compte de l’émotivité, de tenir compte des luttes de pouvoir. Après la négociation ou le procès, le litige est tranché, mais les problèmes perdurent, et les personnes en ressortent souvent amères, insatisfaites. Et, lorsque la relation se poursuit — parce que j’interviens surtout dans les conflits où il y a une forte teneur relationnelle, que ce soit dans les organisations, dans les familles, dans le voisinage — lorsque la relation se poursuit, si les gens sortent désabusés ou amers, la collaboration est difficile. Et on a parlé aussi de la cristallisation et de l’escalade des conflits. Plus le conflit se cristallise, plus la collaboration devient difficile.
J’aimerais vous raconter à ce sujet une anecdote que j’ai vécue lorsque je travaillais ici, au palais de justice à Québec. Il y a une dame qui arrive à mon bureau un jour et qui entre, me tend un document. C’était le jugement de divorce. En tendant le document, elle me dit: J’ai eu la garde des enfants, j’ai eu la maison, je peux conserver la maison, j’ai eu la pension alimentaire que je demandais. Alors là, je lui dis: Qu’est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit: Il n’y a rien qui marche. Bon. Alors là, elle venait en médiation pour dire: Qu’est-ce qu’on peut faire, parce qu’il ne vient pas chercher les enfants, il ne les ramène pas en temps? La pension, bien, heureusement que… C’était avant que l’État aide à payer les pensions alimentaires, donc il fallait qu’elle coure après. Donc là, elle voyait que la justice… elle a compris elle-même que la justice pouvait décréter des critères objectifs à respecter dans ce qui est dans le code mais que tous les interstices, tout ce qui fait la vie quotidienne des gens et qui n’est pas dans le code, bien, ça, c’est en dehors du tribunal que ça se règle, et ça prend de la bonne volonté, et ça prend le désir de s’entendre.
C’est une grande richesse, d’avoir des tribunaux qui nous permettent le loisir d’être capable d’avoir quelque chose qui n’est pas dans les tribunaux mais de savoir qu’il y a un cadre et que, si ça ne fonctionne pas dans le cadre informel, bien il y aura toujours un cadre formel pour contenir des litiges qui ne peuvent se régler de façon informelle. Et je tiens à souligner que c’est parce qu’on a cet État de droit qu’on peut avoir la médiation. La médiation n’existe pas dans les États où c’est la… j’allais dire l’autarcie, mais ce n’est pas le terme, là, mais la dictature. L’État existe dans les États… La médiation existe dans les États de droit.
Donc, c’est une grande richesse, mais l’application des seules règles de droit dans les conflits à forte teneur relationnelle a plutôt tendance à exacerber les conflits, car les conflits interpersonnels sont complexes, et ce type de conflit ne peut se régler de façon efficiente et adéquate, comme le veut le code, si l’on s’en tient à la seule normativité juridique. C’est pourquoi il est important que le code suggère aux citoyens d’élargir leurs discussions aux valeurs, aux intérêts, aux besoins des protagonistes eux-mêmes, aux questions sur lesquelles eux seuls ont le pouvoir, c’est-à-dire les questions de la vie réelle au quotidien, et, si on veut tenir compte des situations relationnelles particulières, parvenir à des solutions sur mesure et durables.
**(17 h 10)**
À l’article 1, on peut lire: «Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend…» Cette obligation faite aux parties est un choix de société qui va dans le sens de nourrir chez les personnes le désir de s’entendre. Cet article a la force nécessaire pour induire des changements, mais il m’apparaît insuffisant. Il permet de s’assurer que les acteurs juridiques prennent au sérieux la volonté du législateur de voir le citoyen considérer les différentes avenues qui s’offrent à lui. L’inscription de la médiation familiale dans la loi qui est entrée en vigueur en 1997 a permis l’essor de la pratique et a suscité un intérêt accru du Barreau pour les modes extrajudiciaires de règlement. Par contre, obliger de tenter le recours aux PRD irait, selon moi, à l’encontre de l’aspect volontaire du processus et risquerait de créer une connotation négative. Les modes privés seraient alors perçus comme une étape obligatoire qui, en plus d’augmenter les coûts, viendrait alourdir le cheminement du dossier.
La médiation n’est pas une étape vers la justice, c’est un autre choix, c’est quelque chose de différent. C’est d’autres valeurs, c’est fondé tout à fait sur d’autres principes. Et souvent on voit la médiation comme une étape progressive, on s’en va lentement vers le tribunal, et j’affirme que ça ne devrait pas être vu de cette façon-là.
Donc, l’interrogation qui est la mienne est la suivante: Comment les parties vont-elles pouvoir considérer le recours aux modes privés de PRD? C’est bien de le mettre, mais «considérer», ça veut dire quoi, ça, «considérer»? Puis j’ai entendu vaguement, tout à l’heure, «considérer suffisamment» puis je n’ai pas entendu le reste. Le code est muet à ce sujet. Comment ça va se faire, ça? Et j’imagine que tout le monde a des idées différentes là-dessus, comment ça va se faire, et c’est ici que l’article m’apparaît insuffisant et que j’aimerais apporter quelques suggestions.
Me Jack Miller, dans son témoignage devant cette commission, invitait à mettre en place un processus — en tout cas, du moins, c’est comme ça que je l’ai compris — pour ne pas laisser à la discrétion des avocats et des juges la manière d’aider les parties à considérer les modes de PRD, et je me permets quelques suggestions. Je crois que les avocats devraient devoir sérieusement, et non uniquement pour satisfaire à la règle, informer leurs clients des différentes possibilités qui existent pour régler leurs problèmes ou leurs différends et de réfléchir avec eux à la meilleure voie à prendre, compte tenu des circonstances. Les juges devraient, quant à eux, avant d’entendre toute cause, demander explicitement aux parties et à leurs avocats si elles ont envisagé sérieusement la possibilité de régler leur différend en privé et, si cela n’a pas été possible, leur demander pourquoi cela n’a pas été possible. Enfin, les étudiants en droit devraient absolument avoir en première année un cours obligatoire sur les modes de PRD et sur la manière dont l’introduction de ces façons de prévenir et de régler les conflits modifie le rôle traditionnel de l’avocat.
J’ai deux autres suggestions à faire en terminant. À l’article 609 du livre VII, on peut lire: «Il n’y a pas de manquement à l’obligation de confidentialité pour le tiers qui assiste les parties, le médiateur ou l’arbitre s’il s’agit de fournir de l’information à des fins de recherche, de statistiques ou d’évaluation générale», etc. En tant qu’enseignante, j’utilise souvent, en les rendant bien sûr anonymes, des exemples tirés de ma pratique. Je suggère donc d’ajouter que la confidentialité soit étendue aux fins éducatives. Donc, après «pour des fins de recherche, des fins éducatives, des fins statistiques», je suggère d’ajouter «fins éducatives».
À l’article 6, on laisse aux parties et à l’intervenant la possibilité de convenir d’utiliser une approche qui leur convient mieux que celle décrite dans le Code de procédure civile. Il existe plusieurs modèles de médiation. Disons qu’en général les gens parlent de médiation, on connaît le mot «médiation», mais très peu de gens connaissent véritablement comment il existe de modèles.
Un chercheur américain, dans un article que je lisais récemment, un auteur qui s’appelle Lewicki, en a recensé, quant à lui, 44 modèles. C’est sûr que, bon, il y a des modèles qui se ressemblent, mais grosso modo il y a comme trois types de modèle. Il y a des modèles qui sont… Les médiateurs qui viennent du domaine juridique sont plus tentés de regarder un modèle qui considère beaucoup la loi, les règles de la loi, donc on a une médiation évaluative. D’un autre côté, les gens qui viennent du domaine psychosocial vont plus dans une médiation qui est relationnelle. Et entre les deux, là où je me situe, c’est comme à l’intersection de ça, c’est-à-dire qu’on tient compte à la fois des aspects financiers, à la fois des aspects humains et on tente d’accompagner le justiciable et la… pas le justiciable mais la personne qui recourt à nos services de cette façon. C’est ce mode intégrateur qui est préconisé à titre de suggestion, disons, dans le code, à titre supplétif — c’est le terme, je crois — et les autres sont permis. Je suggère quand même que, puisqu’il existe plusieurs modèles, pour plus de clarté sur le modèle adopté par le médiateur, ce dernier soit invité, à l’article 615, à décrire à ses clients la nature exacte du modèle de médiation qu’il préconise, les caractéristiques de ce modèle, ses valeurs, ses finalités et ses modalités ainsi que ses critères de succès.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci, Mme Bérubé. On va passer à la période d’échange, on va passer au côté ministériel. M. le ministre.
M. Fournier: Merci beaucoup de votre présence avec nous. Ça finit… Je ne devrais pas dire ça. J’allais dire: Ça finit bien la journée, là, mais je ne devrais pas dire ça, je ne veux pas porter de jugement sur comment elle a commencé ou comment elle s’est poursuivie durant la journée. Mais en tout cas, au moins, ça ramène un son de cloche qu’on entendait plus dans la première semaine, qu’on avait perdu un peu de vue durant la journée et, bon, qu’il fait du bien d’entendre.
Je regardais, là, votre pedigree et je constate une expérience assez poussée dans le domaine. J’aimais bien comment vous nous parliez du fait que les gens… Aujourd’hui, on s’est posé la question: Est-ce que les gens veulent… Enfin, je vais refaire… je vais retourner en arrière. Vous avez dit: Des fois, en médiation familiale, il y a la vérité de monsieur et la vérité de madame, et je me souviens, pour le peu de temps que j’ai pratiqué, qui était beaucoup en matière familiale, où j’en avais conclu que finalement il y avait deux vérités, il n’y en avait pas une, il y en avait juste deux, puis il fallait vivre avec le fait que parfois il y a des vérités qui s’entrechoquent, mais c’est des vérités qui sont la perception que les gens ont, puis il ne faut pas nécessairement chercher dès le départ à faire une seule vérité. Et, de cette nuance, vous nous avez aussi amenés à voir qu’il y a l’envie de s’entendre et l’envie de se défendre ou l’envie de combattre, et aujourd’hui il y avait avoir son jour à la… sa journée à la cour et qui était présenté par un des groupes qui est venu nous voir, qui a dit: Bien non, ce que les gens veulent, c’est vraiment ça, là, ils veulent avoir leur journée à la cour, là, le juge va décider, et puis l’observatoire qui est venu plutôt dire que, non, généralement les gens veulent juste régler le problème. Alors, probablement, quand c’est deux vérités, il est inutile d’essayer de voir la vérité mais juste tenir compte qu’il y a des différentes façons de voir la chose.
Un des éléments essentiels pour lequel je voudrais profiter de votre présence… Ma collègue de Joliette nous habitue à des questions sur l’article 5, et je vais prendre les devants. Je suis sûr qu’elle était pour la poser, alors je vais la poser, quitte à ce qu’elle puisse revenir en additionnelle sur le sujet.
Vous avez fait la profession, dans le fond… enfin, la profession de foi de la multidisciplinarité et du fait qu’il y a quelque chose comme la règle de droit, qu’il peut y avoir ouverture à d’autres guides pour régler un litige. À l’article 5 du projet de loi, on dit: «Les parties peuvent prévenir ou régler leur différend en faisant appel à des normes et à des critères autres que ceux du droit…» Est-ce que cela vous fait offense ou cela est une façon pour vous de voir… Parce que vous nous avez parlé des différents types de médiation, évaluative, relationnelle. Est-ce que nous avons besoin d’un libellé comme celui-là pour ouvrir ou donner toutes les chances à la médiation, pour qu’elle s’intéresse au-delà du litige et qu’elle concerne aussi le conflit?
Je vous pose la question parce qu’une des façons de le voir, c’est de dire: Si ce n’est pas le droit, bien alors peut-être que c’est les valeurs religieuses, et ça, tout de suite on a un effet un peu de: Si c’est des valeurs religieuses, de quoi on parle, là? Là, ce n’est comme plus dans l’ordre juridique représentatif, démocratique, c’est comme dans l’ordre juridique presque du droit canonique, si on parle de certains types, et là on est un petit peu sur la défensive. En même temps, j’avais plutôt l’impression que le libellé servait ici à dire non pas la religion mais d’autres aspects que la norme juridique. C’était un peu ce que je croyais qu’on voulait dire.
Est-ce que vous avez besoin de ce libellé-là pour aller au-delà du litige juridique et vous adresser aux problèmes communicationnels ou relationnels?
**(17 h 20)**
Mme Bérubé (Linda): Il m’apparaît que c’est essentiel d’avoir ce libellé-là pour nous permettre d’élargir le conflit à cette dimension. Puis je vais vous faire rire un peu. Je dis souvent à mes étudiants: Un litige, c’est comme un pruneau sec, et le conflit, c’est comme un pruneau dans lequel on a remis de l’eau, c’est-à-dire qu’on l’a fait gonfler puis il est plus mou, il est plus… C’est drôle, les étudiants trouvent ça amusant quand je dis ça, mais c’est qu’il faut redonner sa substance au conflit pour que le citoyen le comprenne, parce que, comme je disais, si on joue une partie d’échecs, les citoyens ne comprennent pas du tout, puis c’est la norme juridique…
La plupart des conflits ne sont pas d’ordre juridique, on prend la règle de droit pour régler le conflit. Mais, si on prend, par exemple, en médiation familiale, quand on demande aux gens c’est quoi, les problèmes quand on se sépare, bon, bien c’est des problèmes de couple, des problèmes de parent, des problèmes de maison, des problèmes de voisinage, des problèmes de pension alimentaire, d’argent, puis là, finalement, quand on dit c’est quoi, là, la dimension juridique arrive toujours en dernier.
Par ailleurs, quand quelqu’un songe à se séparer, la première affaire qu’il pense, c’est d’aller voir son avocat. C’est assez bizarre comme paradoxe, mais il n’empêche que, quand on vient en médiation, on sait que la loi existe, puis, la loi, il y a un auteur qui disait… Mnookin disait qu’on négocie à l’ombre de la loi. La loi est importante, les gens la connaissent, puis il suffit d’avoir pratiqué avant la loi sur le patrimoine familial puis après la loi sur le patrimoine familial pour voir l’influence que la loi a eue en médiation. Par contre, en médiation on ne parle pas de loi. On parle d’argent, on parle de temps, on parle d’émotions, on parle de relations, de communication, et la loi vient comme… est à côté comme une espèce de balise qui nous aide à voir qu’est-ce qui se fait en général dans la société.
Mais, si on ne met pas ça, qu’est-ce qui va arriver? Le danger que je trouve, c’est qu’on ait une médiation qui devienne quasi juridique.
Tout à l’heure, au cours de la journée, il y a des personnes qui ont mentionné ici, devant vous, que la médiation est maintenant pratiquée la plupart par des avocats, et c’est le cas. Alors que c’étaient des travailleurs sociaux, au début, qui étaient en majorité, c’est devenu des avocats. Bon, je veux bien.
Maintenant, la situation fait que, si on est avocat, on ne pense pas comme un travailleur social. Puis ce n’est ni bien ni mal, c’est comme ça. Et, si on est un avocat, on a la tête formatée d’une certaine façon, puis je peux vous dire que le formatage, il est assez dur à déformater. Ceux qui se déformatent, c’est un peu des extraterrestres, un peu…
Une voix: …
Mme Bérubé (Linda): Hein?
M. Fournier: On vient en politique pour se déformater.
Mme Bérubé (Linda): Bien, c’est ça. Ça, ça aide. Mais ce que je veux dire, c’est qu’on est habitués de penser d’une certaine façon, et c’est très difficile de changer notre façon de faire, et c’est ça que, si on ne met pas ça, si on ne parle pas de critères autres que ceux du droit, bien là tout le monde va rentrer dans la médiation évaluative, puis là on va être rendus avec une petite justice vite fait de qu’est-ce que c’est, vos droits, puis qu’est-ce que c’est qu’un juge dirait à votre place, si vous allez devant lui, puis je trouve qu’il y a un risque d’enlever cette…
M. Fournier: Je vais prendre à contre-pied ce que vous me dites. Si c’était une médiation d’avocat, vous y voyez quelqu’un qui est formaté et vous y voyez peut-être, bon, une petite justice. Mettons-nous dans les souliers d’un avocat-médiateur. Ne pourrait-il pas dire que, dans le cas de quelqu’un, par exemple, comme vous, qui est formaté différemment, on y perdrait certaines substances juridiques, légales de base qui doivent néanmoins faire partie de la médiation?
Ma lecture à moi, c’est que, dans le fond… Puis dites-moi si je me trompe, je ne suis pas un médiateur, je n’ai pas votre expérience. Mais, lorsqu’intervient une médiation entre deux parties, pour laquelle il y a un conflit parfois défini en termes de litige juridique aussi, là, il y a une partie juridique là-dedans, quelqu’un qui n’est pas formaté juridique ne perd-il pas de vue les aspects de droit?
Mme Bérubé (Linda): …l’aspect de droit, on est formés comme médiateurs que, si ça dépasse nos compétences, nos capacités, on réfère à des conseillers juridiques. Donc, en tout temps, les parties peuvent combler les lacunes du médiateur, et ce qui est une lacune — effectivement, ça peut être une lacune de ne pas tout connaître — peut être compensé de d’autres façons.
Et vous avez tout à fait raison de dire que, quand on se situe au milieu, les juristes ont des lacunes sur la connaissance du facteur humain, puis les travailleurs sociaux, ou psychologues, ou autres ont des lacunes du milieu juridique. Et ce n’est pas mauvais d’avoir des lacunes, parce que, si on fait, en dehors du système formel, la même chose que dans le système formel, bien ça ne sert à rien d’avoir un système informel.
M. Fournier: Je veux juste changer de sujet. J’aimais bien que vous nous disiez que, dans le fond, les lacunes font partie de notre monde, et ce n’est pas si mauvais que ça.
Vous avez défini vous-même, vous avez dit… D’ailleurs, c’est étrange parce que c’est deux groupes opposés qui se sont intéressés au mot «considérer» et qui, les deux, le trouvaient pas trop performant mais arrivent presque à la même définition. Vous dites: Oui, considérer, ce n’est pas trop clair. Ce qu’il faudrait, c’est nous assurer que les avocats informent des possibilités et réfléchissent sur les meilleures voies à suivre et…
Mme Bérubé (Linda): …plus complète. Je ne dis pas que le terme «considérer» n’est pas adéquat, mais j’aimerais qu’il soit explicité, qu’on…
M. Fournier: Bien, je ne sais pas jusqu’à quel point les libellés racontent toute l’histoire et les libellés font la jurisprudence avant que la jurisprudence se fasse elle-même, mais j’avais plutôt l’impression que ça ressemblait pas mal à «considérer», ça, et sans qu’il y ait besoin de mettre «suffisamment considérer», auquel cas, là, on commence à ajouter…
Mme Bérubé (Linda): Là, on est sur l’interprétation.
M. Fournier: Et ce n’est pas le choix qui est fait. Mais je crois que le groupe qui précédait cherchait à nous dire que «considérer» pouvait soulever des problèmes. Et quoi de mieux que d’y ajouter un qualificatif pour que le problème soit encore plus grand?
Mais vous l’avez vous-même défini. Considérer, ce n’est pas entrer dans le jeu de la médiation, c’est se dire, un: Cela existe, est-ce que tu es ouvert à ça?, deux: Quelles en seraient les conséquences? Quelle est la conséquence de la médiation, qu’est-ce qu’on va y envisager? Quelle est la conséquence du processus plus traditionnel, qu’est-ce qu’on va y rechercher? La question des coûts, la question des… Enfin, considérer, c’est ça, et je ne crois pas que ça fasse nécessairement peur à personne.
Je conclus sur cette première partie parce que j’ai beaucoup en tête le Barreau canadien qui est venu nous voir tantôt et qui semblait craindre pour la justice adjudicatrice d’ouvrir cette voie-là. Diriez-vous que, dans la médiation, on est dans l’espace du contrat, du consensus, de l’échange de volontés des parties — un contrat, c’est ça, c’est un échange de volontés — qui ne se fait pas, en tout cas dans la plupart des cas — je n’en ai pas d’exemple, de contrat — devant un juge? Je veux dire, c’est la rencontre de volontés de personnes, et ça ne fait pas offense au Barreau, j’en suis persuadé, de reconnaître que, dans notre société, on peut permettre l’échange des volontés hors présence d’un juge.
Mme Bérubé (Linda): Et je trouve que le fait de l’énoncer dans un code de procédure donne toutes ses lettres de noblesse à cette possibilité-là. Ou on y croit, à la participation du citoyen, puis, si on y croit, on le dit, ou bien on laisse la justice comme c’était avant, avec l’écart qui se creuse entre les enceintes formelles et le reste du monde.
Pour moi, c’est une façon de créer une passerelle, c’est comme dans l’antichambre de la justice, de dire: Avant de pénétrer en ces lieux, réfléchissez. Est-ce que c’est vraiment ça que vous voulez? Parce que, moi, quand je reçois des gens en médiation, je réfléchis avec eux. Je ne prends pas pour acquis qu’ils viennent en médiation, je ne prends pas pour acquis qu’ils sont motivés à la médiation. Je fais toujours: Qu’est-ce que vous voulez accomplir? Comment vous voulez l’accomplir? Quelles sont vos attentes? Puis des fois ce n’est pas la médiation qui répond à leurs besoins.
Donc, je trouve que tout bon professionnel devrait être capable d’établir un diagnostic sur la situation, qu’est-ce que les gens sont prêts à faire, qu’est-ce qu’ils ne sont pas prêts à faire, et de ne pas prendre pour acquis qu’ils sont le seul magasin qui existe. C’est sûr qu’autrefois, quand il y avait juste un magasin général puis il fallait aller tous à la même porte, bien tout le monde allait là, on ne se posait pas de question, mais, si maintenant il y a plusieurs portes, chaque magasin devrait être capable de dire qu’est-ce qu’il vend puis à quoi les clients peuvent s’attendre.
M. Fournier: Je voudrais juste revenir sur les portes…
La Présidente (Mme Rotiroti): Allez-y.
M. Fournier: …parce que vous avez dit tantôt: La médiation, c’est un autre choix, ce n’est pas un préalable au processus d’adjudication. En même temps, on comprend bien que c’est un autre choix qui ne ferme pas la porte. Sans que ce soit un préalable à l’autre, il ne ferme pas la porte, il ne disqualifie pas l’autre moyen. Dans la façon dont vous le communiquez avec les gens qui viennent vous voir, c’est de ça dont vous les informez?
Mme Bérubé (Linda): Exact, et c’est rassurant. C’est ce qui permet d’ailleurs… C’est cette possibilité, si ça ne fonctionne pas, qu’il y a d’autres places à aller et qu’on peut toujours s’en sortir qui rassure les parties en grande… principalement.
M. Fournier: Donc, de l’envisager — j’ai l’impression de plaider a posteriori — de l’envisager et de le considérer ne fait pas perdre les lettres de noblesse à la justice adjudicatrice, laquelle, évidemment, pourrait profiter de certaines bonifications contenues dans le Code de procédure, le nouveau, le projet de loi, pour avoir encore plus de noblesse. Merci beaucoup.
Mme Bérubé (Linda): Merci.
La Présidente (Mme Rotiroti): …l’opposition officielle. Mme la députée de Joliette.
**(17 h 30)**
Mme Hivon: Oui, bonjour. Merci, Mme la Présidente. Merci de votre présentation.
Justement, bien, je vais poursuivre un peu sur la même voie. Du fait que vous insistez pour dire que la médiation ou autre forme de justice privée existe en elle-même, ne doit pas être vue comme une étape, un préalable ou tout ça, je voulais savoir comment vous réagissez par rapport à l’article 7 qui dit que «les parties peuvent s’adresser aux tribunaux si elles ne réussissent pas à régler leur différend par la voie privée». Alors, c’est comme… en fait, on est dans une idée où ce n’est pas un préalable, peut-être, formel, mais tantôt c’est parce qu’on nous soulevait que certains se questionnaient à savoir est-ce que justement on n’était pas en train d’en faire un préalable formel du fait qu’on dit «si elles ne réussissent pas à s’entendre». Vous, par ailleurs, vous dites: Ça doit exister en soi et ne pas être vu ou instrumentalisé comme une étape avant de tomber dans le processus formel.
Mme Bérubé (Linda): Je suis ferme là-dessus, parce que ce serait de détruire la médiation, d’après moi, que de faire ça.
Mme Hivon: Mais, selon vous, l’article 7 est correct, est compatible avec l’idée que ça peut rester un élément en soi?
Mme Bérubé (Linda): Oui, parce que, comme disait M. le ministre tout à l’heure, bien que ce soit un choix, ça n’empêche pas qu’après tu peux faire un autre choix. Si ce choix-là ne fonctionne pas, tu peux décider de choisir autre chose, de la même façon que, même si tu vas devant le tribunal, tu peux décider aussi de choisir de revenir en médiation si ça ne fonctionne pas. Donc, les portes restent ouvertes, et l’article 7 ne m’apparaît pas… En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème.
Mme Hivon: Parfait. Je ne pensais pas parler de l’article 5, mais le ministre l’a fait. Mais je vais y revenir parce qu’en fait ce qui, moi, m’intéressait beaucoup, c’est parce que c’est le fait que vous n’avez pas une formation d’avocate, vous en avez fait énormément, et je voulais savoir si des fois il y avait eu des circonstances où il y avait dû y avoir un arrimage, en quelque sorte. C’est quelque chose dont on nous parle beaucoup, surtout de la part des juristes, l’arrimage entre la justice privée et la justice publique. Donc, j’imagine que, dans vos médiations, la place que le droit occupait était assez limitée dans le travail que vous faisiez.
Mme Bérubé (Linda): Comme je ne suis pas juriste, expliquez-moi quand vous parlez de la justice publique. Vous voulez dire les tribunaux, vous voulez dire quoi?
Mme Hivon: Oui, c’est ça.
Mme Bérubé (Linda): O.K. Bien, écoutez, quand je fais de la médiation familiale, en médiation familiale il y a beaucoup de points de droit, c’est-à-dire il y a beaucoup d’aspects juridiques. Le partage du patrimoine, la pension alimentaire, c’est toutes des choses qui sont fixées par la loi. Donc, en tant que médiatrice familiale accréditée… Et je n’étais pas accréditée, parce que je pratique depuis 1982. Donc, j’ai été 15 ans pas accréditée avant que la loi nous oblige à être accrédités. Même avant d’être accréditée, je connaissais assez les aspects légaux, puis je crois pouvoir dire que c’est justement pour ça que je me suis associée avec des avocates, pour être capable de… On a voulu offrir des services interdisciplinaires — j’ai écrit un livre là-dessus — justement pour jumeler.
C’est pour ça que je suis ici aujourd’hui. Ça fait 30 ans que je milite, si je peux dire, pour qu’on travaille ensemble, parce que c’est le citoyen qui va en bénéficier si on est capables de faire le pont entre le juridique… Et en médiation on dit toujours: On n’a pas besoin de connaître toutes les lois, en médiation, parce que, là, ça deviendrait un petit tribunal, mais on a besoin d’être capables de référer aux bonnes personnes quand c’est nécessaire, parce qu’on est toujours un peu proche d’une loi. Que ce soit en matière de harcèlement, que ce soit en médiation familiale, que ce soit en protection de la jeunesse, que ce soit même en justice communautaire pour les jeunes contrevenants, il y a toujours une loi ou un juge pas loin qui a besoin des fois d’un auxiliaire, si on veut, pour certains aspects du conflit que lui-même ne peut pas traiter.
Donc, c’est sûr que ça nous demande d’être attentifs au milieu légal, mais ce n’est pas là-dessus qu’on va… ce n’est pas notre cadre de référence, si je peux dire. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Mme Hivon: Oui. En fait, c’est que ça m’amène à l’article 5. Je pense qu’un des soucis de ceux qui nous disent l’effritement du droit, la primauté du droit, puis tout ça, je pense, je ne suis pas dans leur tête, mais c’est de dire: Il faut peut-être qu’il y ait un arrimage entre la justice privée et la justice publique, c’est-à-dire qu’on n’écarte pas complètement la considération du droit, ne serait-ce que parce que, dans certaines circonstances, l’entente qui va découler de la médiation ne sera peut-être pas l’étape ultime, parce que peut-être que des fois on formalise davantage, il y a une transaction, tout ça, ça a vraiment un effet beaucoup plus formel, des fois non, puis des fois on va se retrouver peut-être plus tard dans un processus plus judiciaire traditionnel, si vous voulez. C’est pour ça que je vous parlais de l’arrimage.
Mme Bérubé (Linda): Excusez-moi, mais, quand ils parlent d’arrimage, j’essaie d’imaginer ça pourrait vouloir dire quoi, l’arrimage. Est-ce qu’ils le disent?
Mme Hivon: Bien, il y a différentes questions pour l’arrimage, mais moi, j’imagine que vous arrivez à une entente entre les parties qui est fondée sur des choses autres que le droit mais qu’à un moment donné cette entente-là ne tient plus, n’est plus respectée, puis là on repart, on rentre dans un processus, puis on pourrait vouloir concilier, concilier avec… c’est-à-dire refaire une médiation, intégrer des principes de justice, aller dans la justice traditionnelle. Certains nous disent: Est-ce que, dans une hypothèse comme celle-là, il faudrait rentrer dans le train à partir de zéro? Est-ce qu’on arriverait plus loin dans le processus? C’est un peu tout ça, là.
Mme Bérubé (Linda): C’est des bonnes questions. Je trouve qu’il faut continuer de réfléchir à ces questions-là, je n’ai pas tout à fait de réponse. Ce qui me venait pendant que vous parliez: Parfois, les gens vont homologuer. Il y a quelqu’un qui est venu devant vous, un notaire, qui a dit: Bien, ça devrait être notarié. Les gens peuvent le faire notarier s’ils veulent, mais en même temps, si on veut faire confiance au citoyen puis qu’il devienne responsable, bien là il y a aussi une part de risque, une part de risque que tout n’est pas formaté. Si on veut laisser la place aux gens pour réfléchir puis devenir responsables de leur vie, il faut accepter cette part de risque là. On ne peut pas protéger les gens de tout.
En même temps, bien, je suis moi-même une adepte de mettre en commun. Et je n’ai pas eu le temps de lire, tout à l’heure, ma conclusion, mais c’était justement sur l’importance qu’on continue de réfléchir ensemble mais pas juste les juristes entre eux autres, parce que c’est ça, moi, qui commence… Je veux dire, je vais rester positive, je vais dire comme M. le ministre, mais c’est difficile de voir tous ces gens-là qui parlent dans leur jargon, puis nous, on est là, à côté, puis on est comme sur le bord de la porte, puis qu’on essaie de dire notre mot. Ce n’est pas évident.
Donc, c’est pour ça que je suis ici aujourd’hui, parce que vous m’avez accordé cette occasion-là, mais ce n’est pas si simple pour les non-juristes de parler avec les juristes. Et je le sais parce que mes amis sont juristes, la plupart de mes collègues sont juristes, puis je les aime beaucoup, les avocats, mais des fois, là, ils peuvent être, bon…
Une voix: …
Mme Bérubé (Linda): …oui, fatigants. On va juste se limiter à… Bon. Mais, ceci dit, je préconise qu’on continue de discuter, parce que c’est de ça que vont germer les bonnes idées. Mais il faut se trouver des places pour faire ça.
Mme Hivon: Je vous comprends bien sur les avocats. Moi, je dis souvent: Je suis avocate, mais j’ai aussi des qualités. Donc, on n’a pas juste, juste des défauts, même si on est avocats. En fait, c’est que…
Une voix: …
Mme Hivon: Oui, c’est ça. J’ai deux prises contre moi, imaginez.
En fait, c’est qu’en réfléchissant sur l’article 5 et en réfléchissant sur cette question d’arrimage c’est quelque chose à quoi je n’avais pas songé au départ, mais je réfléchis avec vous… Et je ne veux pas, là, trouver la petite faille ou tout ça, mais, dans la mesure où on veut donner une plus grande certitude, par exemple, à la suite d’une médiation à l’entente, on veut que ça soit homologué, on veut une transaction — j’imagine qu’il y a eu des circonstances comme ça — là la question de l’arrimage se pose plus, parce que je dirais que ça rentre… c’est formalisé, et donc ça a un caractère… Je ne sais pas comment décrire ça, mais ça doit être suivi, ce n’est plus qu’entre les parties. Et, si quelqu’un se base sur des règles qui n’ont rien à voir avec le droit… Moi aussi, je conçois que c’est tout à fait nécessaire pour pouvoir avoir différents types de médiation, puis tout ça. C’est plus cette question-là qui me vient à l’esprit: Quand on va vouloir formaliser la chose ou s’assurer qu’on va plus loin que la simple entente entre les parties, comment cet arrimage-là va pouvoir se faire?
**(17 h 40)**
Mme Bérubé (Linda): Cet arrimage-là se fait régulièrement en médiation familiale. Quand on fait une entente en médiation familiale, nous, on la rédige pour que les parties puissent la comprendre puis qu’il y ait des détails que tu n’as souvent pas dans une procédure juridique, puis après ça, bien, les parties, soit qu’ils font une demande conjointe eux-mêmes ou soit qu’ils vont voir un avocat pour la rédiger sous une forme juridique. Ça, ça se fait. Ça fait 15 ans que ça se fait, ce n’est pas un problème.
En matière, par exemple… On parle de d’autres matières. Si je pense en matière de harcèlement psychologique, par exemple, bien là les questions de droit, là, je peux vous dire qu’elles sont petites, petites, petites, en matière de harcèlement, parce que comment qu’un avocat viendrait dire, là… Ça prend des faits, ça prend… Tu n’as pas grand-chose à écrire. C’est souvent, quand ils s’entendent: Bien, on va se dire bonjour, puis on va se saluer le matin, puis je… Ce n’est pas des grosses règles, là, puis ce n’est pas des 100 000 $ qui sont sur la table, là, tu sais, ça reste de l’humain là-dedans.
Si on parle de conflit de voisinage, c’est un petit peu la même chose aussi. On parlait d’où est la clôture, là. Bien, la clôture est là, mais c’est ce qui se passe de l’autre bord de la clôture qui est intéressant, puis ça, la loi ne veut rien savoir de ça. Ça fait que, quand même tu écrirais ça dans une entente puis tu le ferais homologuer, ça va donner quoi?
Alors, il y a tellement de types de conflit dans notre société, il y en a qui méritent et qui doivent absolument être homologués. Puis, même en médiation familiale, moi, je disais des fois à des gens: Allez-y, allez-y, vous ne le regretterez pas, c’est important que vous soyez sûrs que l’un et l’autre, vous allez respecter, parce que des fois on sait qu’il y a des risques que ça ne soit pas respecté. Ça fait qu’on peut recommander plus fortement que ça soit homologué quand il y en a, des risques, mais, d’un autre côté, il ne faut pas non plus voir du danger partout. Puis les gens, quand ils viennent en médiation, très souvent c’est parce qu’ils ne veulent pas aller en cour, ça fait qu’ils ne veulent pas aller en cour en plus d’aller en médiation. C’est ça qu’il ne faut pas oublier aussi.
Puis je reviens à la responsabilité du citoyen puis je reviens aussi à la responsabilité du médiateur, s’il voit qu’il y a des risques, de faire des suggestions. Et, moi, combien de fois souvent j’ai recommandé à des gens d’aller voir un conseiller juridique, de faire évaluer leurs régimes de retraite, ils ne voulaient absolument pas. Bon, si quelqu’un, il ne veut pas, tu lui expliques de long en large les risques, qu’un régime de retraite, la valeur qu’il a cotisée, ça n’a rien à voir avec la valeur actuarielle, tu lui expliques tout ça. Mais, s’il ne veut pas, là, bien il est responsable de ses choix, hein? Moi, je… C’est le dernier mot pour moi, en tout cas, quant à moi.
Mme Hivon: Puis je pense que toute cette approche-là vient aussi de la responsabilisation, vient d’une volonté que les parties se responsabilisent, puis une solution qui est trouvée par les parties qui agissent de manière responsable risque d’être plus acceptée, tout ça, on est tous d’accord avec ça. Mais l’exercice que je fais un peu avec vous, c’est qu’on a des gens qui se présentent ici — et vous l’avez vu juste aujourd’hui — avec toute une panoplie, je dirais, d’acceptations par rapport à ce virage-là qu’on tente de prendre, et ce sont des arguments qui nous sont présentés. Donc, je pense que c’est important d’aller au fond des choses de part et d’autre sur cette question-là notamment.
Mme Bérubé (Linda): Si je peux me permettre de faire remarquer qu’il n’y a aucune obligation d’aller là, puis on ne tord le bras de personne, hein, en demandant de considérer, là, juste de dire que ça existe, là. Puis ça fait 20 ans que ça existe. Juste de reconnaître que ça existe, je ne crois pas que le système de justice soit si fragile et si friable que d’inscrire ça dans le code… S’ils ont peur de ça, c’est parce que, mon Dieu, moi, je trouve le système de justice plus solide qu’eux. Je ne pense pas que le système de justice va être ébranlé puis je ne pense pas que ni le Barreau ni les associations d’avocats, quels qu’ils soient, sont mal équipés pour se défendre par rapport à tout ce qui pourrait arriver de malencontreux dans le futur.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci, Mme Bérubé. Est-ce qu’il y a d’autres questions du côté ministériel?
M. Fournier: Juste quelques commentaires suite à l’échange, parce que je me suis senti interpellé. Je ne sais pas si c’est mon côté avocat, quoique c’est moins pire parce qu’avec le mandat que j’ai je suis aussi Notaire général, donc tout à coup je me sens moins pire que les autres mais pas pour longtemps, là, tu sais, ça passe, ce mandat-là. Je ne serai pas notaire comme toi, Vincent, si longtemps. Et vous disiez le souhait que vous avez que les mondes se parlent, soit le vôtre, le monde juridique, pour le bien du citoyen, et je veux juste en profiter pour vous dire que c’est un peu ce à quoi nous assistons présentement. Je crois que la proposition d’avant-projet de loi, c’est le reflet d’une évolution, là, ce n’est pas non plus, là… ce n’est pas inventé d’hier, là, c’est le reflet d’une évolution, mais en même temps c’est aussi une espérance, c’est aussi une main tendue à ce que tout le monde se dise: Bien, peut-être qu’on peut relever ce défi-là puis qu’on a avantage au dialogue. Je vais juste prendre à la volée ce que vous avez dit, parce qu’il y a, dans les… bien, dans la journée aujourd’hui, cet avant-projet de loi était une réaction intempestive et irréfléchie, alors qu’il y a quand même un certain nombre d’années qu’il y a des gens qui ont des expériences où on ouvre, et ce n’est pas une abdication de la justice adjudicatrice, au contraire, c’est même de trouver des moyens pour qu’elle soit plus performante et plus accessible.
Donc, il y a un accès à la justice, entre guillemets, traditionnelle et puis un accès à une justice autre… je n’aime pas prendre le mot «complète», mais une justice plus large, qu’il n’y a pas que le règlement d’un litige transformé en termes juridiques mais plus de relation entre les parties, parce que, dans un litige juridique, il y a des parties, puis forcément, si le litige est arrivé, il peut avoir été causé par une relation… ou qu’il devienne cause d’un type de relation, et donc problématique plus large. Et, dans le fond, adroitement ou maladroitement, le projet… Puis il y en a eu d’autres avant, il y a eu d’autres… Ce projet de loi là, ce n’est pas la lumière qui jaillit tout à coup, là, il y a eu plein de moments qui ont été franchis jusqu’ici, où le législateur, je crois, essaie de donner à l’ensemble de la société comme message: Oui, on peut trancher des litiges, et, oui, on va le faire, et, oui, on va le faire le mieux possible et avec les règles les plus compréhensibles, simples, accessibles, mais en même temps on va régler un litige juridique, de l’ordre juridique, mais on peut aussi se donner la main pour essayer d’aller plus profondément. C’est ce que certains sont venus nous dire sur l’accès à cette justice participative où on ne s’entend pas. Certains disent: Tout le monde est rendu là. D’autres nous disent: Encourageons les gens pour y aller.
Alors, je ne sais pas si l’histoire commence ou si elle est rendue à mi-chemin, là, difficile à dire où on est rendus, mais je profite simplement de votre message sur le fait que vous souhaitez que les mondes se parlent. Je crois que nous avons tous avantage, comme société… et je pense bien que ma collègue, lorsqu’elle parle d’un code de justice ou… — et je ne sais pas comment il peut être nommé — on souhaite tous se dire: La justice, c’est le droit, mais c’est aussi un ensemble d’autres éléments pour que le monde et les gens soient justes. Et il n’y a pas que l’aspect… Il y a un aspect juridique, forcément, là, mais, au-delà de ça, c’est parce qu’il y a une multidisciplinarité qui vit bien ensemble.
Alors, vous l’avez bien décrit tantôt, il faut essayer de concevoir que, dans l’offre de services au citoyen, pour l’aider à trouver la bonne solution juste, on n’évacue pas une dimension. Alors, quand l’article 5 dit «des critères autres que ceux du droit», il y a les critères du droit, mais il peut y en avoir d’autres, critères, que ceux du droit, et on a besoin de la multidisciplinarité pour y arriver. C’est probablement la façon dont on peut s’organiser pour offrir ce service-là au citoyen qui est le plus important.
Mme Bérubé (Linda): Pour moi, j’avais commencé en me disant qu’un milieu formel comme le milieu juridique, c’est nécessaire, dans une société, pour établir une base solide. Puis tout à l’heure je faisais un peu des farces avec mes amis avocats puis avec le Barreau, mais j’estime ces institutions-là puis je respecte beaucoup leur travail. Je trouve qu’il est essentiel, on ne peut pas s’en passer, et c’est justement parce qu’ils le font bien qu’on peut se permettre, nous, d’essayer de mettre notre épaule à la roue, puis de faire notre part, et de leur laisser justement, pour les vrais litiges, les vraies questions juridiques, laisser tout le temps aux juges et aux tribunaux de se concentrer sur ces questions-là puis non pas sur les chicanes qui pourraient être résolues par les citoyens eux autres mêmes.
Puis il faut tenir compte du fait aussi que notre société évolue, les gens sont instruits. Les gens ne sont plus, là, dans le temps qu’ils allaient voir le notaire puis le curé pour se faire dire quoi faire, là. Les gens, puis ça va être encore plus vrai, là, avec les gens de la génération Y, ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Ça fait que, s’ils ne veulent se faire dire quoi faire, il faut aussi qu’ils assument le fait qu’ils doivent se parler pour trouver des solutions s’il y a deux points de vue qui se confrontent, qui s’affrontent.
Donc, c’est tout un changement de culture. Puis on disait: Est-ce qu’on est en avance ou pas en avance? Moi, je pense qu’on est en chemin. On a un bout de fait, mais il en reste beaucoup à faire, et je crois que c’est en élargissant le monde juridique à d’autres points de vue… Puis le Barreau l’a bien compris quand il s’est élargi avec la justice participative puis a commencé à dire à ses membres: Oui, bien oui, c’est une voie d’avenir, il faut s’intéresser à ça. Puis les clients le demandent aussi. Que ce soient les corporations ou les gens, ils demandent, comme on disait, de régler leurs problèmes.
Pas plus tard qu’avant Noël, je faisais une médiation d’entreprise entre deux entreprises qui avaient cessé de se parler depuis six mois, et puis on a rétabli la communication. Puis ce n’étaient pas des problèmes financiers, puis ce n’étaient pas des problèmes juridiques, puis ils ont réussi merveilleusement bien à créer quelque chose pour aller de l’avant, mais ils auraient pu aller voir un avocat, puis là ils auraient foutu l’affaire… Il n’y avait rien de juridique là-dedans, bien qu’il y avait certains aspects, mais ils ont pris leurs responsabilités puis ils ont pris leurs choses en main. Mais ils savaient qu’ils avaient besoin d’aide, ils savaient qu’ils ne pouvaient pas le faire tout seuls. Ils avaient essayé de le faire tout seuls puis ils avaient claqué la porte. Donc, des fois, ça prend juste un guide pour tenir le cadre, puis aider les personnes à aller chercher ce qu’ils veulent, puis aider les personnes à s’exprimer puis à rétablir l’équilibre.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. Est-ce que la députée de Joliette… Vous avez d’autres questions?
Mme Hivon: Oui, deux petites questions.
La Présidente (Mme Rotiroti): Allez-y.
Mme Hivon: Donc, juste pour terminer sur l’article 5, je comprends que vous dites: C’est bienvenu, mais je comprends aussi que, dans l’état actuel des choses, vous pouvez tout à fait, dans la manière dont vous pratiquez la médiation, avoir recours aux normes et critères que vous souhaitez, dans le sens que tantôt vous avez dit: Oui, c’est absolument essentiel, l’article 5, mais, dans le fond, dans l’état actuel des choses, vous procédez déjà, si vous le souhaitez, avec d’autres normes que le droit sans qu’il y ait l’article 5 écrit.
**(17 h 50)**
Mme Bérubé (Linda): Oui, c’est vrai. Mais, à venir jusqu’à maintenant, on n’avait rien écrit dans le Code civil ou presque rien concernant la médiation, et là on se met à en parler. Alors, si on se met à en parler, ça… si on n’en parle pas, c’est qu’il va y avoir un trou. On a parlé de la confidentialité, on parlé de l’impartialité, de la transparence, on a parlé de beaucoup… on a quand même assez bien défini dans le livre VII, et, si ici on ne met pas ça, ma crainte, ce serait qu’on s’en tienne à la norme juridique.
Mme Hivon: Parfait. Je comprends bien votre point de vue.
Dernière question. L’Association du Barreau canadien, tantôt, est venue nous dire… Parce que je pense qu’on tient un peu pour acquis que, si les gens vont vers les modes alternatifs, il risque d’y avoir des économies de temps et d’argent, pas nécessairement, mais que c’est une manière des fois de s’approprier les choses, donc que les choses se règlent plus rapidement et avec des frais moindres. Est-ce que c’est votre expérience que la médiation est généralement moins coûteuse et moins longue que le processus de justice plus traditionnel?
Mme Bérubé (Linda): Je n’ai jamais travaillé comme avocate, donc, personnellement, je ne peux vous dire la différence. Mon expérience, c’est que la médiation ne fait pas de miracle, la médiation peut prendre un peu plus de temps, mais généralement les médiateurs, d’abord, ont des taux moins élevés que les avocats, et le temps, par rapport au temps, généralement, c’est qu’on n’est pas contraints par une machine judiciaire, donc on peut procéder plus rapidement, c’est sûr. Mon expérience personnelle, c’est que ce serait mieux de demander ça à quelqu’un qui a l’expérience des deux, mais, si je regarde à côté de moi, je pense qu’effectivement c’est moins cher.
Puis j’aimerais me permettre ici une petite remarque, cependant. Au niveau de la médiation familiale, on a mis 7 h 30 min de subvention de l’État, et ça, c’est malheureux parce que… bien ce n’est pas malheureux que l’État subventionne, mais ce qui est malheureux, c’est qu’on ait pensé que tous les cas pouvaient prendre 7 h 30 min en médiation familiale. Alors, des fois, je demande à mes collègues avocats: Est-ce que vous accepteriez de prendre un dossier puis de dire: Il faut absolument que tu règles ce dossier-là dans 7 h 30 min? Parce que même en médiation il y a des dossiers simples qui prennent moins que 7 h 30 s, mais il y a des dossiers qui prennent beaucoup plus. Alors, quand le citoyen s’est mis dans la tête: Bien, c’est gratuit, donc, dès qu’il commence à vouloir payer… Ce que je veux dire, essentiellement, c’est que je crois que la médiation est moins chère mais que la médiation a un coût aussi qui n’est pas rien non plus, tu sais. Il faut que le citoyen envisage que ça ne peut pas toujours être gratuit, qu’il faut qu’il paie pour ça aussi, même si je crois qu’en général c’est moins cher.
Mme Hivon: Merci beaucoup.
La Présidente (Mme Rotiroti): Merci. Alors, à mon tour de remercier Mme Bérubé pour votre présentation ce soir et tous les groupes qui se sont présentés aujourd’hui.
Compte tenu de l’heure, j’ajourne les travaux jusqu’à demain, à 9 h 30, où la commission se réunira afin de poursuivre ce mandat. Merci. Bonne soirée.
(Fin de la séance à 17 h 53)